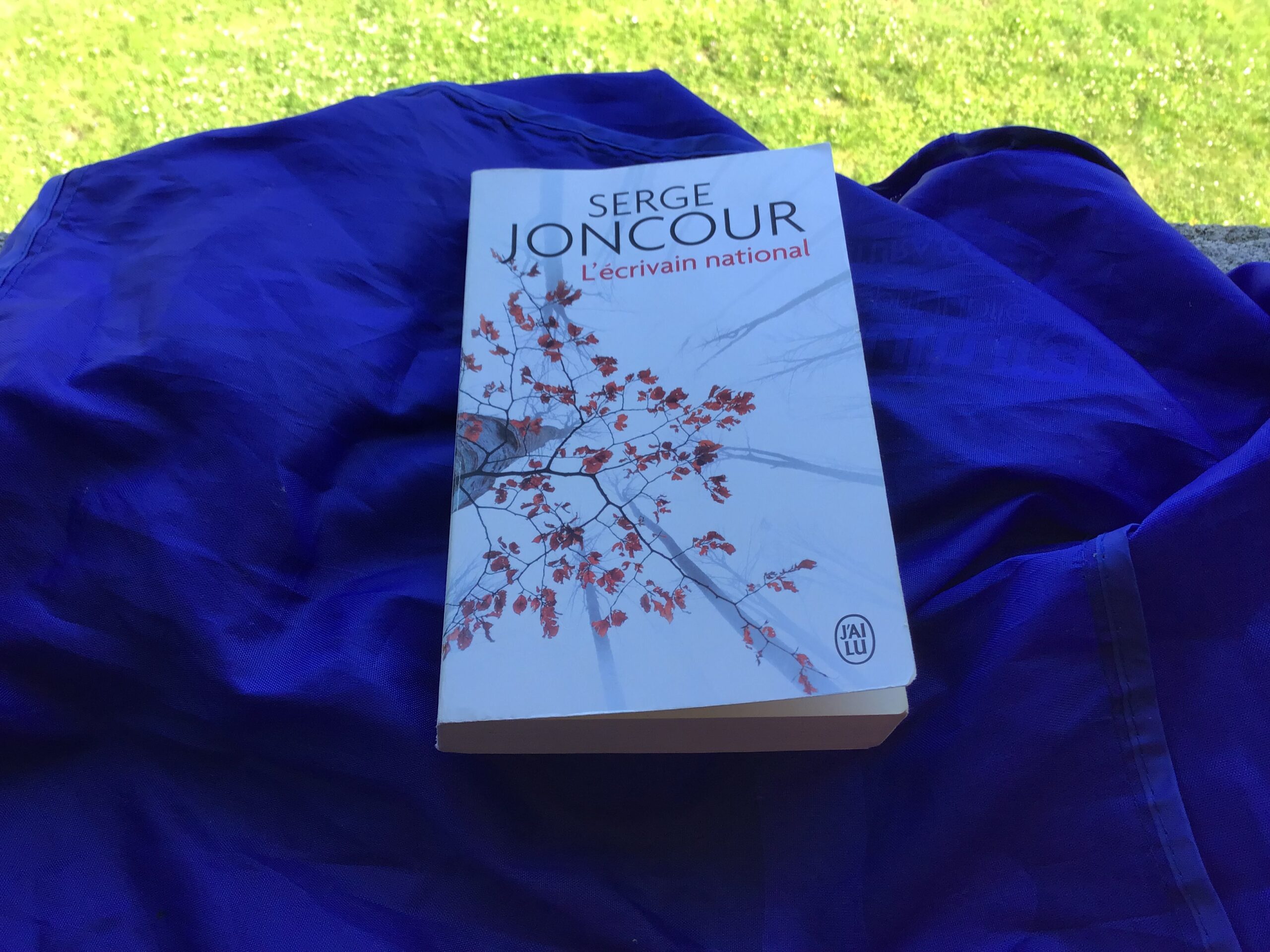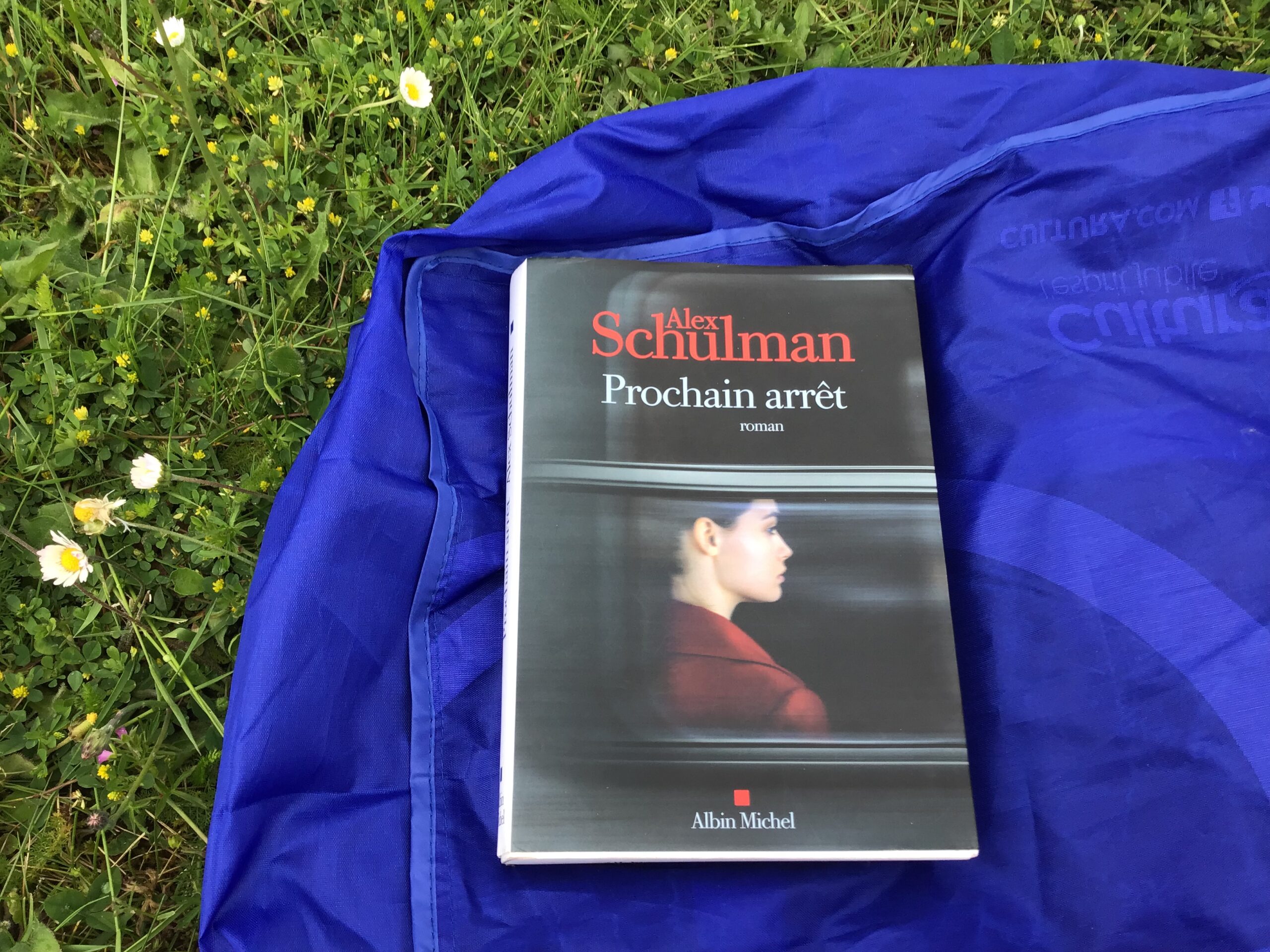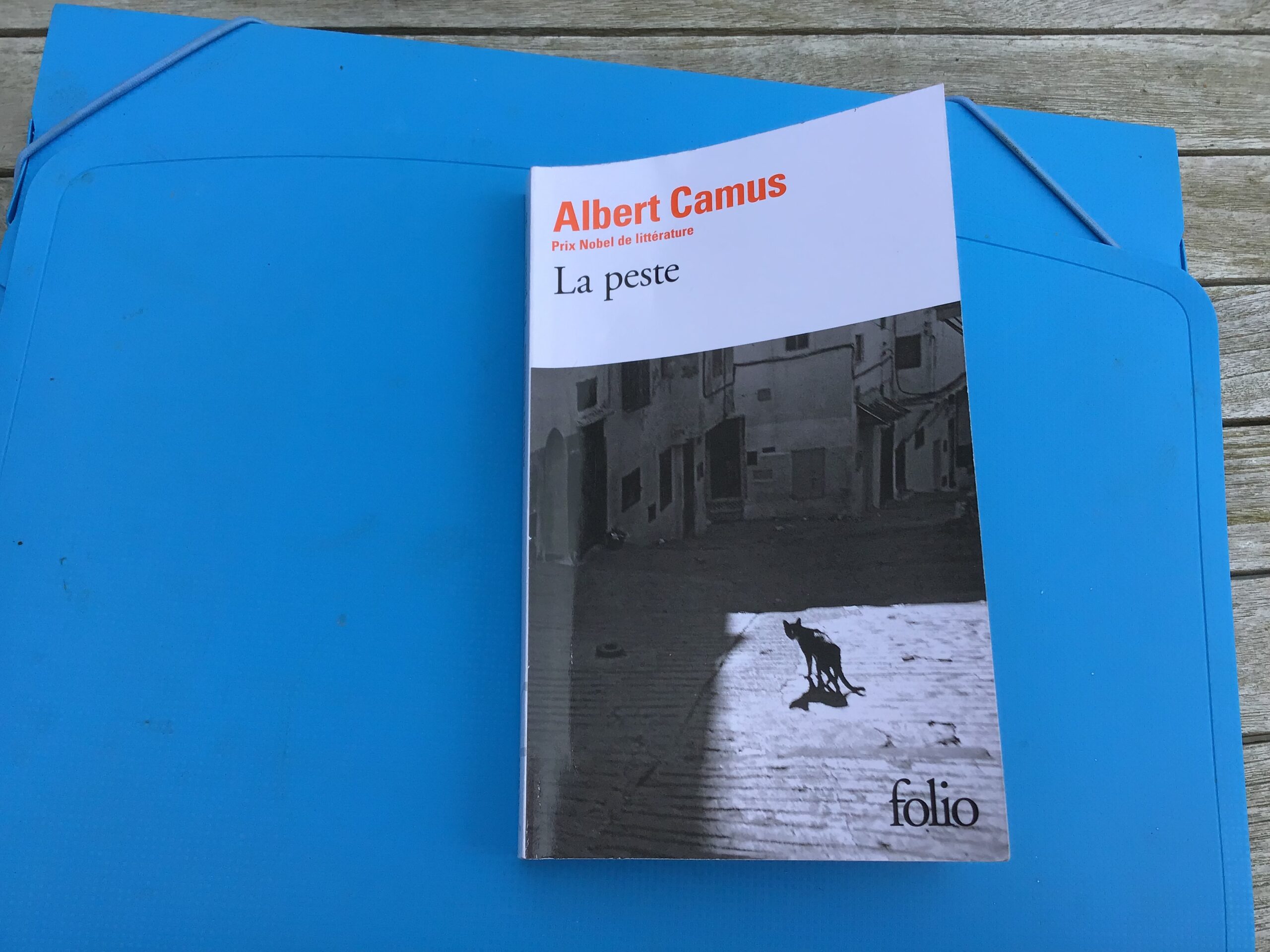Édition J’ai lu 381 pages, 2018, première édition 2015.
C’est ce qu’il y a de plus universel ça, l’envie de parler, dès lors qu’on se propose sincèrement d’écouter l’autre, alors on tient le monde.
 Voilà enfin un roman que je peux enlever de mes listes et cette lecture va aussi réduire ma pile. J’avais bien aimé « l’idole » et j’ai retrouvé avec plaisir le style de cet écrivain, cette façon de ne pas se prendre au sérieux, tout en nous décrivant un phénomène de société qui nous concernent nous particulièrement : les lectrices qui cherchent à rencontrer nos écrivains préférés dans des salons ou autres manifestations littéraires.
Voilà enfin un roman que je peux enlever de mes listes et cette lecture va aussi réduire ma pile. J’avais bien aimé « l’idole » et j’ai retrouvé avec plaisir le style de cet écrivain, cette façon de ne pas se prendre au sérieux, tout en nous décrivant un phénomène de société qui nous concernent nous particulièrement : les lectrices qui cherchent à rencontrer nos écrivains préférés dans des salons ou autres manifestations littéraires.
Car c’est de cela qu’il s’agit un écrivain est invité par des libraires dynamiques dans une petite ville dans le Morvan, pour animer une résidence littéraire pendant un mois. Il doit se rendre dans de nombreuses communes et répondre à des questions de lectrices passionnées sur son oeuvre et animer des ateliers d’écriture. Notre écrivain a ceci de particulier : il est toujours au mauvais endroit au mauvais moment, il aura bien du mal à ne pas se mettre à dos l’ensemble de la population. Le maire qui l’a fait venir pour s’assurer une nouvelle élection, les défenseurs de l’implantation de la grande scierie ont peur qu’ils soient du côté des écolos, les gendarmes qui épluchent sa vie lui voient un profil d’agitateur politico-écolo. Bref, un panier de crabes comme on n’en connaît parfois dans les petites villes et avec ça un vieil homme original qui a disparu. Il y a aussi Dora, une jeune femme superbe qui entraîne l’auteur dans des combines pas très nettes mais qui a un corps splendide.
Voilà le cadre, et dans tout cela l’écrivain raconte aussi sa façon d’écrire et cela donne au lecteur un peu l’impression de mise en abime, est ce l’écrivain qui raconte la fiction ou la fiction qui crée le processus d’écriture ?
J’ai bien aimé ce roman pour les trois quart, il se trouve que je l’ai perdu pendant deux jours puis retrouvé et la fin m’a semblé top longue et sans grand intérêt. Cela vient sans doute de la coupure entre les deux moments de lecture. Il reste que, tout ce qu’il dit sur la création romanesque et le pouvoir des livres m’a beaucoup intéressée
Extraits
Début.
Ce séjour promettait d’être calme. C’était même l’idée de départ, prendre du recul, faire un pas de côté hors du quotidien. En acceptant l’invitation je ne courais aucun risque, la sinécure s’annonçait même idéale, un mois dans une région forestière et reculée, un mois dans une ville perdue avec juste ce qu’il faut de monde pour ne pas craindre d’être seul, tout en étant royalement retiré, ça semblait rêvé.
La chambre d’hôtel.
À l’intérieur régnait le calme douillet d’une chambre sans âme mais, augmentée de mon bazar précoce, je me sentais chez moi. Je me sens toujours pleinement à l’aise dans une chambre d’hôtel. La chambre d’hôtel, c’est la sphère idéale, dégagée de toute histoire, de toute contrainte, de tout passé. La chambre d’hôtel, c’est le territoire parfait pour croire de nouveau en soi, avoir l’impression d’être neuf, réinventé.
Les fait divers.
Au-delà de l’indéniable voyeurisme, le fait divers distrait de l’actualité conventionnelle, on y éprouve les affres d’un bien intime spectacle auquel on se sent soulagé de ne pas participer. Il y a une vertu expiatoire à plonger dans ces paragraphes incandescents, ces chroniques terribles qui entraînent vers une toute autre histoire que la sienne et la rend chanceuse par comparaison.
Numéro de portable .
Chaque fois que je découvre le numéro de portable de quelqu’un, j’ai toujours un regard esthétique sur cette séquence de chiffres, lui trouvant parfois une harmonie évidente, une élégance dans la combinaison ou, au contraire, une complexité antipathique, comme s’il y avait un message possible derrière chacun de nos numéros, un sens caché, comme s’il s’agissait d’un code qui révélait quelque chose de son propriétaire. Le numéro de Dora n’était fait que de chiffres pairs, et de quatre zéros, quatre zéros et des chiffres pairs ça lui donnait une rondeur sensuelle, une consonance inoffensive.
L’amour.
Tomber amoureux, c’est voir l’autre comme un mystère dont on ne supporte pas d’être exclu, c’est redouter de ne pas l’atteindre, ne plus penser qu’à une chose : le revoir, le côtoyer. Plus je me disais que cette fille était un danger et plus elle en devenait désirable.