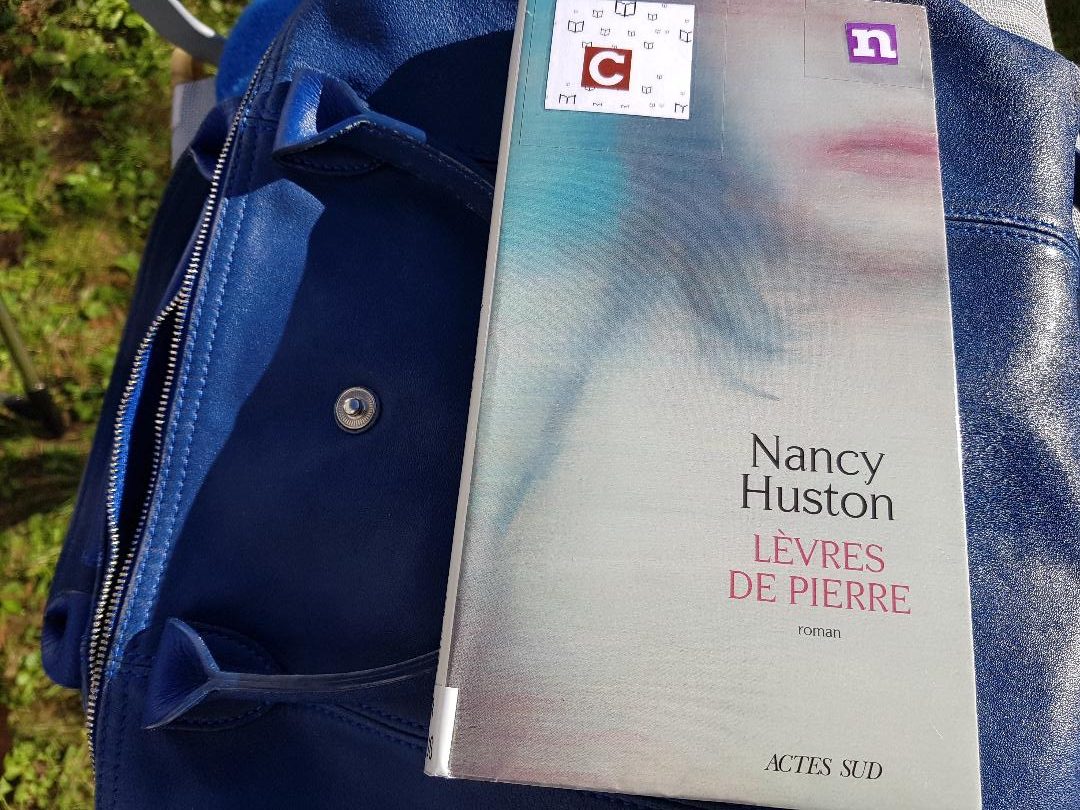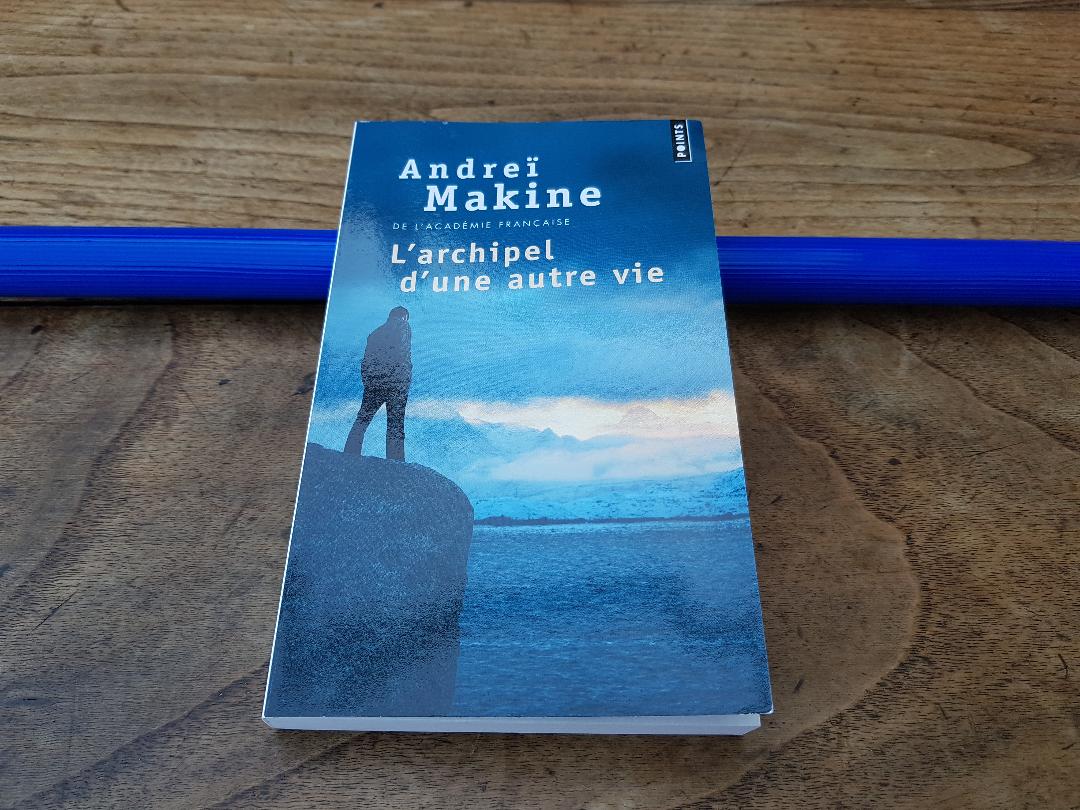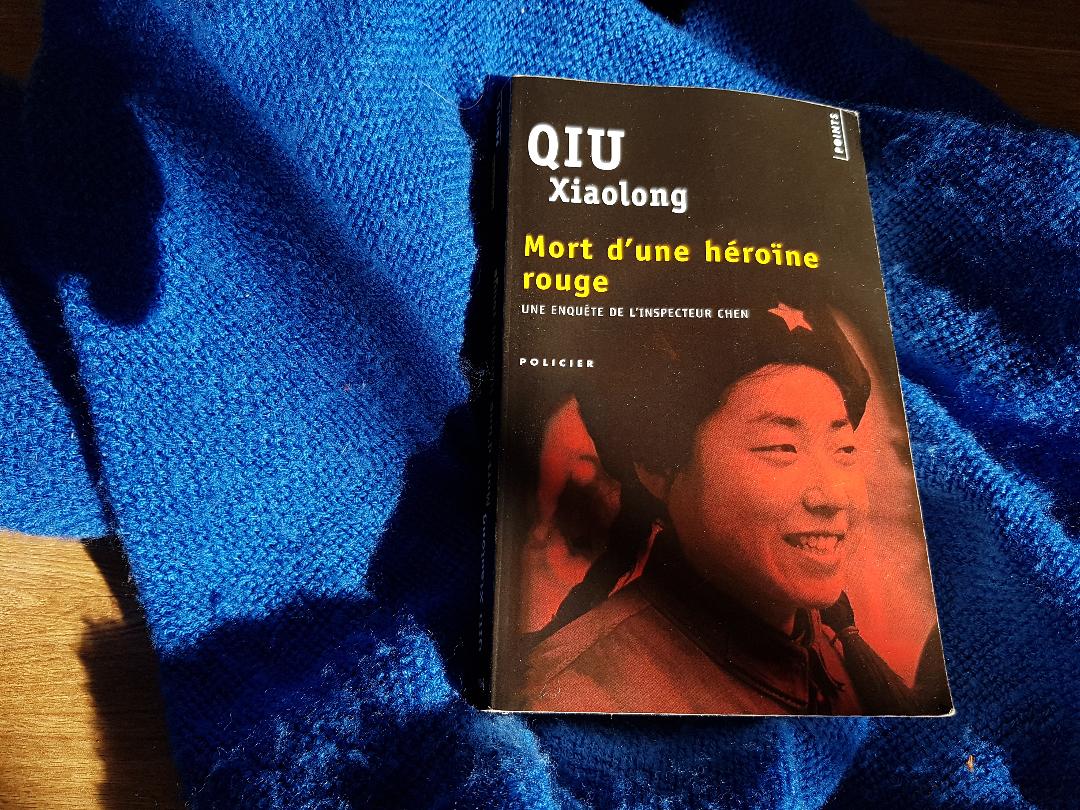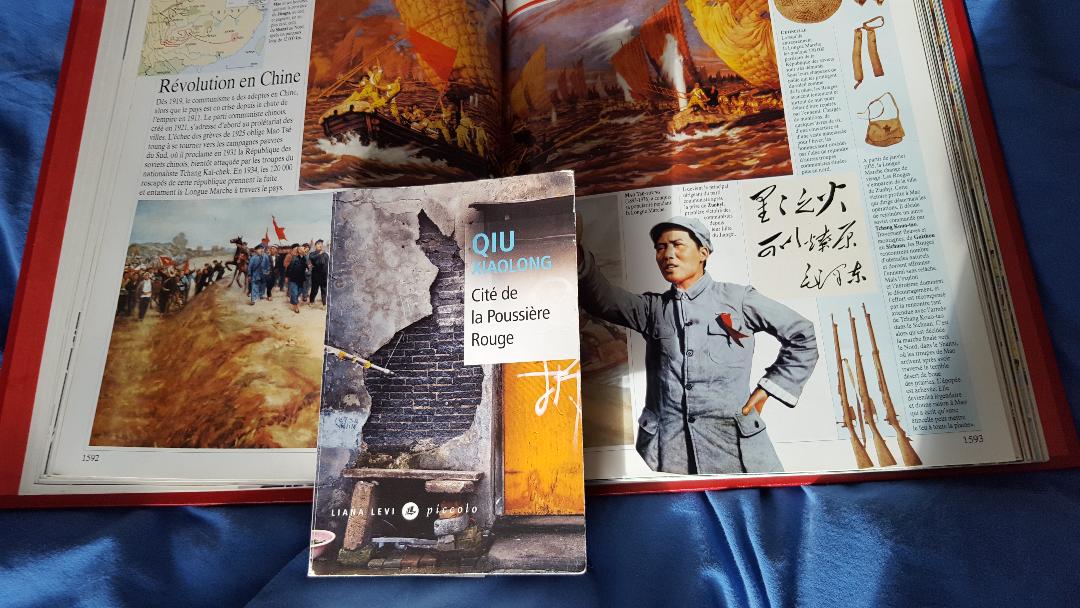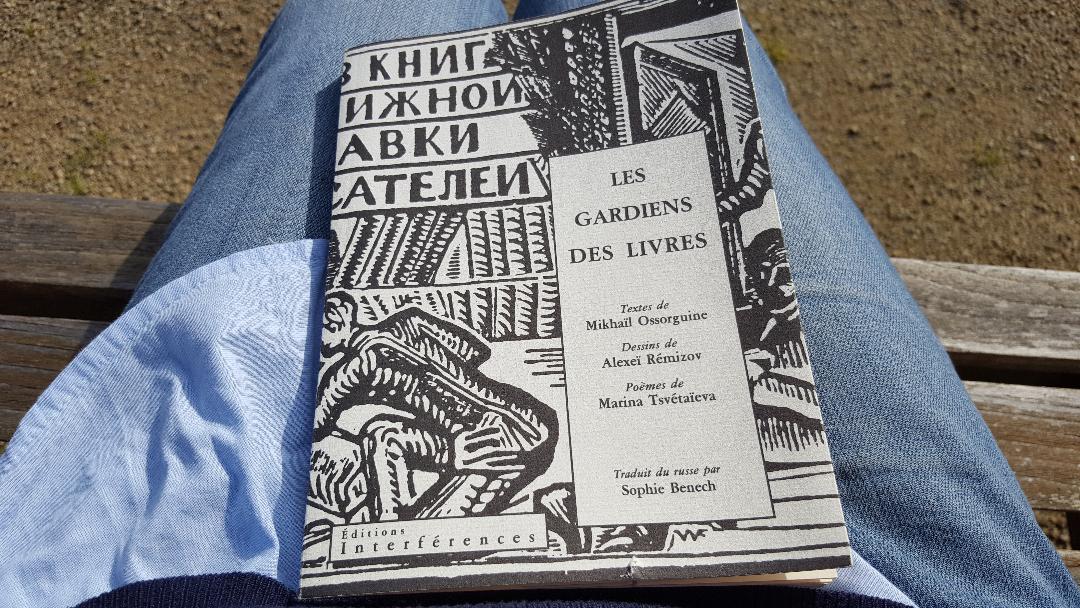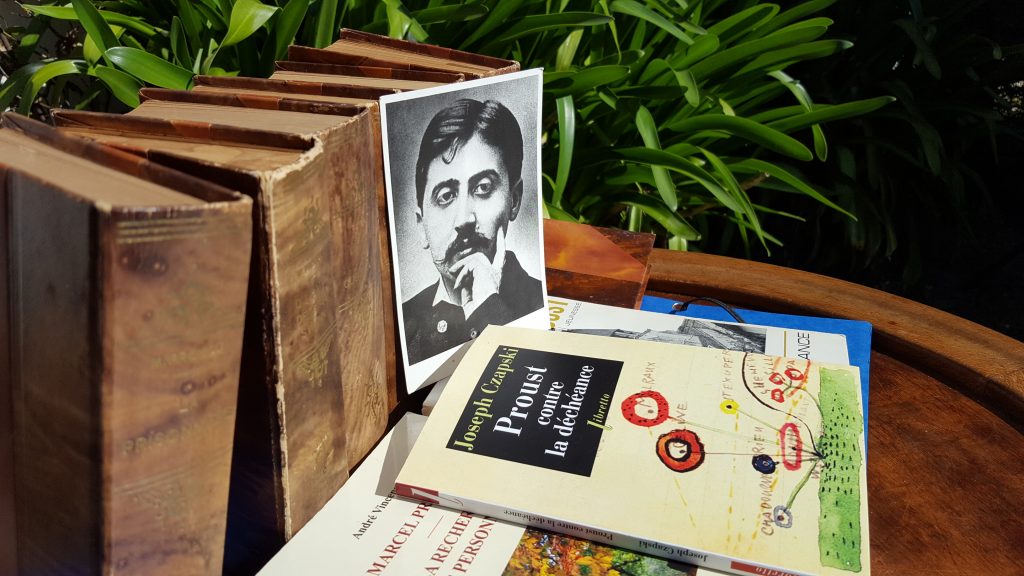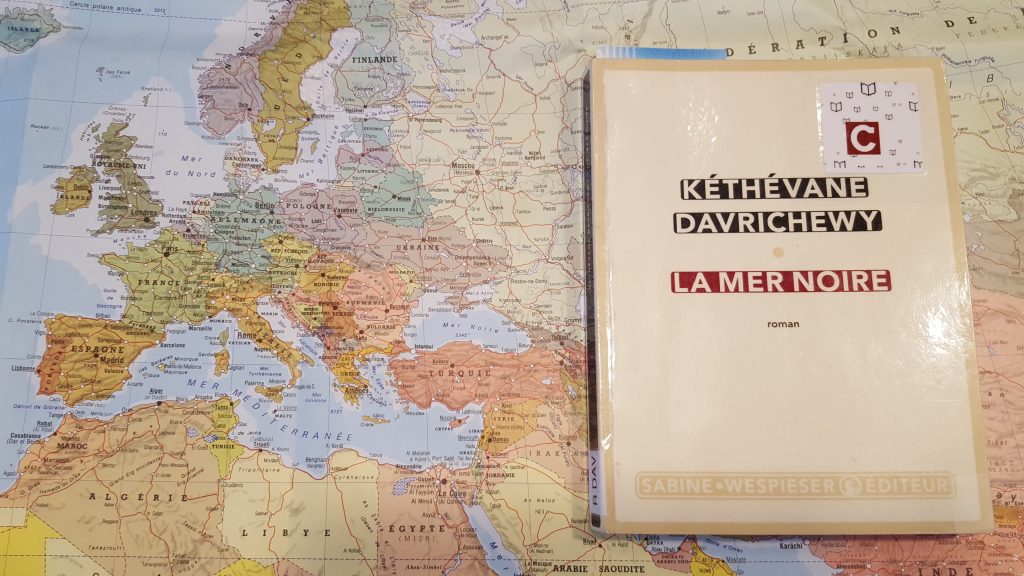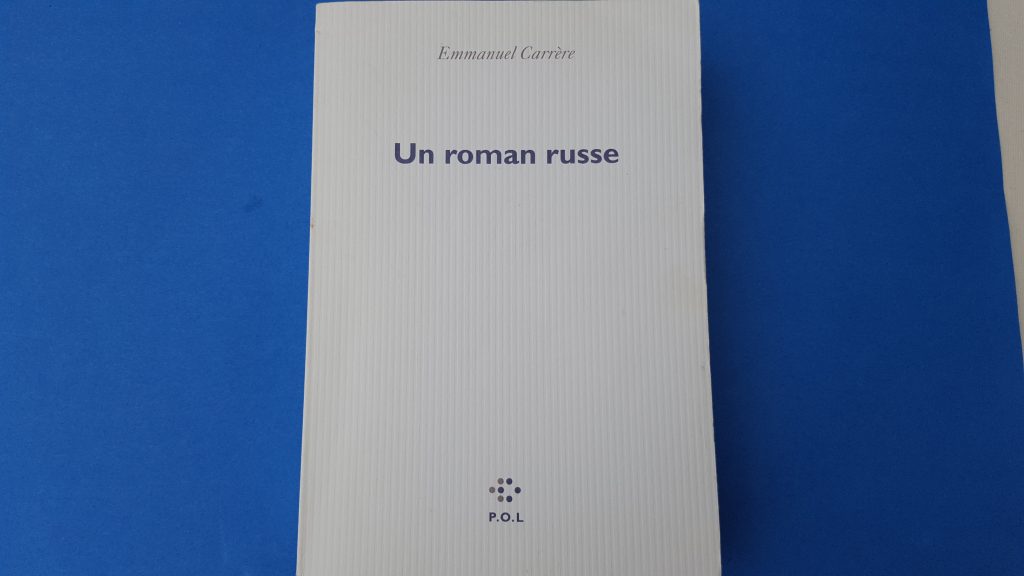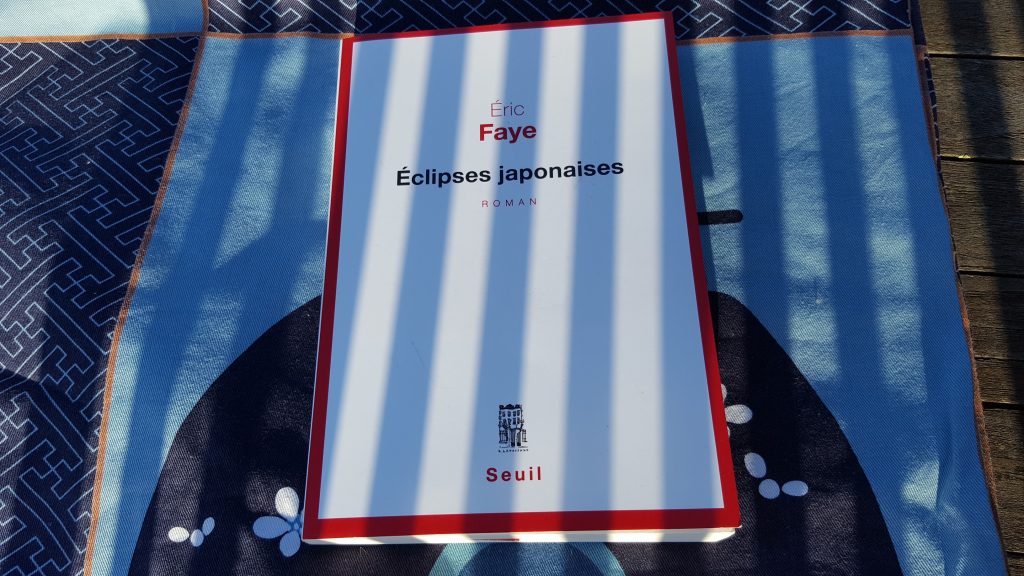Lu dans le cadre du club de lecture de la médiathèque de Dinard.
 Un livre qui m’a davantage étonnée que plu. Il y a deux livres en un, d’abord le récit de formation de Pol Pot du temps où il s’appelait Saloth Sâr . C’est dans toutes les faiblesses de cet enfant, puis du jeune homme que Nancy Houston traque tout ce qui a pu faire de cet homme qui a tant raté, ses études, ses amours, un tyran parmi les plus sanguinaires. Il ne réussit pas à obtenir ses diplômes, il fera tuer tous les intellectuels. Il puisera dans les discours révolutionnaires français, de 1789 à 1968, le goût des têtes qui doivent tomber ! Les chiffres parlent d’eux mêmes, Pol Pot est responsable de 1,7 million de morts, soit plus de 20 % de la population de l’époque. L’article de Wikipédia, en apprend presque autant que ce livre, mais l’émotion de l’écrivaine rend plus palpable l’horreur de ce moment de l’histoire du Cambodge.
Un livre qui m’a davantage étonnée que plu. Il y a deux livres en un, d’abord le récit de formation de Pol Pot du temps où il s’appelait Saloth Sâr . C’est dans toutes les faiblesses de cet enfant, puis du jeune homme que Nancy Houston traque tout ce qui a pu faire de cet homme qui a tant raté, ses études, ses amours, un tyran parmi les plus sanguinaires. Il ne réussit pas à obtenir ses diplômes, il fera tuer tous les intellectuels. Il puisera dans les discours révolutionnaires français, de 1789 à 1968, le goût des têtes qui doivent tomber ! Les chiffres parlent d’eux mêmes, Pol Pot est responsable de 1,7 million de morts, soit plus de 20 % de la population de l’époque. L’article de Wikipédia, en apprend presque autant que ce livre, mais l’émotion de l’écrivaine rend plus palpable l’horreur de ce moment de l’histoire du Cambodge.
Et puis nous voyons la très jeune narratrice, qui doit avoir plus d’un point commun avec l’auteure, passer une enfance et adolescence très marquée par le mouvement hippie pendant son enfance et mai 68 à Paris pendant sa jeunesse. Le but de ces deux histoires, est de montrer les points communs entre cet horrible Pol Pot et la narratrice. Je pense qu’il n’y a qu’elle qui voit les ressemblances. En revanche, le passage par Paris et la description des intellectuels , Jean-Paul Sartre en tête qui soutiennent les Khmers Rouges est terrible pour l’intelligentsia française. La seule excuse à cet aveuglement volontaire, c’est de ne pas vouloir prendre partie pour les américains qui ont envoyé sur le Cambodge plus de bombes que pendant la deuxième guerre mondiale sur toute l’Europe. Et voilà toujours le même dilemme : comment dénoncer les bombardements américains sans soutenir le communiste sanguinaire, Pol Pot.
Citations
l’écriture
De toute façon, elle a appris depuis l’enfance à neutraliser par l’écriture tout ce qui la blesse. Les mots réparent tout, cachent tout, tissent un habit à l’événement cru et nu . Dorit ne vit pas les choses en direct mais en différé : d’abord en réfléchissant à la manière dont elle pourra les écrire, ensuite en les écrivant. Protégée quelle est par la maille des mots, une vraie armure, les agressions ne l’atteignent pas vraiment.
Mai 68
Un jour Gérard vient l’écouter jouer du piano dans l’appartement de la rue L’homond. Au bout d’une sonate et demie de Scarlatti, il pousse un soupir d’ennui : » C’est bien joli, tout ça dit-il, mais je n’y entends pas la lutte des classes. »
Les Khmers rouges
Le 9 janvier 1979, les troupes nord-vietnamienne se déploient à Phnom Penh, révélant au monde la réalité du Kampuchéa démocratique, la capitale désertée, dévastée… Les champs stériles… Les monceaux de squelettes et de crânes… De façon directe ou indirecte, au cours de ces quarante cinq mois au pouvoir, le régime de Pol Pot aura entraîné la mort de plus d’un million de personnes, soit environ un cinquième de la population du pays. Le Cambodge gît inerte, tel un corps vidé de tout son sang .