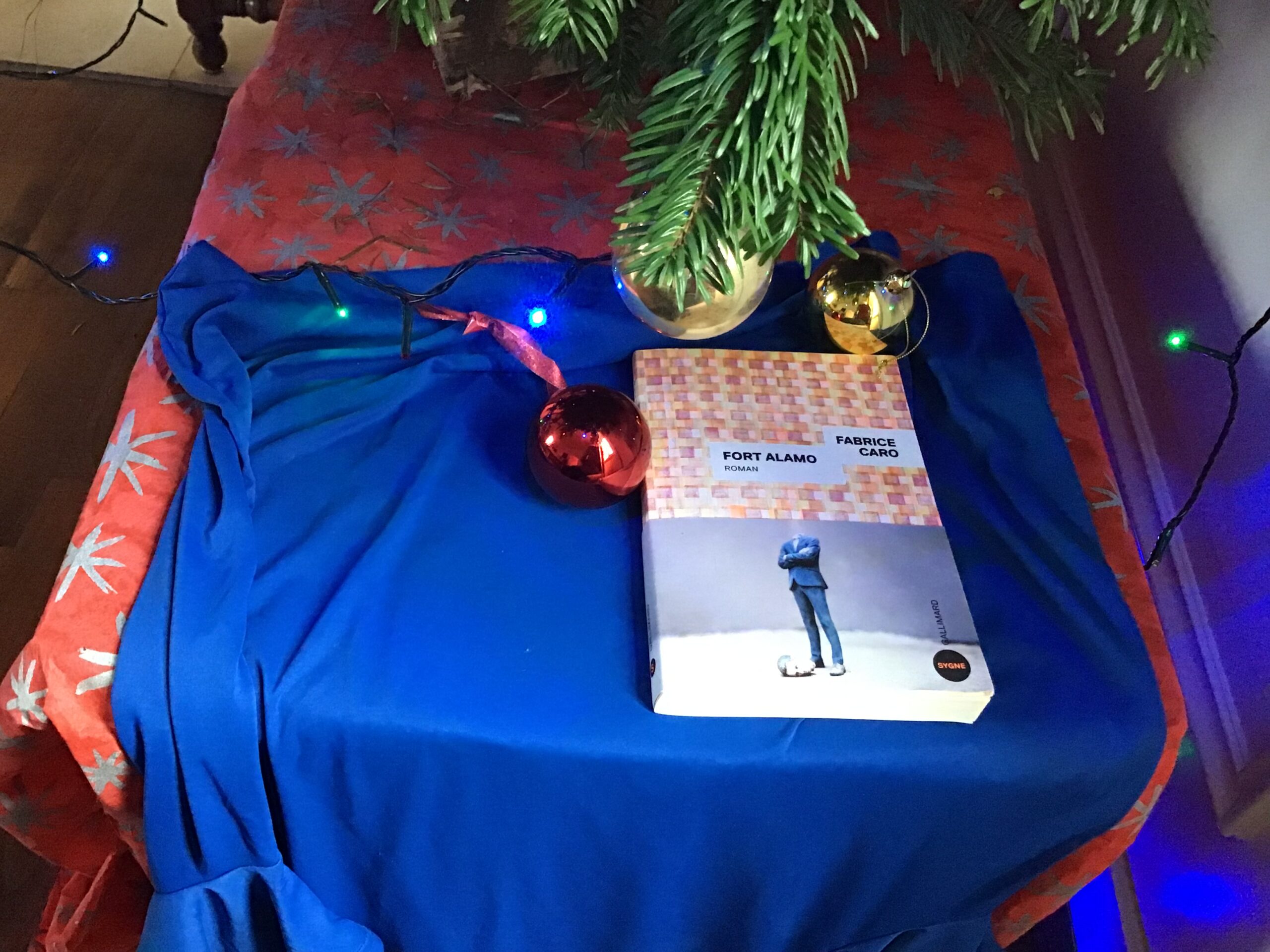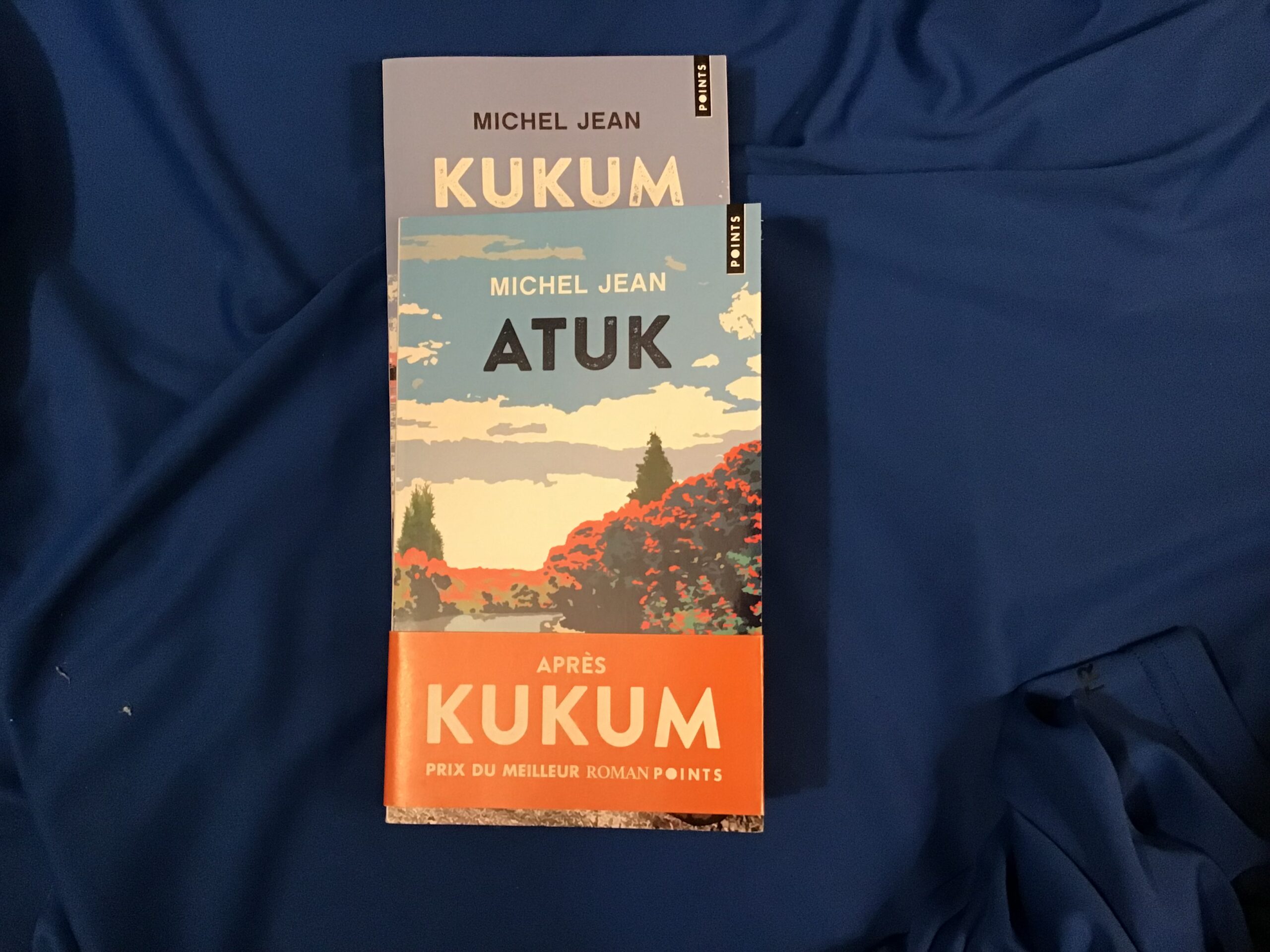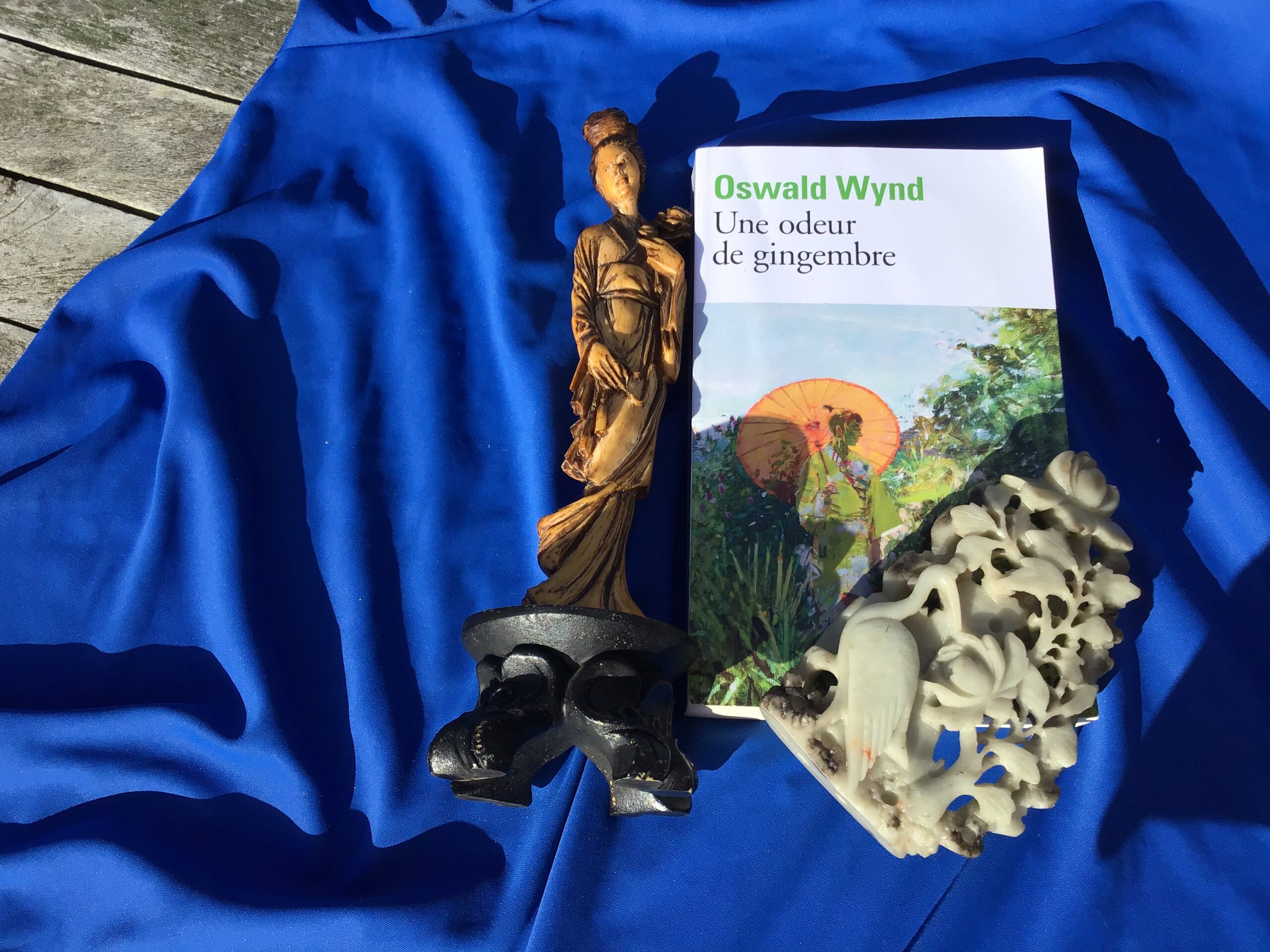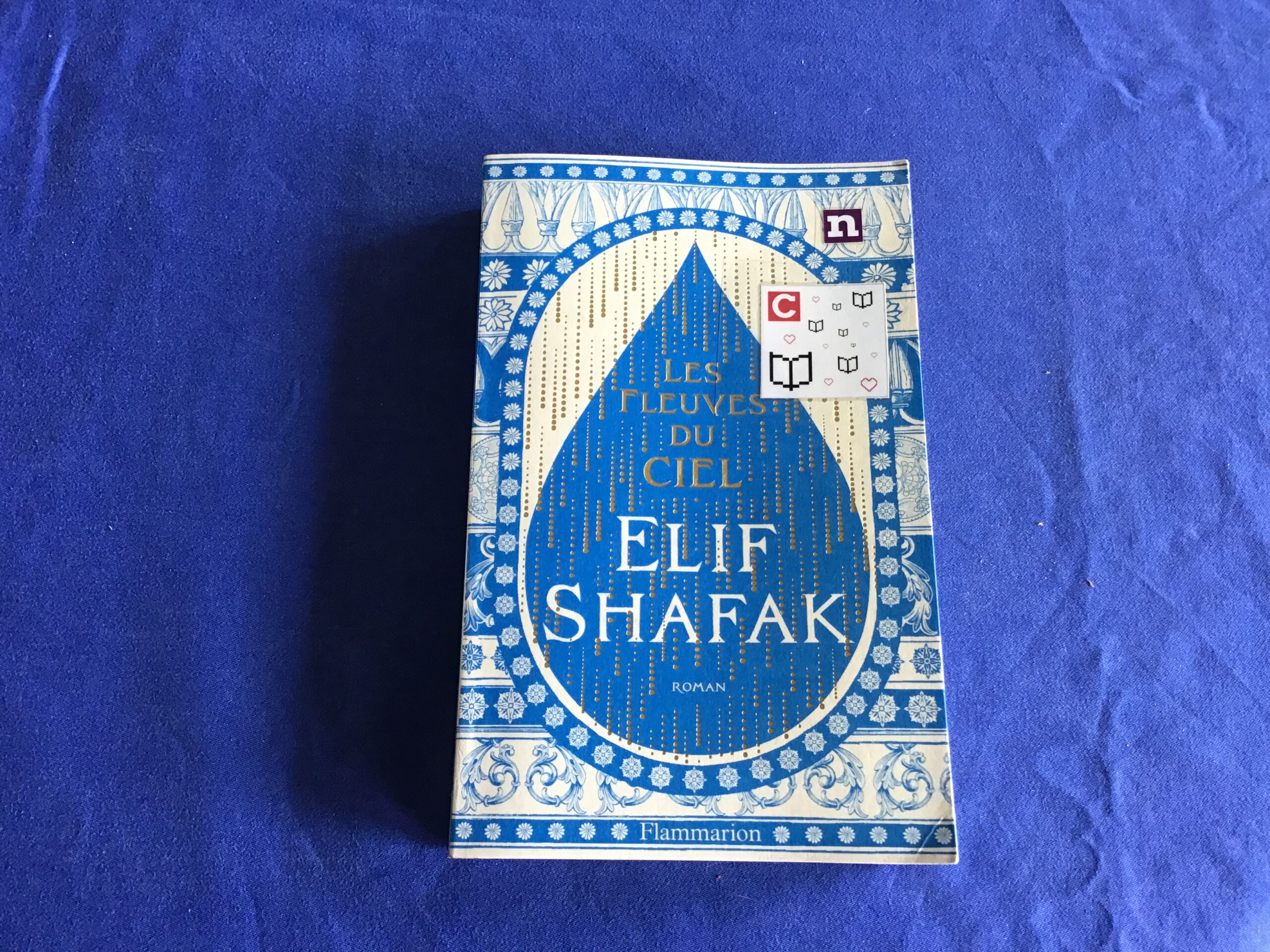Éditions Acte Sud Babel, 600 pages, mars 2022
Traduction de l’Allemand par Rose Labourie

Bien entendu, il y avait des réticences. Car au fond, tout le monde était pour l’énergie éolienne, pas vrai -mais tant qu’à faire, pas sur le pas de sa porte.
S’il y a une chose que j’ai apprise à Unterlruten, c’est que chacun habite son propre univers dans lequel il a raison du matin au soir
 C’est chez Keisha que j’avais noté ce titre mais comme il faisait déjà partie du mois de littérature allemande de l’an dernier , je suppose déjà que vous êtes nombreux comme Sacha,et Je lis je blogue, à l’avoir apprécié. À mon tour, je vais essayer de vous tenter, car ce roman est devenu au fil de ma lecture un véritable coup de cœur, même si, au début, j’ai eu un peu de mal à suivre le fil narratif à cause du nombre de personnages. (J’avais un peu oublié la lecture de Nouvel an de cette auteure, j’avais bien aimé mais moins que ce celui-ci.)
C’est chez Keisha que j’avais noté ce titre mais comme il faisait déjà partie du mois de littérature allemande de l’an dernier , je suppose déjà que vous êtes nombreux comme Sacha,et Je lis je blogue, à l’avoir apprécié. À mon tour, je vais essayer de vous tenter, car ce roman est devenu au fil de ma lecture un véritable coup de cœur, même si, au début, j’ai eu un peu de mal à suivre le fil narratif à cause du nombre de personnages. (J’avais un peu oublié la lecture de Nouvel an de cette auteure, j’avais bien aimé mais moins que ce celui-ci.)
Rappel du propos de ce roman : il se passe à notre époque, dans un village rural de l’ex-RDA. Le village doit prendre position à propos d’un champ d’éoliennes. C’est bien connu, tout le monde, ou presque, est pour les énergies renouvelables, mais de là, à voir de son jardin un parc d’éoliennes, il y a de la place pour une belle tragédie à la sauce des rancœurs rancies d’un village de campagne. L’auteure utilise un procédé qui a déçu certains lecteurs, elle passe d’un habitant à un autre, en reprenant à chaque fois, le fil de son histoire. Cela donne l’impression que le récit n’avance pas, et qu’elle se répète. Il faut aussi faire un effort pour retrouver qui est qui dans cette histoire, mais le schéma du village avec les noms des propriétaires de chaque maison que l’on trouve au début du roman aide bien à se repérer. Le fait d’aller de personnage en personnage ne permet pas, vraiment, de mieux comprendre l’intrigue mais de se rendre compte qu’aucun protagoniste de ce conflit n’est exactement ce que les rumeurs pensent de lui. Tout tourne autour d’un antagonisme violent et très ancien entre Gombrowsky, dont la famille possédait une grande ferme avant qu’elle soit transformée en une sorte de kolkhoze par le régime communiste. Ce personnage n’oubliera jamais le rôle de l’autre antagoniste : Kron, qui est venu brûler la ferme de ses parents en 1946. Gombrowsky réussira à devenir le principal acteur de la coopérative d’état, puis, lors de la réunification à faire revivre la coopérative à son profit. Kron continue à le poursuivre de sa haine alors qu’il fait vivre toute la région. Il faut maintenant savoir où sera implanté le parc éolien.
Ce village se trouve assez proche de Berlin, et donc des gens qui ne comprennent vraiment rien aux luttes ancestrales du village, fuient la ville pour effectuer un retour vers la nature, ils viennent troubler les disputes haineuses des habitués de Unterleuten (nom bien trouvé « parmi les gens ») Il y a d’abord le défenseur des oiseaux avec sa jeune femme uniquement occupée à allaiter et bercer un bébé qui l’épuise. Lui, il a toujours tout faux, ne doute jamais, et se trompe toujours. Ensuite il y a Linda, une femme énergique qui n’a peur de rien et qui sans le vouloir va être une actrice importante du drame qui va se jouer. Enfin il y a un homme très riche qui a acheté les terres que convoitait Kron. Chaque personnage tire sur les liens qui étouffent toute vie sereine possible jusqu’au drame final qui ne résoudra rien : les nouveaux arrivants repartiront et le village continuera avec des éoliennes mais sans les deux principaux ennemis. On peut faire confiance à leur génie pour s’en créer d’autres. On est au cœur même de l’âme humaine dans un moment très précis : l’adaptation d’un pays ex-communiste aux lois du marché capitaliste. En particulier dans la détestation des habitants d’un village de celui qui était « le riche » et qui ensuite a toujours réussi à rester « le riche ». Il va le payer très cher. Car finalement il avait fait le vide autour de lui, c’est une sorte de tyran domestique et sa vie familiale est une catastrophe et malgré (ou à cause de) sa réussite professionnelle, il n’aura que des obligés et aucun ami sur qui compter.
Pour moi, ce livre est à l’échelle d’un village, une illustration de beaucoup des comportements de nos sociétés. Je dois aussi dire qu’il y a beaucoup de remarques très bien vues, vous n’en trouverez qu’une partie dans mes extraits, il vous reste donc à lire ce roman pour profiter du grand talent de cette auteure.
Extraits.
Début.
« L’animal nous tient à sa merci. C’est encore pire que la chaleur et les odeurs. » Jule leva les yeux. « Je n’en peux plus.
– Ça ne sert à rien de s’énerver chérie. » Gerhard s’efforçait de donner à sa voix un ton assuré. Plus Jule cédait à l’hystérie, plus il se cramponnait à la raison. « Quand on déteste quelqu’un, tout ce qu’il fait nous dérange.
– Tu veux dire qu’il faudrait que j’essaie d’aimer l’animal ?.Et que comme ça, ça ne poserait pas de problème qu’il détruise notre vie ?
– Je veux dire que tu ne dois pas te faire des nœuds au cerveau. En t’énervant, tu ne fais de tort qu’à toi-même.
C’était un combat perdu d’avance Jule s’était recroquevillée sur elle-même et mise à pleurer, si bien qu’il ne lui resta plus qu’à s’asseoir près d’elle et à passer un bras autour de ses épaules.
Courrier administratif.
Linda sentit sa bonne humeur retomber, une chute de température interne. Les courriers administratifs ne signifiaient jamais rien de bon. L’État n’envoyait pas de lettres pour remercier ses citoyens de respecter la loi, de bien payer leurs impôts, ou de se passer d’aides sociales L’État était comme un faux ami qui se manifestait uniquement quand il voulait quelque chose. Encaisser de l’argent, infliger des sanctions, prononcer des interdictions. La vue de la lettre lui est nouait l’estomac, mais Linda n’était pas du genre à fuir l’adversité.
Phrase intéressante.
Les chasseurs focalisent, les proies ont une vision panoramique.
L’art du portrait
Il avait trimé toute sa vie pour que sa femme et sa fille vivent confortablement. En guise de remerciement, Elena lui donnait l’impression d’être un mauvais époux. Et Püppi n’avait attendu qu’une chose : que le mur tombe pour pouvoir enfin quitter « ce trou perdu d’Unterleuten ». Elle habitait Freiburg, où elle avait fait, aux frais de Gombrowski, des études aussi longues que pédantes à « l’université la plus loin de vous de tout le pays ». Comme avec son doctorat en « je sais tout sur tout » elle n’avait décroché qu’un poste d’assistante à mi-temps, Gombrowski lui avait acheté un appartement. Malgré tout, elle avait le culot de tordre du nez à l’idée Elle avait le culot de tendre du nez à l’idée que cet argent était gagné par des moissonneuses batteuses et des machines à traire.
Le marxisme et l’agriculture.
Les campagnards le savaient depuis le début la RDA était un régime qui ne tenait pas la route. Le parti auquel il fallait soudain obéir aux doigts et à l’œil venait des villes. Les cadres dirigeants formés à Moscou, ne connaissaient rien à la vie rurale et encore moins à l’agriculture. Ulbricht et consorts tentaient de compenser leurs lacunes par l’application des théories marxistes léninistes. Mais la nature n’était guère réceptive aux idées communistes. Elle avait ses règles propres. De génération en génération, les paysans avaient appris à extorquer ces fruits à la terre sableuse. Ils vivaient à la campagne, avec la campagne, et pour la campagne. Les slogans politiques, ils s’en lavaient les mains. Le vieux Gombrowski n’était pas aimé partout. Mais si son exploitation devait être engloutie dans une coopérative agricole gérée par des crétins finis, autant être avec lui plutôt qu’avec ses politicards des villes qui n’était pas capable de faire la différence entre le blé et l’orge.
Les pères écolo modernes.
Gerhard se promettait d’être un père moderne qui, au restaurant, s’indignerait à voix haute que la table à langer se trouve dans les toilettes des femmes.
La météo et les paysans.
D’ici une bonne heure Gombrowski regarderait le toit de la cabane à outils par la fenêtre de sa chambre pour voir si la pluie était tombée. Si les tuiles étaient rouges claires comme ce jour-là, il jurait parce que le blé serait trop sec. Si pour une fois il avait plu, les pommes de terre seraient trempées, ce qui était aussi une raison pour jurer. Depuis que les hommes ne croyaient plus en Dieu, ils se plaignaient constamment du temps qu’il faisait. Et quoi qu’il arrive, la météo ne trouvait jamais grâce aux yeux d’un agriculteur.
L’écologie.
La protection de la nature, c’est un business impitoyable. Subvention de l’Union européenne, emplois, agriculture bio. Sans oublier le tourisme.
Les tableaux dans les salles d’attente.
Aux murs étaient accrochées plusieurs reproductions de Magritte. Meiler n’avait jamais compris pourquoi les médecins et les juristes se sentaient obligés d’imposer leurs goûts artistiques à leur client. Encore récemment, il avait changé de dentiste parce qu’il ne supportait plus, en attendant la consultation, d’avoir sous les yeux des toiles qu’un quelconque barbouilleur amateur, sans doute le dentiste lui-même ou sa femme, avait bombardé de gros pâtés de peinture. En comparaison, Magritte était un moindre mal. Pourtant, Meiler se demandait bien ce que maître Söldner cherchait à dire des achats fonciers, contrats de mariage et ouverture de testaments en accrochant dans sa salle d’attente un homme avec un chapeau melon et dont le visage était caché par une pomme.
Humour et c’est tellement bien observé.
Quand Meiler pensait à la nouvelle génération, il voyait une armée de jeunes gens au bras droit tendu pas pour faire le salut fasciste, mais pour se prendre en photo avec leur smartphone.
 Quand j’ai une petite baisse de moral un petit Fabrice Caro et hop ! ça va mieux, ça marche à tous les coups : depuis Le Discours, Figurec, Brodway, et Samouraï
Quand j’ai une petite baisse de moral un petit Fabrice Caro et hop ! ça va mieux, ça marche à tous les coups : depuis Le Discours, Figurec, Brodway, et Samouraï