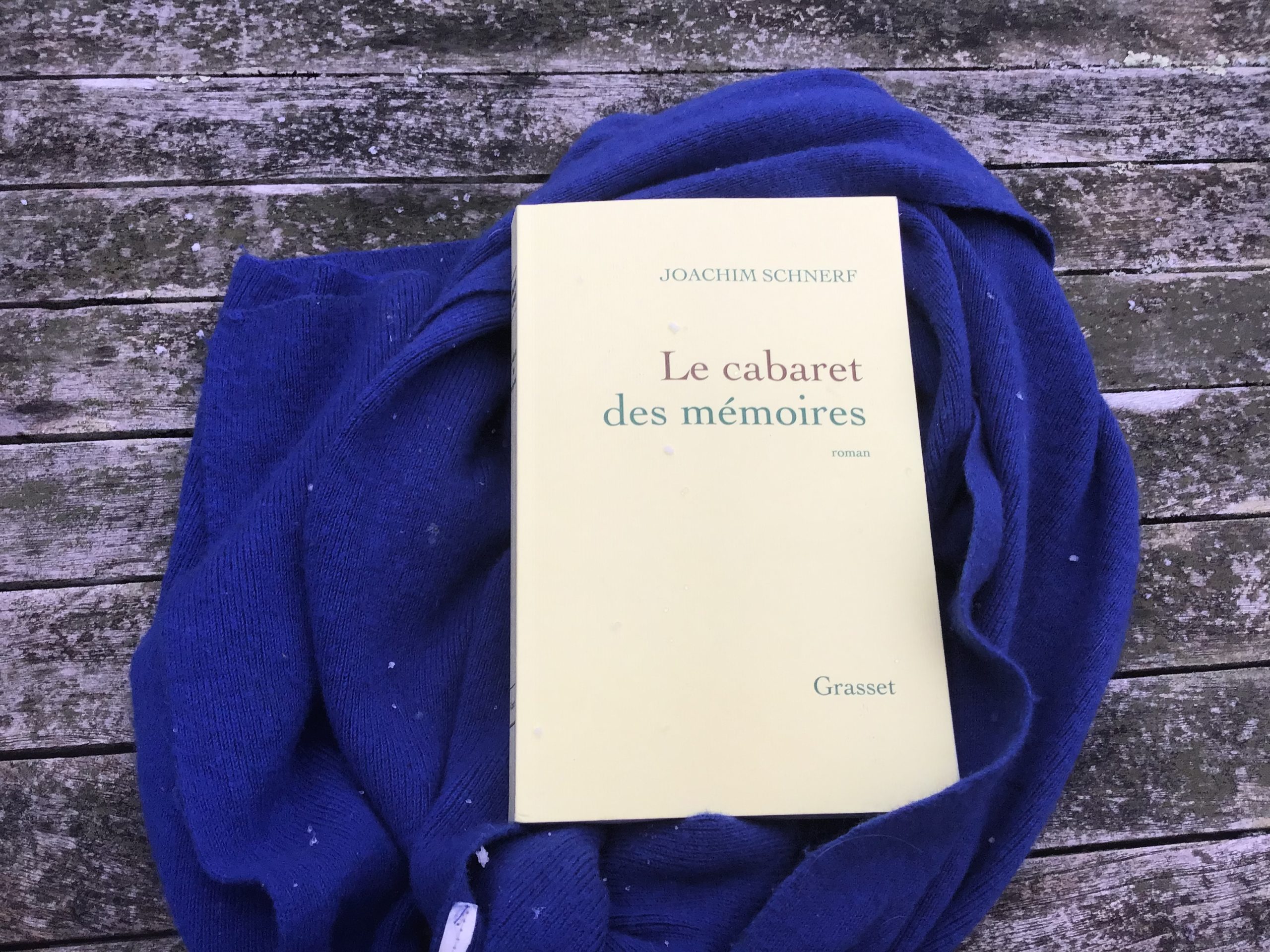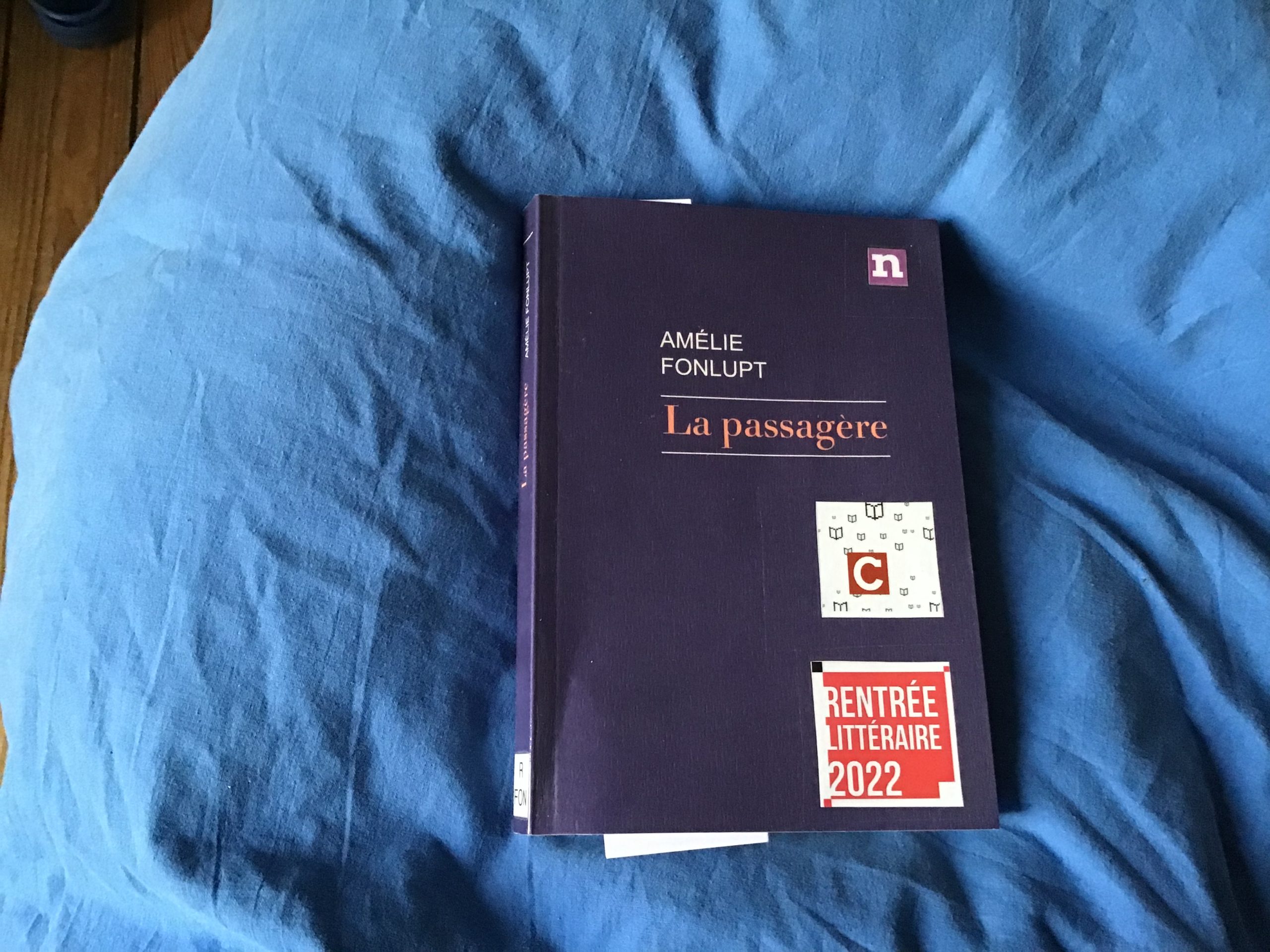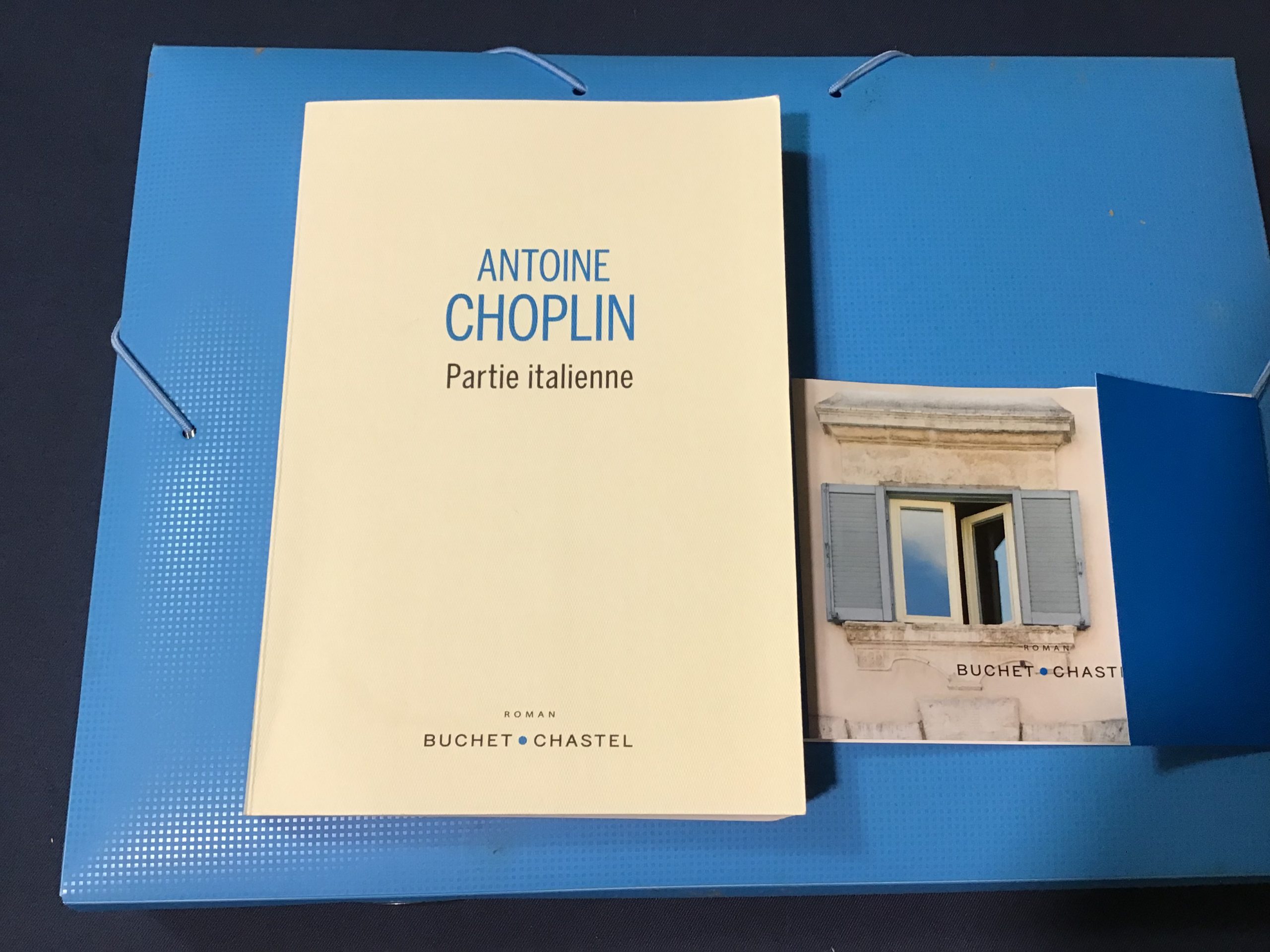Édition Liana Lévi Traduit du russe (Ukraine par Paul Lequesne)
Lu dans le cadre du club de lecture de la médiathèque de Dinard
 Kourkov devient un habitué de Luocine, il faut dire que l’Ukraine occupe beaucoup nos esprits en ce moment. Après le Pingouin et Les abeilles grises, voici donc ce roman dont l’auteur nous annonce qu’il aura une suite.
Kourkov devient un habitué de Luocine, il faut dire que l’Ukraine occupe beaucoup nos esprits en ce moment. Après le Pingouin et Les abeilles grises, voici donc ce roman dont l’auteur nous annonce qu’il aura une suite.
Je ne sais pas si le point de départ est véridique, mais c’est possible, Kourkov aurait eu entre les mains les archives de la Tcheka durant la période de la guerre civile en 1919. Et il dit lui-même qu’il devient un spécialiste de cette époque. À partir des documents de la police politique de l’époque, il va créer un roman dont le personnage principal sera un jeune lycéen qui a vu son père tuer d’un coup de sabre de cosaque. Lui-même aura l’oreille tranchée. En 1919 à Kiev dans un quartier que nous arpentons dans tous les sens, la population est soumise à des forces armées violentes et très hostiles. L’armée rouge, par deux fois a été repoussée d’Ukraine mais elle est en train de s’imposer. Il y a aussi l’armée resté fidèle à l’ancien régime et qui voudrait chasser les bolchéviques. Et comme souvent, quand il n’y a plus d’état pour protéger les populations, des forces venant d’un peu partout essaie de prendre part au conflit. Et au milieu de tout cela, la population qui voudrait tout simplement survivre. Le roman suit le jeune Samson qui va être enrôlé dans la milice. Il va se charger de découvrir les responsables des vols en particulier de l’argenterie et cela mettra sa vie en danger. Finalement, il réussit à comprendre les raisons de ce trafic. C’est assez bizarre de voir ce jeune homme à l’oreille coupée, dans un pays où tout le monde se tire dessus sans raison, vouloir absolument découvrir les dessous d’un trafic et mener une enquête policière assez classique. J’ai oublié un détail : l’oreille ! Il met son oreille coupée dans une boîte et celle-ci continue à entendre ce qui se passe autour d’elle : un peu de fantaisie macabre à la façon de Kourkov, comme dans « Le pingouin ». Et puis, c’est bien connu, dans les pays où la police politique est toute puissante « les murs ont des oreilles » ! ! Ce roman nous permet de comprendre à quel point l’Ukraine en 1919 était dans un état de chaos incroyable et à quelle point la violence était de mise dans tous les camps.
La situation était très confuse et cela rend le roman difficile à lire et moins humoristique que « le pingouin ». L’auteur annonce une suite je ne suis pas certaine de m’y confronter.
Citations
Le poids d’une arme .
De retour au commissariat Samson et Kholodny se virent remettre à chacun un Nagant, avec sangle et étui en bois, une dizaine de cartouches ainsi qu’une autorisation écrite de porter l’arme.
Samson ajusta l’étui à sa taille et sentit peser à droite, à sa ceinture un poids réconfortant. Désormais sa vie allait forcément changer. Elle change toujours quand on reçoit une arme.
Difficulté de s’y retrouver .
– Un défroqué ? Dit Tofim Sigismundovitch.– Oui, il dit avoir abjuré Dieu et vouloir combattre pour l’ordre.– Vous devriez vous méfier de lui, intervint la mère de Nadejda, la mine soucieuse. Quand un homme devient son propre contraire, il risque de se perdre entre le bien et le mal.– Tout le monde peut s’y perdre répondit son mari nous vivons à une époque où il est parfois impossible de comprendre où se trouve l’un et l’autre. Tiens, par exemple je sais déjà que les petliouristes sont un mal, mais concernant le hetman, je serai incapable de le dire. Et les denikinistes ? S’ils arrivent à Kiev, sera-ce un bien ou un mal ?
La présence de la mort.
Sur quoi il entra dans le commissariat de pas résolu. Un moment plus tard deux coups de feu éclataient à l’intérieur.Samson courut dans le bâtiment. Passetchny remonta déjà de la salle de détention, Mauser toujours au poing. Derrière lui, un bourdonnement de voix et des gémissements.» Comme ça, ils se tiendront tranquilles, dit-il en se dirigeant vers la porte d’entrée restée grande ouverte. Comme ça, ils auront un cadavre sous les yeux pour leur rappeler que chez nous la mort est bon marché, bien meilleur marché que la vie. »
La guerre civile.
Le détenu abattu par le milicien était toujours étendu au milieu de la chaussée devant le commissariat. Et personne n’avait l’intention ni d’aller le ramasser, ni de le pousser au bord de la voie. Parce que les cadavres devaient être enlevés par le pouvoir. Or cette nuit-là le pouvoir se battait pour sa survie. Il était occupé à semer les cadavres, non à les récolter. La moitié des mort appartenaient au pouvoir, la moitié du pouvoir gisait mort.