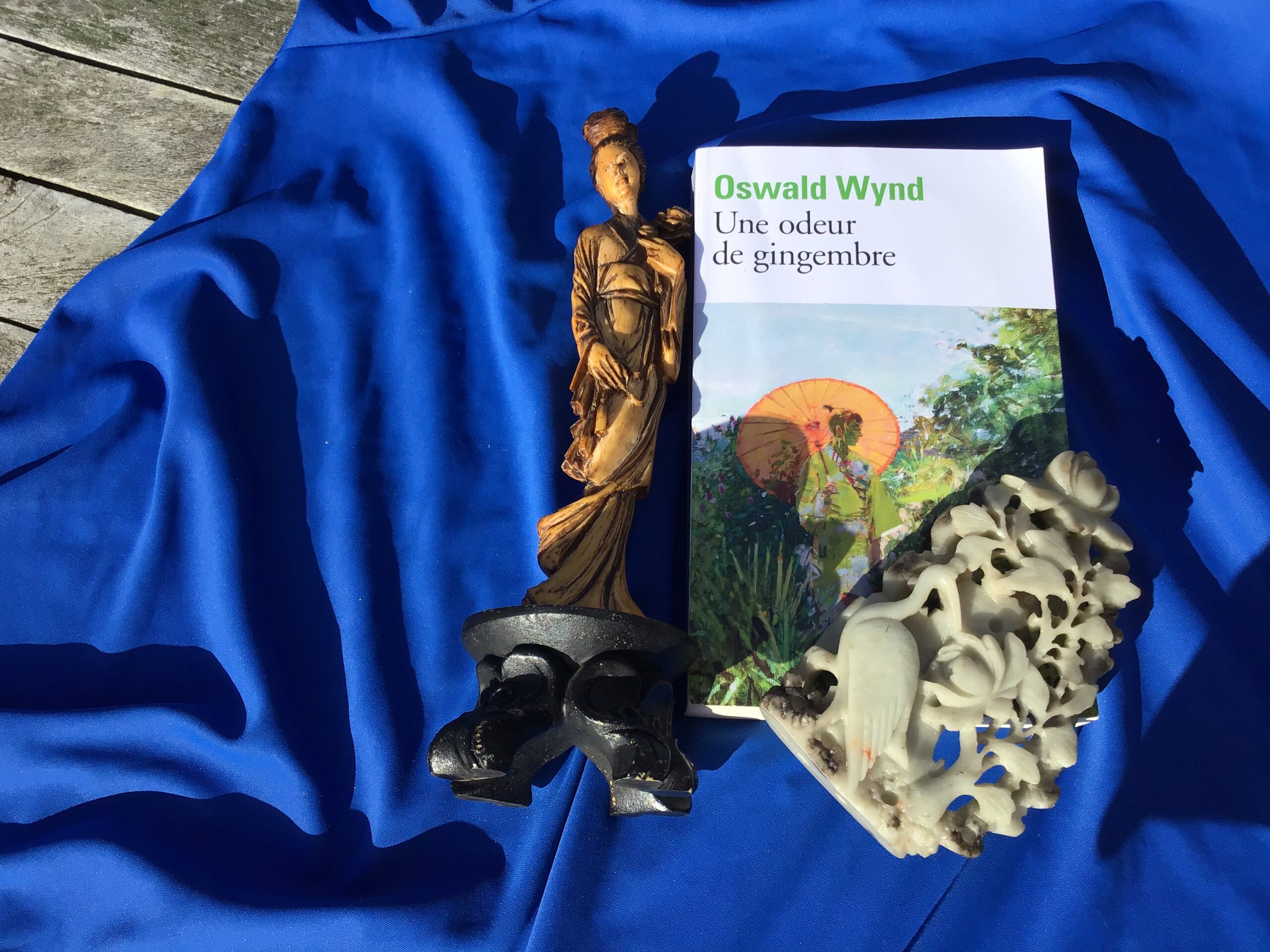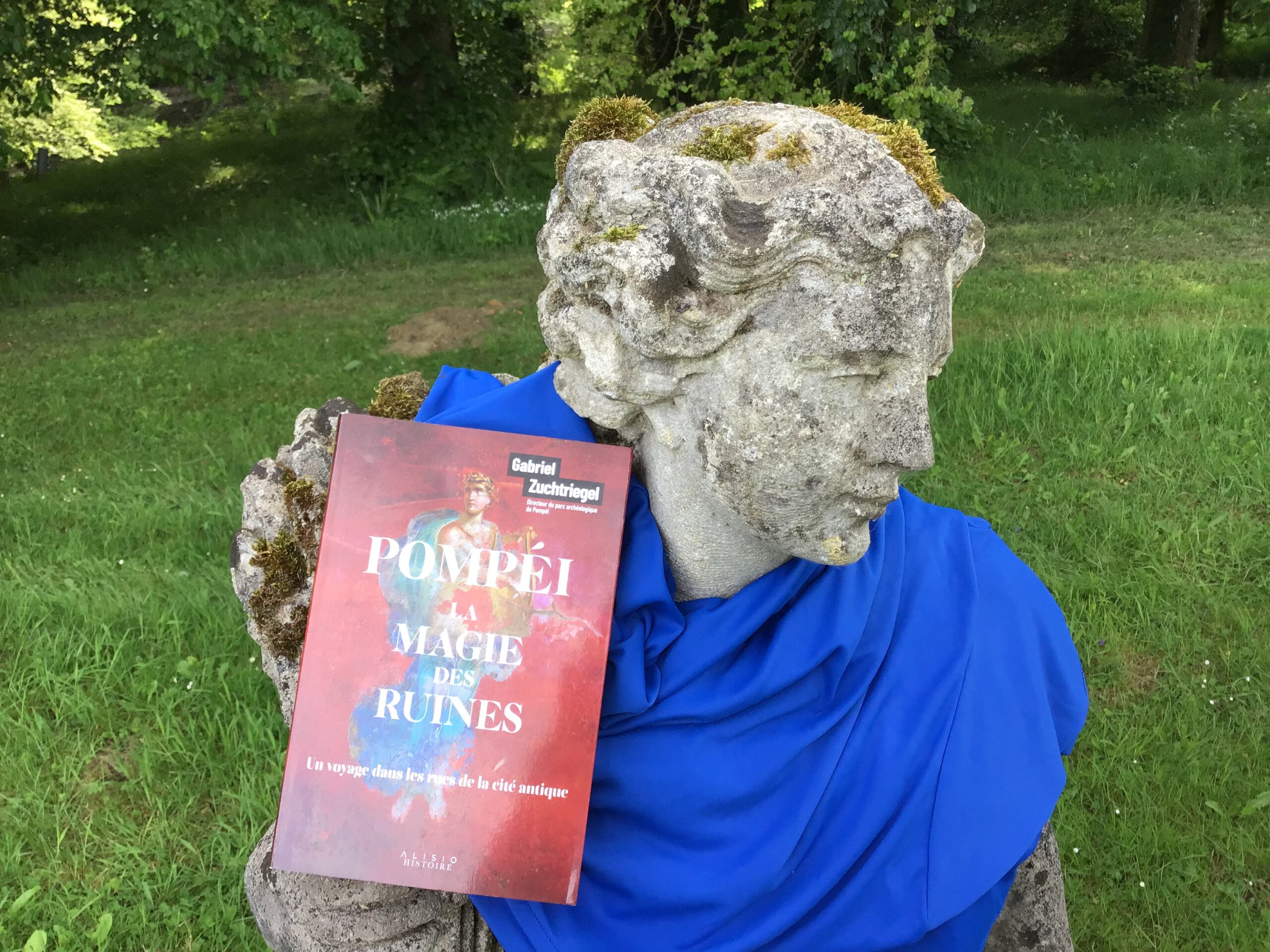Éditions Le Tripode, 172 pages et 65 chapitres, mars 2025
 C’est encore Keisha qui m’a signalé ce roman après m’avoir fait découvert « Parfois l’homme« . Surtout, laissez vous tenter à votre tour, et si vos bibliothèques ou autres médiathèques ne l’ont pas encore, expliquez à quel point ce livre plaira à un public très large. Je suis ravie de commencer l’année 2026 avec ce coup de cœur.
C’est encore Keisha qui m’a signalé ce roman après m’avoir fait découvert « Parfois l’homme« . Surtout, laissez vous tenter à votre tour, et si vos bibliothèques ou autres médiathèques ne l’ont pas encore, expliquez à quel point ce livre plaira à un public très large. Je suis ravie de commencer l’année 2026 avec ce coup de cœur.
Une personne a tout quitté pour en retrouver une autre dans 11 heures et 37 minutes. C’est l’espoir d’une très forte histoire d’amour avec une fin comme dans les films, un baiser final annonçant une scène plus érotique. Oui, mais … Vous aimeriez, sans doute, savoir si la personne qui est dans sa voiture est un homme ou une femme, mais je ne peux pas car l’auteur a décidé de ne vous laisser aucune indication. Cela permet parfois de penser que c’est une femme, celle qui a une bombe lacrymogène dans son sac, et puis un homme qui choisit si mal sa nourriture au restaurant de l’autoroute.
Pendant ce trajet si long, l’auteur observe tous les petits détails de nos trajets sur les autoroutes, sur nos voitures, sur la conduite la nôtre et celle des autres : lisez le chapitre 19 « Accélérer ». Mais nous avançons aussi sur l’histoire personnelle de la personne qui conduit , il nous fait partager ses digressions qui parfois, quand elle est fatiguée, sont quelque peu délirantes. Dans les 65 courts chapitres, Sébastien Bailly, passe de l’humour, à des observations très justes à des moments plus profonds.
J’ai recopié beaucoup de passages, car cela m’aide à mieux me souvenir du talent de cet auteur, mais je ne voudrais pas gâcher votre rencontre personnelle avec ce roman, donc vous pouvez ne les lire qu’après votre propre lecture.
Extraits.
Début
1 Partir
Tu as dû partir. La route est longue : douze heures au moins. Une journée classée noire ? Il a fallu que tu te lèves, tôt. Devant toi un parcours que tu n’as pas eu besoin de planifier. Parce que, parfois l’autre est une machine. Tu lui as indiqué l’adresse de destination, la voix t’a répondu : vous arriverez dans 11 heures et 37 minutes. Plus qu’à te laisser guider.
Sortie de ville.
Du centre-ville à la périphérie, tu es toujours dans la ville. Les immeubles cossus font place aux HLM, les HLM aux pavillons, les pavillons aux hangars des zones commerciales, aux restaurants de spécialités improbables, aux vendeurs de moquettes et de canapés, aux entrepôts de carrelage, aux ateliers et aux usines, les panneaux publicitaires continuent de boucher le paysage et quand tu vois un bout de forêt, ce sont d’abord trois arbres au milieu d’un rond-point, puis un bosquet qui cache une excroissance de zone d’activité, une pépinière de startup, une usine pétrochimique, une friche mi-béton mi-ronce..
La ville s’efface, elle ne disparaît pas d’un coup.
Il m’a fait rire : les autocollants sur les voiture.
Les plus expansifs ont collé en haut de leur vitre arrière, un parasoleil dont l’efficacité reste à prouver, mais qui permet deux ou trois mots explicites en l’honneur d’une équipe de football, d’un club de karaté, ou de philatélie. C’est vert bouteille, ou d’une transparence bleutée un peu sale.
Les propriétaires ont donc cru un jour que leur opinion importait qu’ils feraient ainsi progresser leurs idées. Et ils t’expliqueraient qu’ils ont bien raison, puisque c’est ainsi qu’ils ont sympathisé avec leurs voisins de camping, il y a quinze ans. Lui aussi, était outré par la chasse à la baleine. Ils se retrouvent depuis chaque mois d’août, côte à côte, vieillissants mais fidèles, leurs tentes dernier cri tournées l’une vers l’autre.Et les baleines ? Décimées.On ne peut pas gagner sur tous les tableaux.
Les veilles de rentrée.
Tu te souviens de la veille de la rentrée des classes, il t’était souvent impossible de trouver le sommeil. Tu te répétais en boucle les évènements probables du lendemain une centaine de fois explorant toutes les options mêmes les plus improbables, et tu t’endormais sur l’hypothèse d’un tremblement de terre qui empêcherait l’ouverture de l’école.
Tellement vrai.
L’habitacle a abrité des débats politiques et des enfants ont demandé si c’était encore, loin. On va toujours trop loin. Et c’est toujours trop long.Il avait fallu s’arrêter en urgence pour les pauses pipi qui ne pouvaient attendre, et se ranger trop tard, sur le bas-côté, pour des envies de vomir arrivées trop vite.
Humour.
Sur l’autoroute uniforme, ces spécialités marquent l’appartenance locale. On apprend d’une région qu’elle est productrice de moutarde, de bonbons acidulés, de saucisson de cheval, mais c’est plus rare.
Cela aussi, c’est vrai.
Les voitures sont si sophistiquées maintenant qu’un voyant s’allume à la moindre défaillance. À quand le voyant qui clignote pour dénoncer les voyants qui ne s’allument pas ? Et le voyant qui s’allume pour dénoncer le voyant qui ne clignote pas pour dénoncer les voyants qui ne s’allument pas alors qu’ils le devraient ? Et celui qui …
La boîte à gants.
La boîte à gants… C’est bien un endroit où tu as stocké tous les objets inimaginables sauf des gants.
Bon à savoir…
Rien n’interdit à une personne majeure de quitter le domicile conjugal sans explication. Rien n’interdit de disparaître.Je cite pour que tu suives, et que tu saches ce qui t’attend : sur décision d’un juge, il est possible d’obtenir une présomption d’absence et dix ans plus tard, une déclaration d’absence. Elle importe les mêmes effets qu’un décès : le patrimoine est légué. Le conjoint de l’absent peut contracter un nouveau mariage.En d’autres termes, tu as dix ans devant toi pour changer d’avis. Comme quoi, on a toujours le choix de ce qu’on vit.
Le chapitre 50 m’a beaucoup touchée.
Comme tout le monde. On espère. On a entendu dire qu’il était possible que tout se passe bien, que tout se passe au mieux, jusqu’à ce que la mort nous sépare. Tu parles. Quand la mort nous sépare elle n’a généralement pas un grand effort a fournir. Voilà un moment que le travail a été fait : le temps, le temps est bien plus efficace que la mort.Gratte un peu le vernis des couples irréprochables. Tu verras ce qu’il reste de brillant. Pas grand-chose, et les crevasses de la peinture séchée trop vite, les pigments effacés par la lumière, les coulures des bleus qui se dissolvent révèlent une autre version que la façade, longtemps présentée sans défaut. Et si tout semble avoir gardé l’éclat du premier jour le châssis joue, la toile est voilée, comme une roue de bicyclette après l’ornière. On ne sauve que les apparences de loin.L’autre à qui l’on a donné les clés de sa vie a tellement changé que la personne que l’on quitte, n’est pas celle qu’on a aimée, non. On ne trahit rien à bien y réfléchir. On tire une leçon, et c’est ainsi qu’on part.
La vie et le roman.
La différence entre la vie et un roman : dans le roman, tu finis toujours par te servir de ta bombe lacrymogène, sinon, pourquoi l’auteur se serait-il donné la peine d’en parler ? Dans la vie, tu finis par t’apercevoir, un jour, en nettoyant ton sac, qu’il y avait une date limite d’utilisation de la bombe, si bien que l’achat n’aura servi à rien. Et tant mieux.