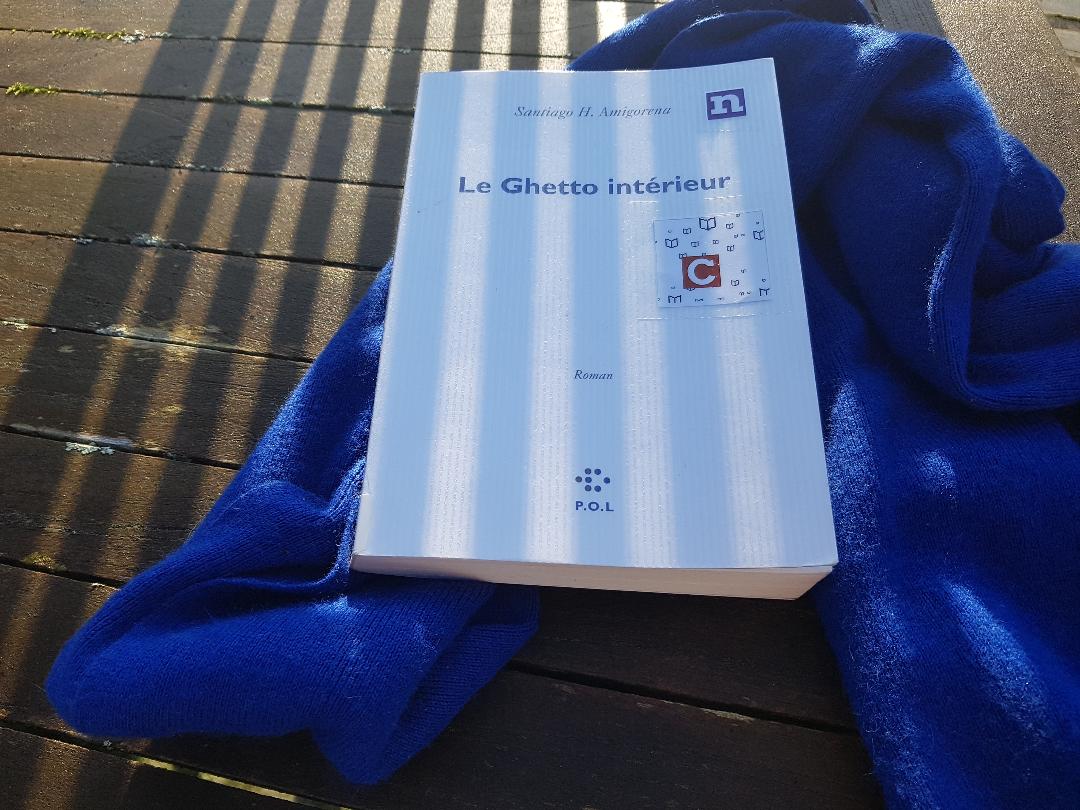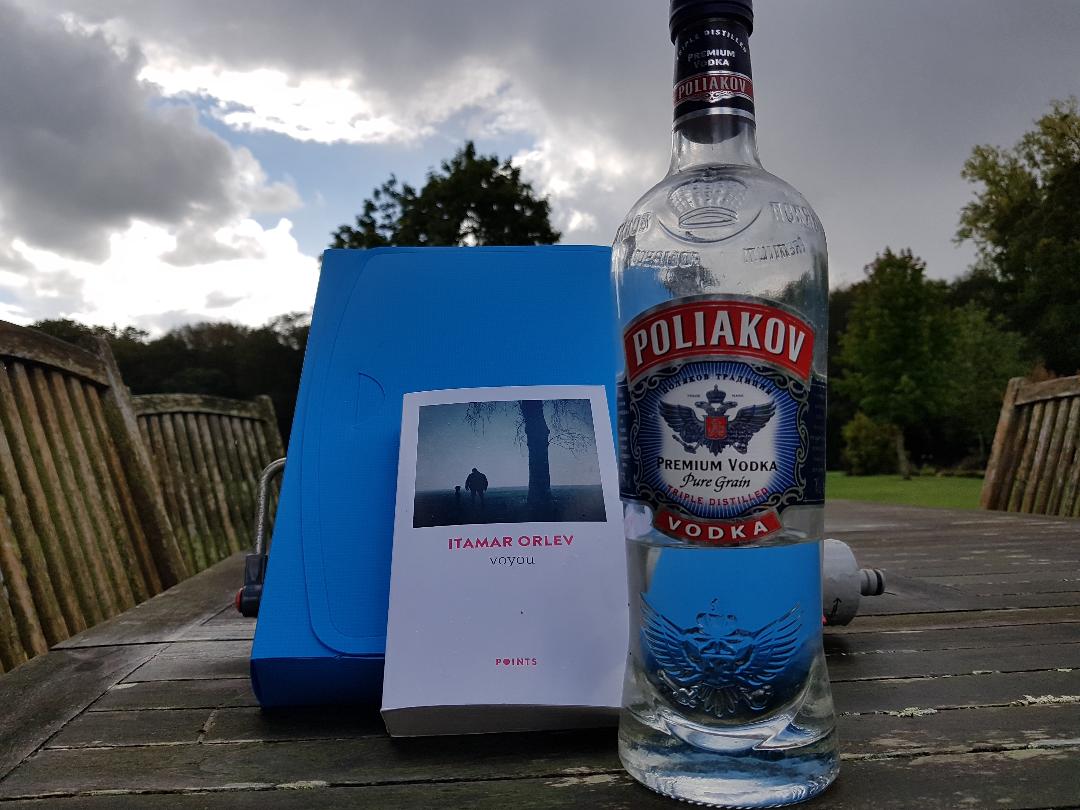
Éditions Points . Traduit de l’hébreu par Laurence Sendrowicz
 Merci à celle grâce à qui ce livre est arrivé jusqu’à moi. Il me revient donc, de vous donner envie de lire au plus vite ce roman qui ne connaît peut-être pas le succès qu’il mérite. Je vous invite à partir avec Tadek Zagourski à la rencontre de son père Stefan Zagourski. Ils ne se sont pas vus depuis plus de vingt ans, Tadek vit en Israël et Stefan croupit dans une maison de retraite à Varsovie. La femme de Tadek ne supporte plus son mari qui tente d’être écrivain et qui surtout traîne un mal-être qui le réveille toutes les nuits par des cauchemars horribles. Elle le quitte en emmenant avec elle leur fils. Seul et encore plus malheureux, Tadek se tourne vers son passé et se souvient de son père qu’il a quitté lorsqu’il avait six ans. Sa mère, son frère, ses sœurs tous les gens qui ont connu son père lui déconseille de faire ce voyage pour retrouver l’homme qui les a martyrisés pendant leur enfance. Pour les sauver de cette terrible influence, sa mère a fui en Israël car elle était juive et a pu empêcher son père de les rejoindre car lui ne l’était pas . Ce retour vers cet homme violent qui est devenu un petit vieux très diminué complètement imbibé de Vodka nous vaut une description impitoyable de la Pologne de 1988, encore sous le joug soviétique, et une plongée dans la guerre 39/45 avec l’évocation du sort réservés aux juifs polonais et des violences entre les différentes factions des partisans. Son père est un héros de cette guerre, il a subi pendant six mois les tortures de la gestapo à Lublin sans trahir aucun de ses amis, puis sera interné au camp de Majdanek dont il s’évadera, ensuite il sera utilisé comme liquidateurs des collaborateurs polonais. Pour tuer un homme ou une femme de sang froid il lui faudra boire au moins une bouteille de vodka par jour. Après la guerre, il restera quelqu’un de violent et fera peur à tout le voisinage, il s’en prendra hélas à sa femme et à ses enfants toujours quand il était sous l’emprise de cette satanée vodka, enfin plus que d’habitude. Tadek va rechercher quels liens unissaient ce père à ses enfants pour retrouver le sens de sa propre paternité. Cet aspect du roman est bouleversant : comment un enfant quelles que soient les violences qu’il a vécues recherche toujours le lien qui l’unissait à un père même imbibé d’alcool dès le matin – car c’est ce que Stefan boit au petit déjeuner à la place du café. Dans cette relation amour/haine, Tadek doit petit à petit faire son chemin et obliger son père à dévoiler tous les côtés les plus noirs de son passé aussi bien sur le plan de la violence que sur le plan sentimental.
Merci à celle grâce à qui ce livre est arrivé jusqu’à moi. Il me revient donc, de vous donner envie de lire au plus vite ce roman qui ne connaît peut-être pas le succès qu’il mérite. Je vous invite à partir avec Tadek Zagourski à la rencontre de son père Stefan Zagourski. Ils ne se sont pas vus depuis plus de vingt ans, Tadek vit en Israël et Stefan croupit dans une maison de retraite à Varsovie. La femme de Tadek ne supporte plus son mari qui tente d’être écrivain et qui surtout traîne un mal-être qui le réveille toutes les nuits par des cauchemars horribles. Elle le quitte en emmenant avec elle leur fils. Seul et encore plus malheureux, Tadek se tourne vers son passé et se souvient de son père qu’il a quitté lorsqu’il avait six ans. Sa mère, son frère, ses sœurs tous les gens qui ont connu son père lui déconseille de faire ce voyage pour retrouver l’homme qui les a martyrisés pendant leur enfance. Pour les sauver de cette terrible influence, sa mère a fui en Israël car elle était juive et a pu empêcher son père de les rejoindre car lui ne l’était pas . Ce retour vers cet homme violent qui est devenu un petit vieux très diminué complètement imbibé de Vodka nous vaut une description impitoyable de la Pologne de 1988, encore sous le joug soviétique, et une plongée dans la guerre 39/45 avec l’évocation du sort réservés aux juifs polonais et des violences entre les différentes factions des partisans. Son père est un héros de cette guerre, il a subi pendant six mois les tortures de la gestapo à Lublin sans trahir aucun de ses amis, puis sera interné au camp de Majdanek dont il s’évadera, ensuite il sera utilisé comme liquidateurs des collaborateurs polonais. Pour tuer un homme ou une femme de sang froid il lui faudra boire au moins une bouteille de vodka par jour. Après la guerre, il restera quelqu’un de violent et fera peur à tout le voisinage, il s’en prendra hélas à sa femme et à ses enfants toujours quand il était sous l’emprise de cette satanée vodka, enfin plus que d’habitude. Tadek va rechercher quels liens unissaient ce père à ses enfants pour retrouver le sens de sa propre paternité. Cet aspect du roman est bouleversant : comment un enfant quelles que soient les violences qu’il a vécues recherche toujours le lien qui l’unissait à un père même imbibé d’alcool dès le matin – car c’est ce que Stefan boit au petit déjeuner à la place du café. Dans cette relation amour/haine, Tadek doit petit à petit faire son chemin et obliger son père à dévoiler tous les côtés les plus noirs de son passé aussi bien sur le plan de la violence que sur le plan sentimental.
C’est un sacré voyage que je vous propose mais je suis certaine que vous ne pourrez pas laisser ces deux personnages avant d’avoir refermer le livre et que vous découvrirez encore tant de choses que je ne vous ai pas dites. Vous irez de beuverie en beuverie, mais, comment voulez vous arrêter de boire dans pays si catholique où, à chaque fois que l’on boit, on vous dit : « soyez béni : Na zdrowie » ! ! ?
Encore une remarque, l’auteur nous promène dans le temps et dans l’espace en Israël, aujourd’hui en Pologne en 1988 , 1970 et 1940, mais cela ne rend pas la lecture difficile, on passe sans difficulté d’un moment ou d’un lieu à l’autre car on suit la reconstruction de Tadek et on espère qu’il arrivera un jour à dormir sans être réveillé par ces horribles cauchemars dont son père portent une grande part de responsabilité.
Citations
Genre de dialogues que j’adore : nous sommes en Israël la femme de Tadek va le quitter
Elle a dit. J’en ai marre de cette vie de chien, je me crève le cul pour le gosse et pour toi, alors que toi, tu n’es ni un mari, ni un père. Tu nous enfermes dans ton rêve bancal et tu t’apitoies sur ton sort à longueur de journée.
– Tout de même, je fais la vaisselle, ai-je bredouillé pour ma défense. Et je m’occupe du jardin.
– C’est quand, la dernière fois que tu t’es occupé du jardin ? On dirait un dépotoir.
– Ce n’est pas la saison. J’attends le printemps.
– Et l’évier aussi, il attend le printemps ?
– Non, la nuit. Je fais la vaisselle la nuit.
– D’accord. Fais la vaisselle la nuit, attends printemps. Sauf qu’à partir d’aujourd’hui, tu feras ça tout seul. Je refuse de porter à bout de bras un parasite qui glande et se laisse aller. Qui ne fait que rester assis à fumer, à boire et à accuser la terre entière de son impuissance.
La Pologne après la guerre
C’est là-bas qu’on les a regroupés. Tous les Juifs de la région. On les a obligés à creuser un grand trou, et ensuite on leur a tiré dessus et on les a enterrés dedans. Mais pendant trois jours, la terre a continué à bouger. Tu comprends ? Et elle continue à bouger encore aujourd’hui. Je l’ai vu de mes propres yeux. Si tu t’approches trop, ils peuvent t’attraper par la jambe et t’entraîner au fond.
Sa mère au volant en Israël
Ma mère est une conductrice épouvantable. Elle roule trop vite et ralentit subitement sans raison. Elle est capable de changer de voie sans mettre son clignotant ni regarder dans le rétro, puis de vouloir retourner dans sa file initiale, mais en hésitant tellement qu’elle embrouille les conducteurs autour d’elle. Ou alors elle peut tout à coup dévier et rouler sur la bande d’arrêt d’urgence comme si c’était une voie normale.
Scène bien décrite d’une enfance marquée par la violence d un père
Ma mère est debout à la fenêtre de la cuisine et fume une cigarette. La vaisselle sale du dîner s’entasse dans l’évier. Ola est plongée dans un roman. Anka fait ses devoirs. Robert et moi jouons au rami. Silence. Chacun vaque à ses occupations. Soudain, dans la cage d’escalier, le bruit d’une porte qui claque, puis des pas qui montent lentement. Mon frère se crispe. Maman lance un regard inquiet vers le seuil. Anka et Ola se figent et tendent l’oreille. Moi aussi j’écoute, ces pas s’approchent et se précisent, au bout de quelques instants on comprend avec soulagement que ce n’est pas papa. On peut donc retourner à nos activités, sauf qu’on sait très bien que plus il rentrera tard, plus il sera saoule. Ne nous reste qu’à espérer qu’il le soit au point de s’écrouler en chemin ou chez un de ses amis de beuverie.
L’alcool tient une part importante du roman
Tante Nella avait un lourd passé d’alcoolique, tout comme son mari, un conducteur de train qui la frappait dès qu’il avait un coup dans le nez. À chaque fois, elle s’enfuyait et venait se réfugier dans notre appartement. Elle savait que c’était le seul endroit où il n’oserait pas la poursuivre. Au bout de quelques heures, quand il était enfin calmé, il débarquait chez nous, s’agenouillait à ses pieds et la suppliait de revenir.
En Pologne après la guerre
C’est un garçon rondouillard, blond, avec une raie sur le côté et de bonnes joues bien rouges. Il ne sort jamais seul, il est toujours accompagné par quelqu’un de sa famille, parce que dans notre quartier, un tel enfant se promenant seul, ça ressemblerait à une sardine blessée dans une mer infestée de barracudas voraces.
L’âge
L’âge, ça ne compte jamais, pour rien. Pour la baise non plus. Et encore moins pour la castagne. Ce n’est qu’une question de capacité, et tant qu’on y arrive – on le fait.
Humour polonais pendant le communisme
Qu’est-ce que tu veux ? Ici, tout le monde fait semblant de travailler, alors le gouvernement fait semblant de payer, comme ça, ça s’équilibre.
La recherche de la reconnaissance paternelle
Bien plus tard, j’ai constaté que, toute notre vie, nous cherchons à obtenir une sorte de reconnaissance de notre père mais que, pour ce que j’en ai compris – et je ne comprends sans doute pas grand-chose-, nous n’y arrivons quasiment jamais. Et peu importe que le père soit un fils de pute et un minable, on s’obstine, comme quand on était petit.
Tadek : être un homme et un père
Tel était mon rôle : être dans sa chambre en cas de besoin, m’asseoir à côté de lui sur une chaise ou m’allonger sur le tapis et m’endormir, peu importe, le principal c’était que je sois dans les environs, papa gardien, prêt à défendre le château fort qui les abritait, lui et sa mère. C’était leur droit et mon devoir, sauf que mes capacités s’étaient tellement amenuisées au fil du temps que j’ai fini par cesser d’essayer. Bien sûr, j’étais l’homme, et je le serai toujours, celui qui ouvre les bocaux quand personne n’y arrive, qui sait déboucher le lavabo, qu’on réveille à deux heures du matin pour aller voir ce que sont ces bruits en provenance de la salle de bain, de la porte d’entrée ou du jardin. Mais ce n’était pas ce que je voulais. Oui, moi, j’avais espéré être autre chose.
 Le bandeau me promettait une lecture inoubliable et un roman qui a connu un énorme succès. Même « la souris jaune » en avait dit beaucoup de bien, je dis même car il est très rare que je trouve chez elle des livres à grand succès. Je l’avais remarqué chez « Sur mes brizées« . J’ai été beaucoup plus réservée qu’elles deux. Je trouve que la première partie sur la montée du nazisme en Autriche est bien raconté mais je crois que j’ai tellement lu sur ce sujet que je deviens difficile. Il y a un aspect qui a retenu mon attention, c’est à quel point les Autrichiens ont été parfois pires que les Allemands dans le traitement des juifs. Ils n’ont pourtant été que peu jugés après la guerre pour ces faits. On comprend bien la difficulté de s’exiler, même quand l’étau antisémite se resserre, la famille que nous allons suivre a beaucoup de mal à laisser derrière elle leurs parents âgés et ils espèrent toujours au fond d’eux que cette folie va s’arrêter. Quand ils se décideront à partir au tout dernier moment, les frontières se sont refermées et les pays n’accueilleront plus les juifs. Ils passent donc un moment en Suisse dans un camp assez sinistre. Ils iront finalement dans le seul pays qui a accepté de recevoir des juifs : La République Dominicaine. C’est toute l’originalité du destin de ces juifs qui ont été accueillis dans ce pays si loin de leurs traditions autrichiennes. Dans ce gros roman l’auteure décrit avec force détails l’installation de ces intellectuels dans un kibboutz où chacun doit cultiver, élever les animaux, construire une ferme dans le seul pays qui a accepté officiellement d’accueillir jusqu’à la fin de la guerre des juifs chassés de partout. Nous voyons ces Autrichiens ou Allemands tous intellectuels de bons niveaux s’essayer aux tâches agricoles et de faire vivre un kibboutz et ensuite la difficulté de se reconstruire avec des origines marquées par la Shoa . Je ne sais pas pourquoi je n’ai pas entièrement adhéré à ce roman. Je n’avais qu’une envie le de finir sans jamais m’intéresser vraiment à ces personnages.
Le bandeau me promettait une lecture inoubliable et un roman qui a connu un énorme succès. Même « la souris jaune » en avait dit beaucoup de bien, je dis même car il est très rare que je trouve chez elle des livres à grand succès. Je l’avais remarqué chez « Sur mes brizées« . J’ai été beaucoup plus réservée qu’elles deux. Je trouve que la première partie sur la montée du nazisme en Autriche est bien raconté mais je crois que j’ai tellement lu sur ce sujet que je deviens difficile. Il y a un aspect qui a retenu mon attention, c’est à quel point les Autrichiens ont été parfois pires que les Allemands dans le traitement des juifs. Ils n’ont pourtant été que peu jugés après la guerre pour ces faits. On comprend bien la difficulté de s’exiler, même quand l’étau antisémite se resserre, la famille que nous allons suivre a beaucoup de mal à laisser derrière elle leurs parents âgés et ils espèrent toujours au fond d’eux que cette folie va s’arrêter. Quand ils se décideront à partir au tout dernier moment, les frontières se sont refermées et les pays n’accueilleront plus les juifs. Ils passent donc un moment en Suisse dans un camp assez sinistre. Ils iront finalement dans le seul pays qui a accepté de recevoir des juifs : La République Dominicaine. C’est toute l’originalité du destin de ces juifs qui ont été accueillis dans ce pays si loin de leurs traditions autrichiennes. Dans ce gros roman l’auteure décrit avec force détails l’installation de ces intellectuels dans un kibboutz où chacun doit cultiver, élever les animaux, construire une ferme dans le seul pays qui a accepté officiellement d’accueillir jusqu’à la fin de la guerre des juifs chassés de partout. Nous voyons ces Autrichiens ou Allemands tous intellectuels de bons niveaux s’essayer aux tâches agricoles et de faire vivre un kibboutz et ensuite la difficulté de se reconstruire avec des origines marquées par la Shoa . Je ne sais pas pourquoi je n’ai pas entièrement adhéré à ce roman. Je n’avais qu’une envie le de finir sans jamais m’intéresser vraiment à ces personnages.

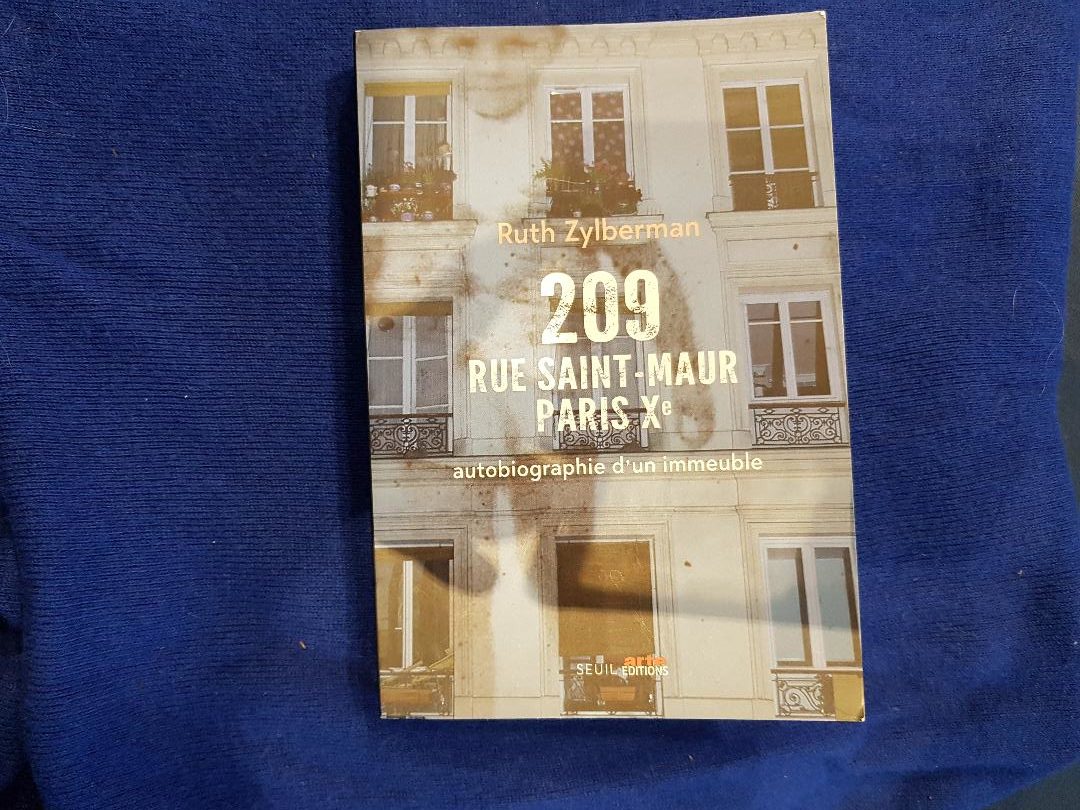

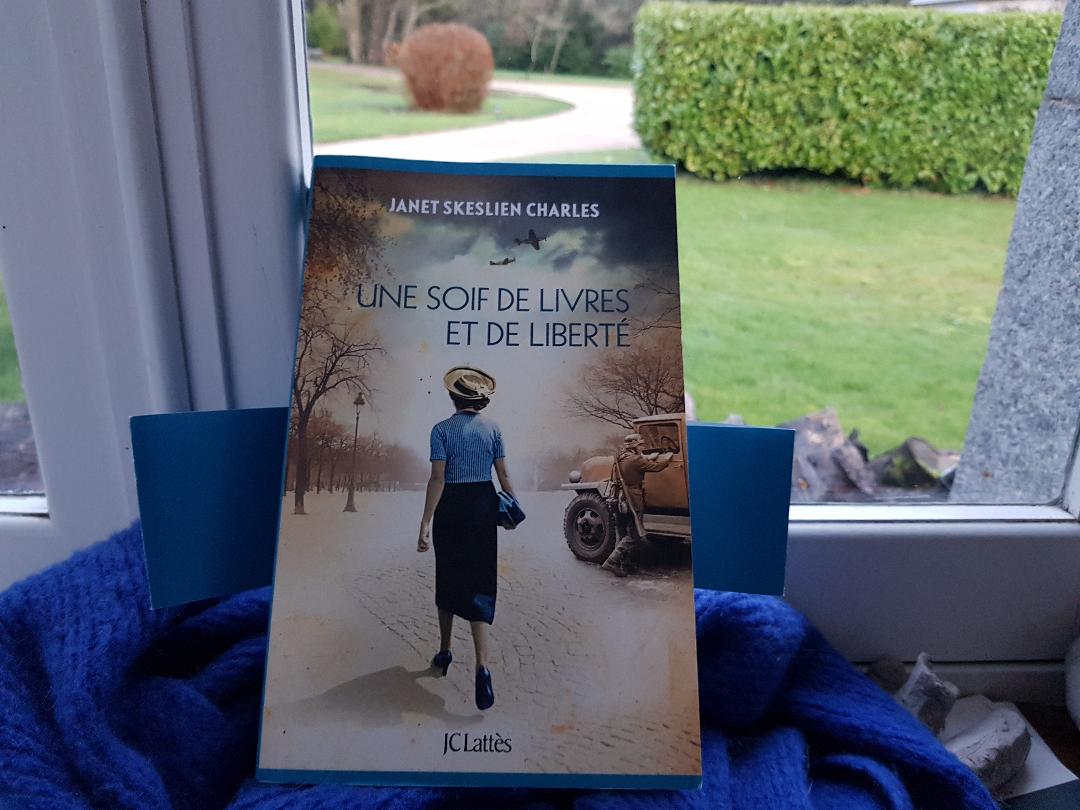
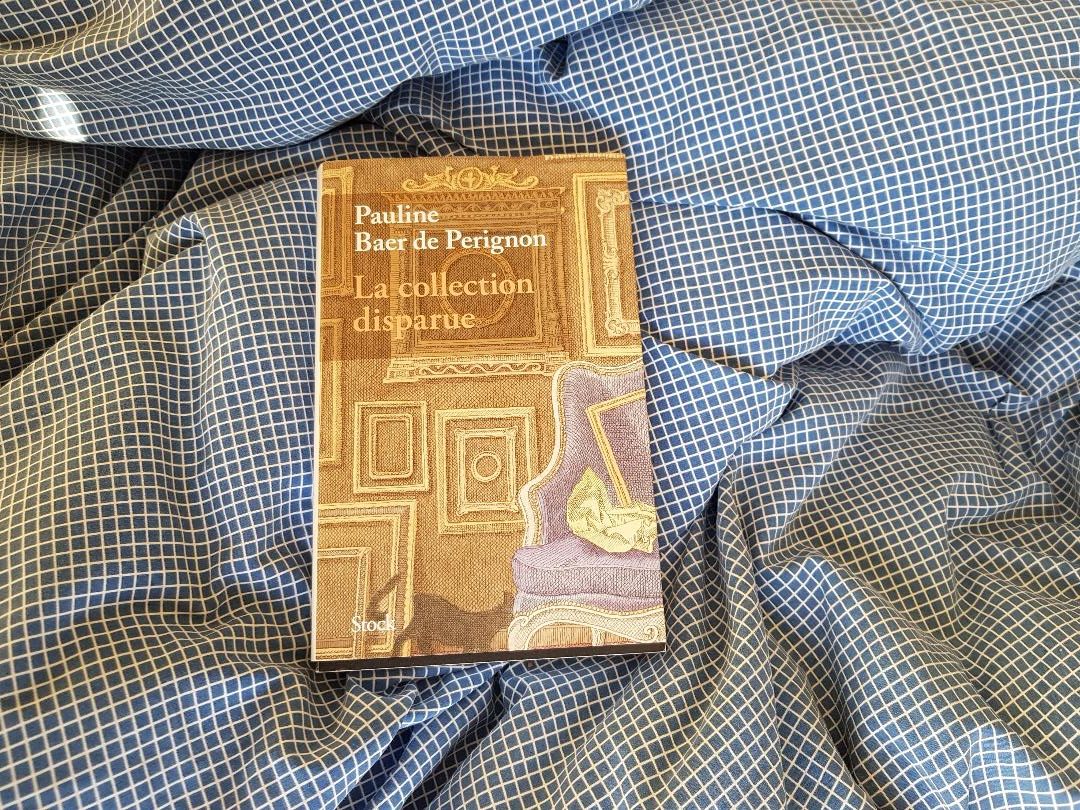


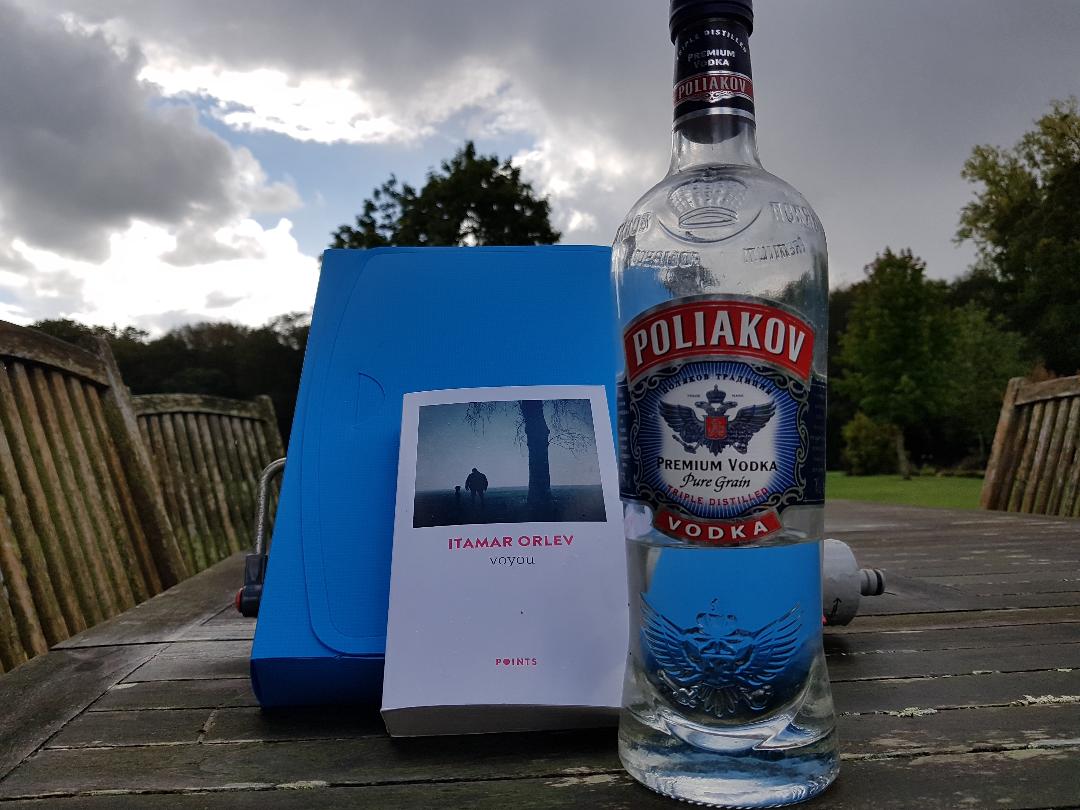
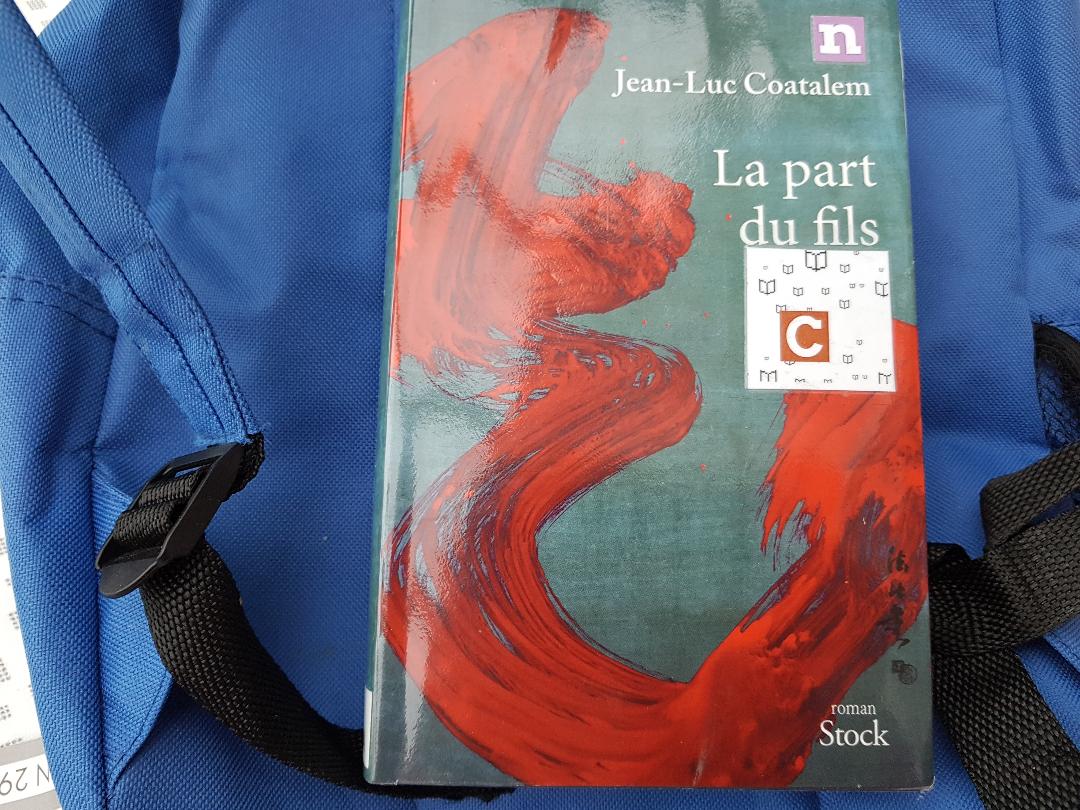
 Jo
Jo