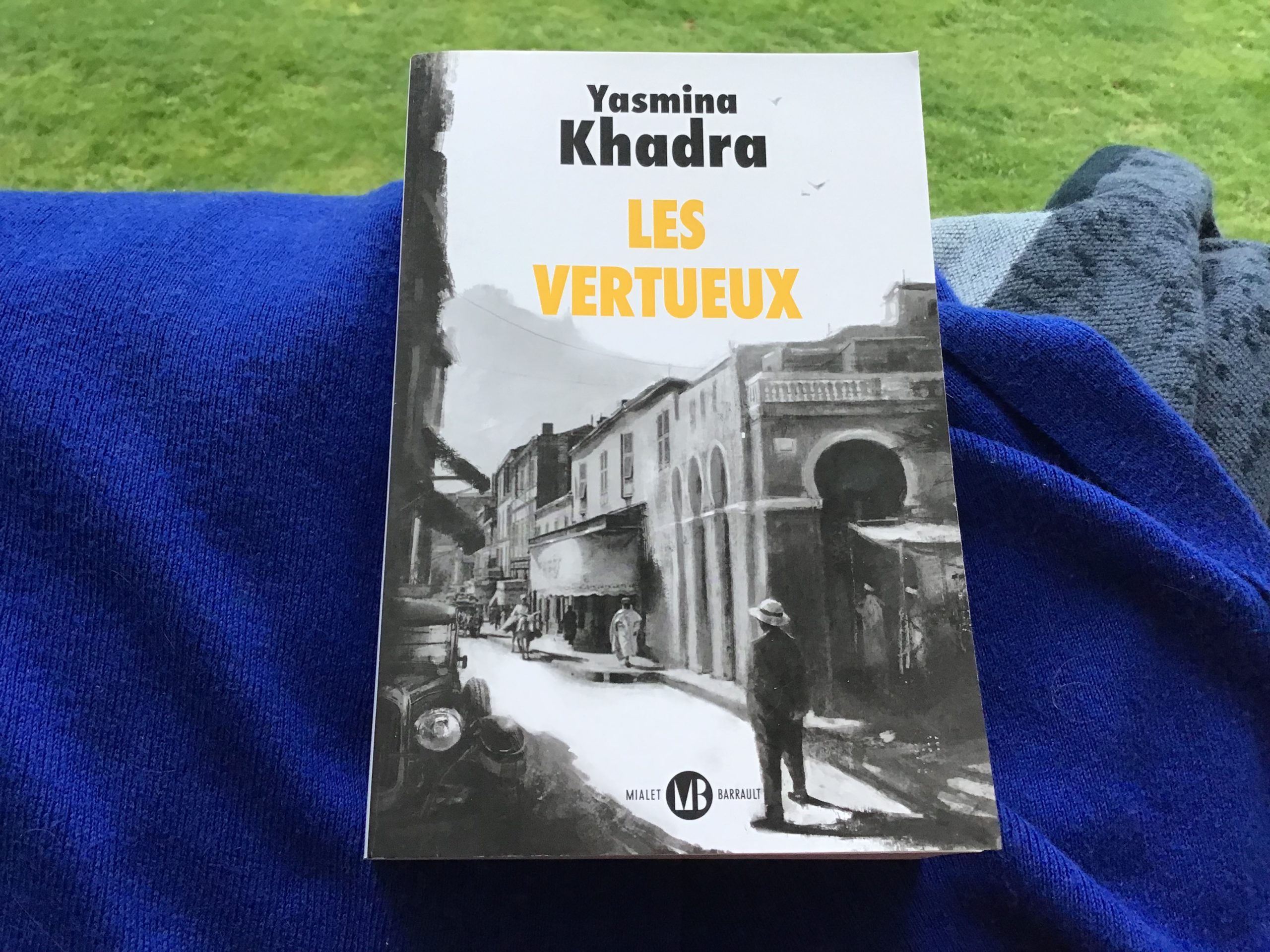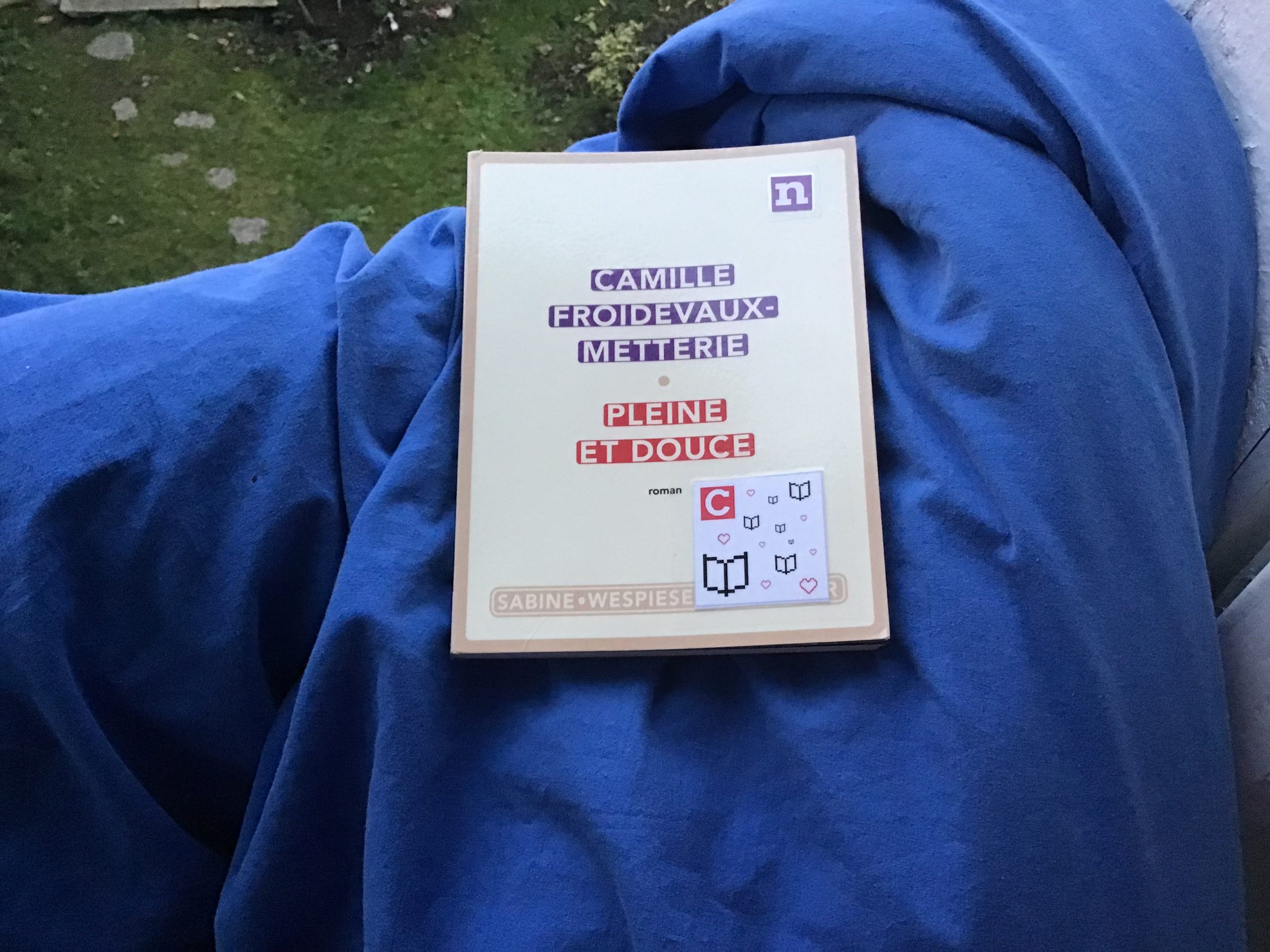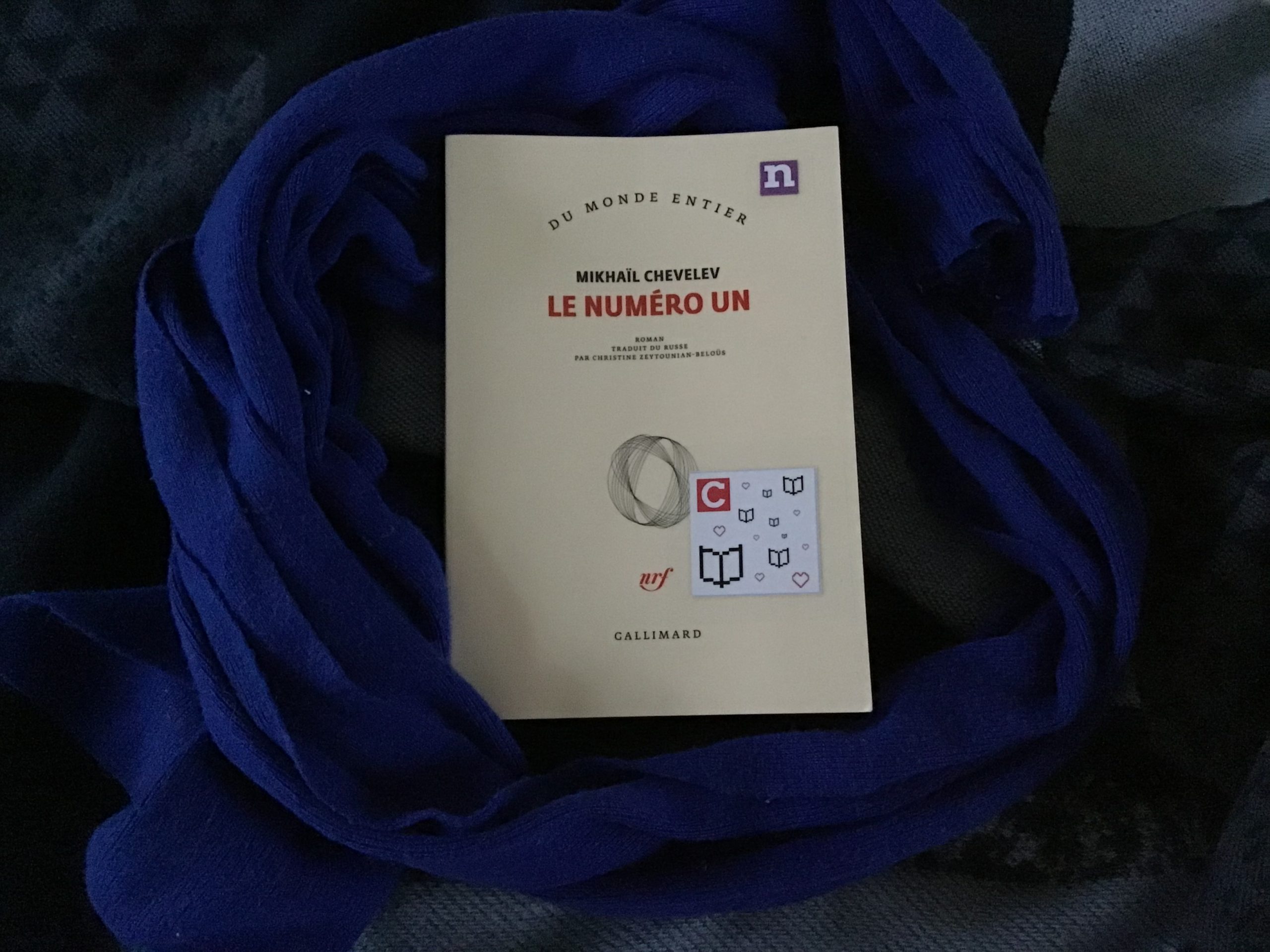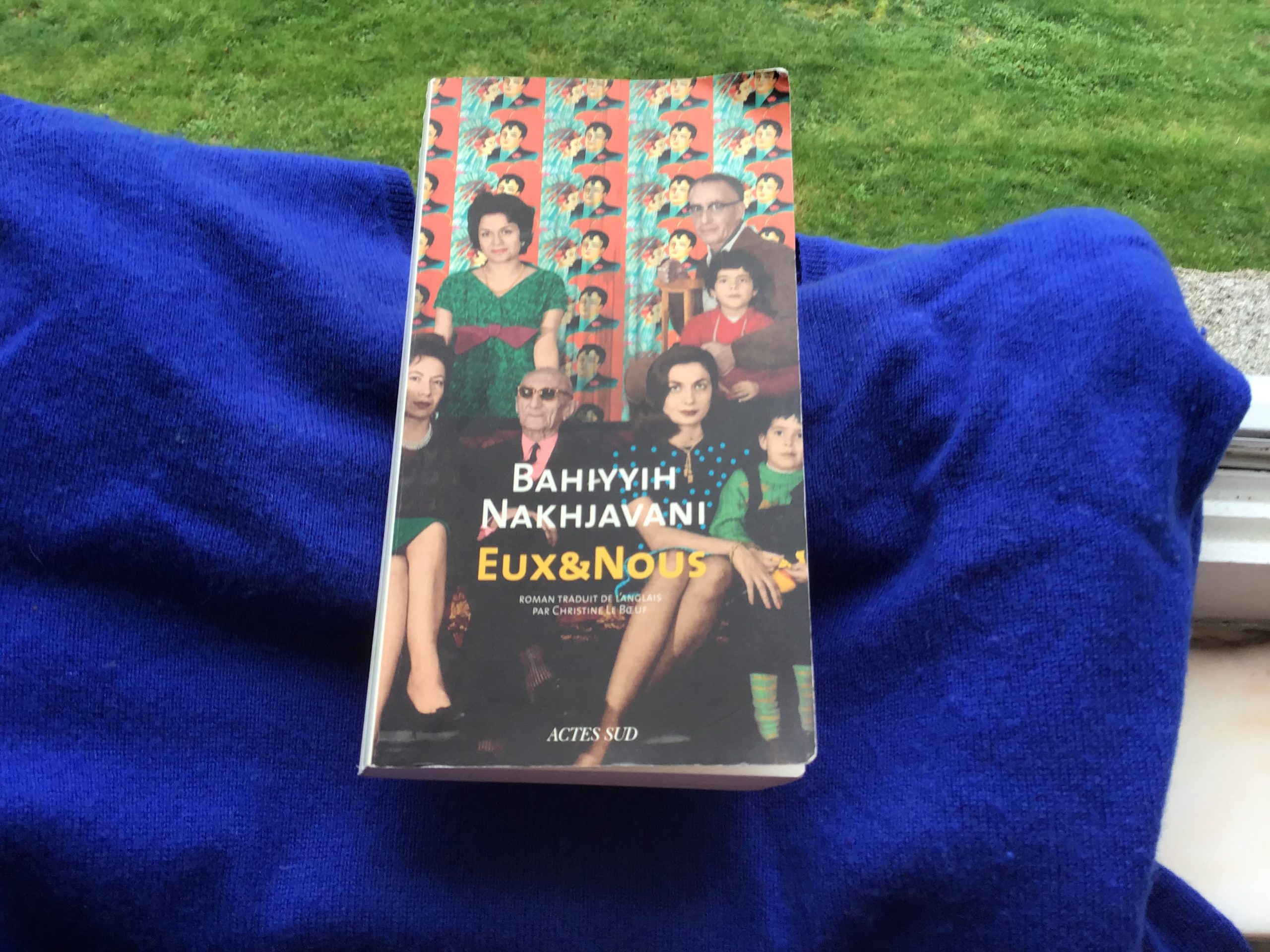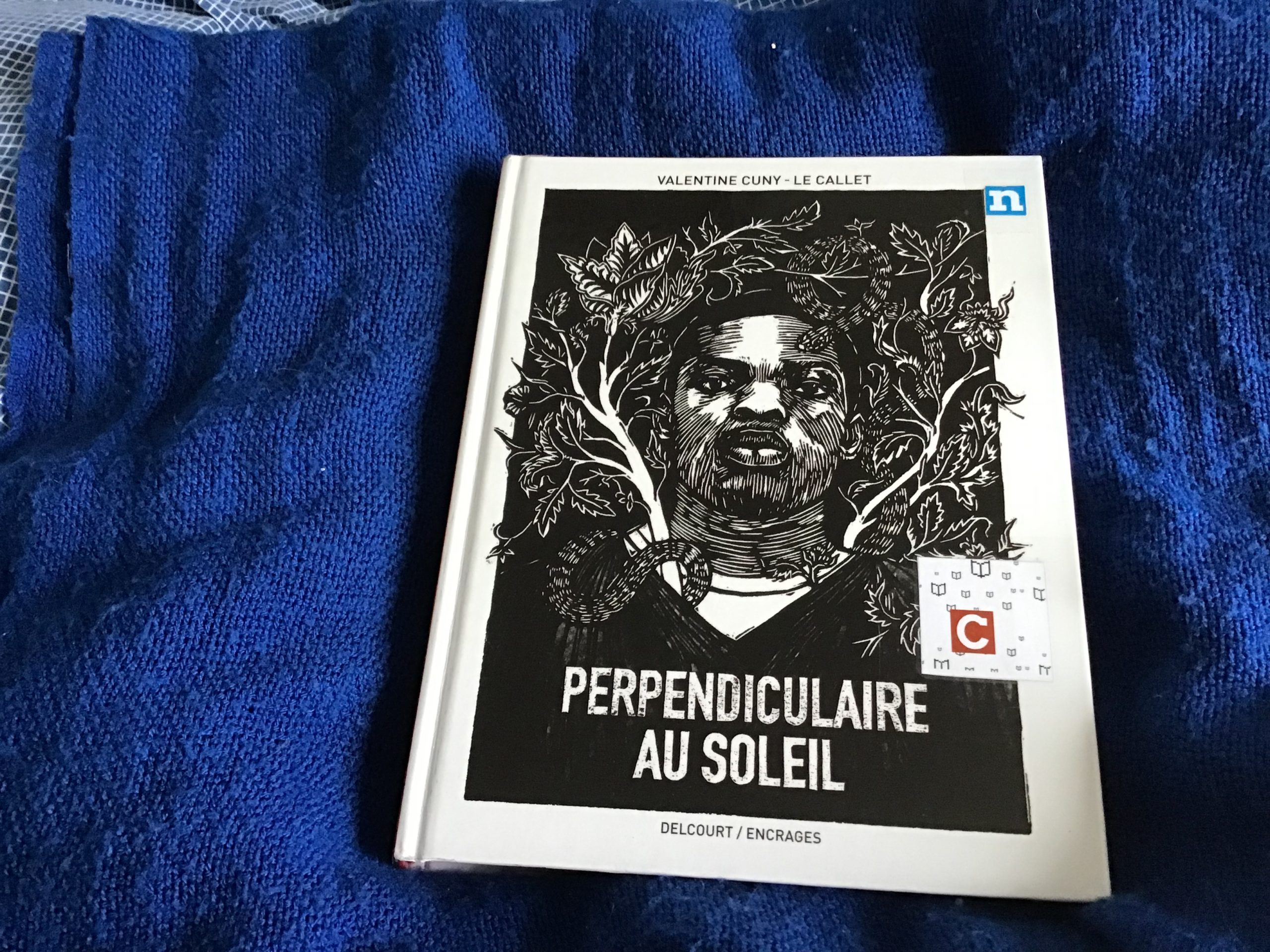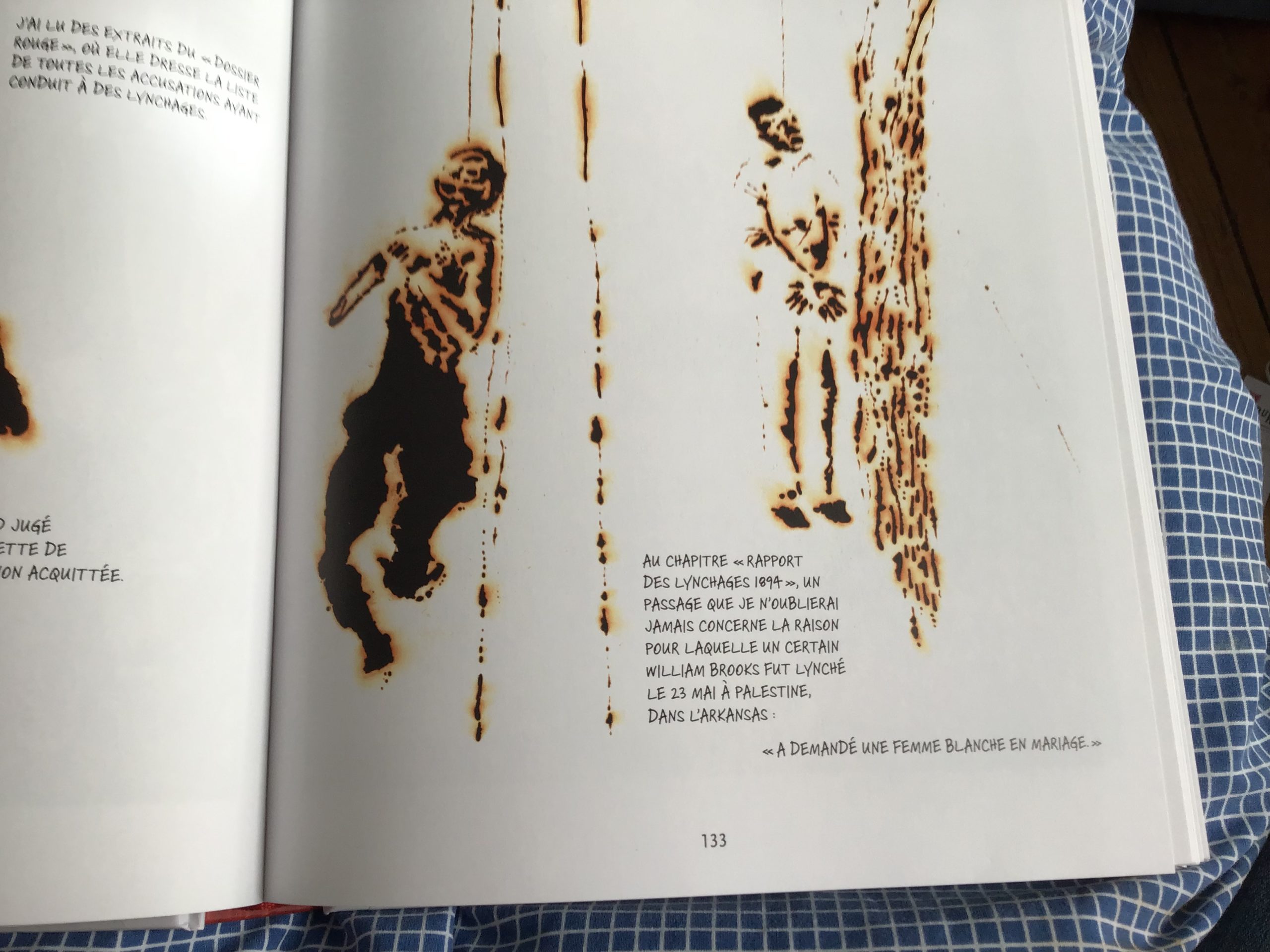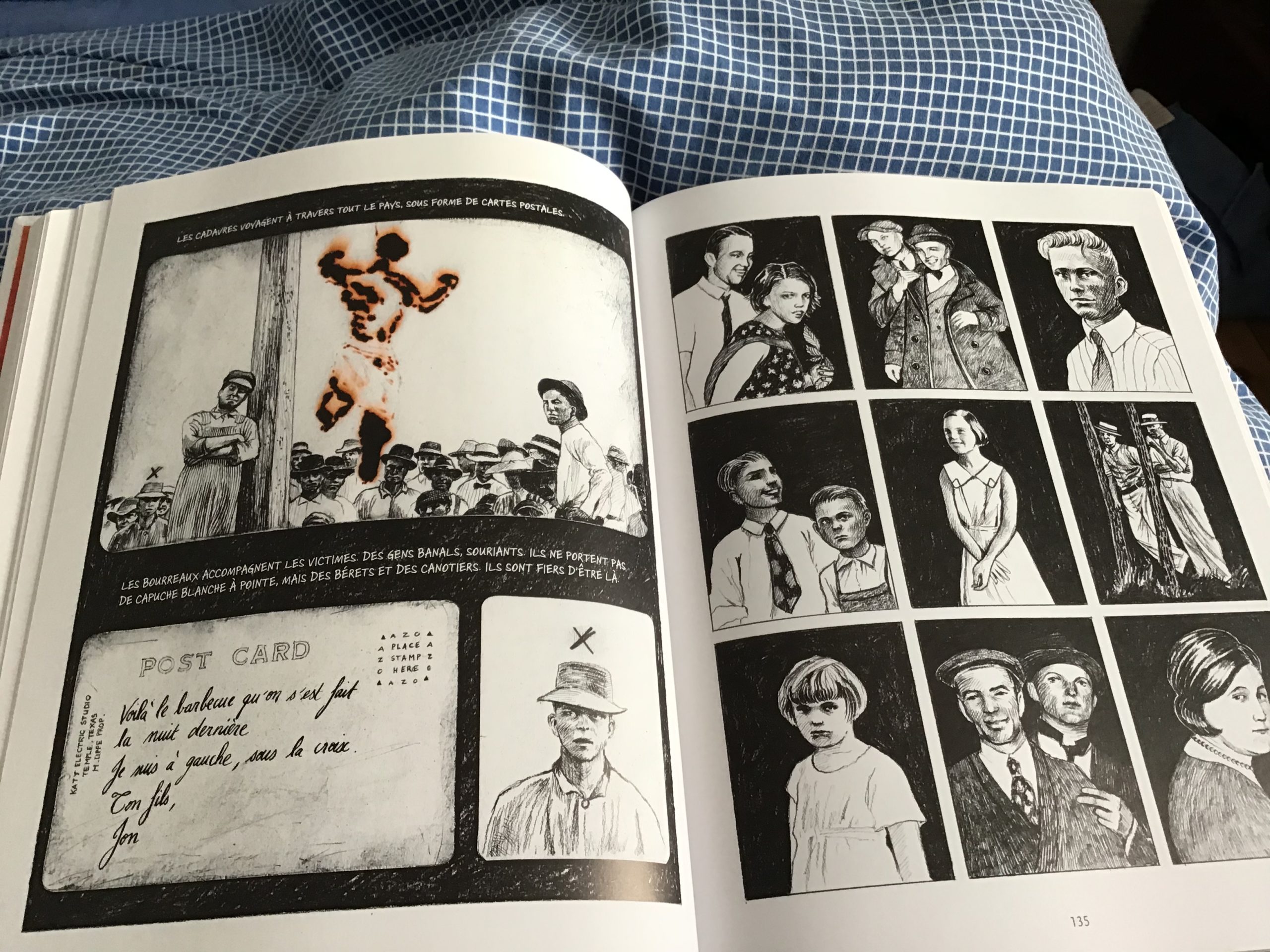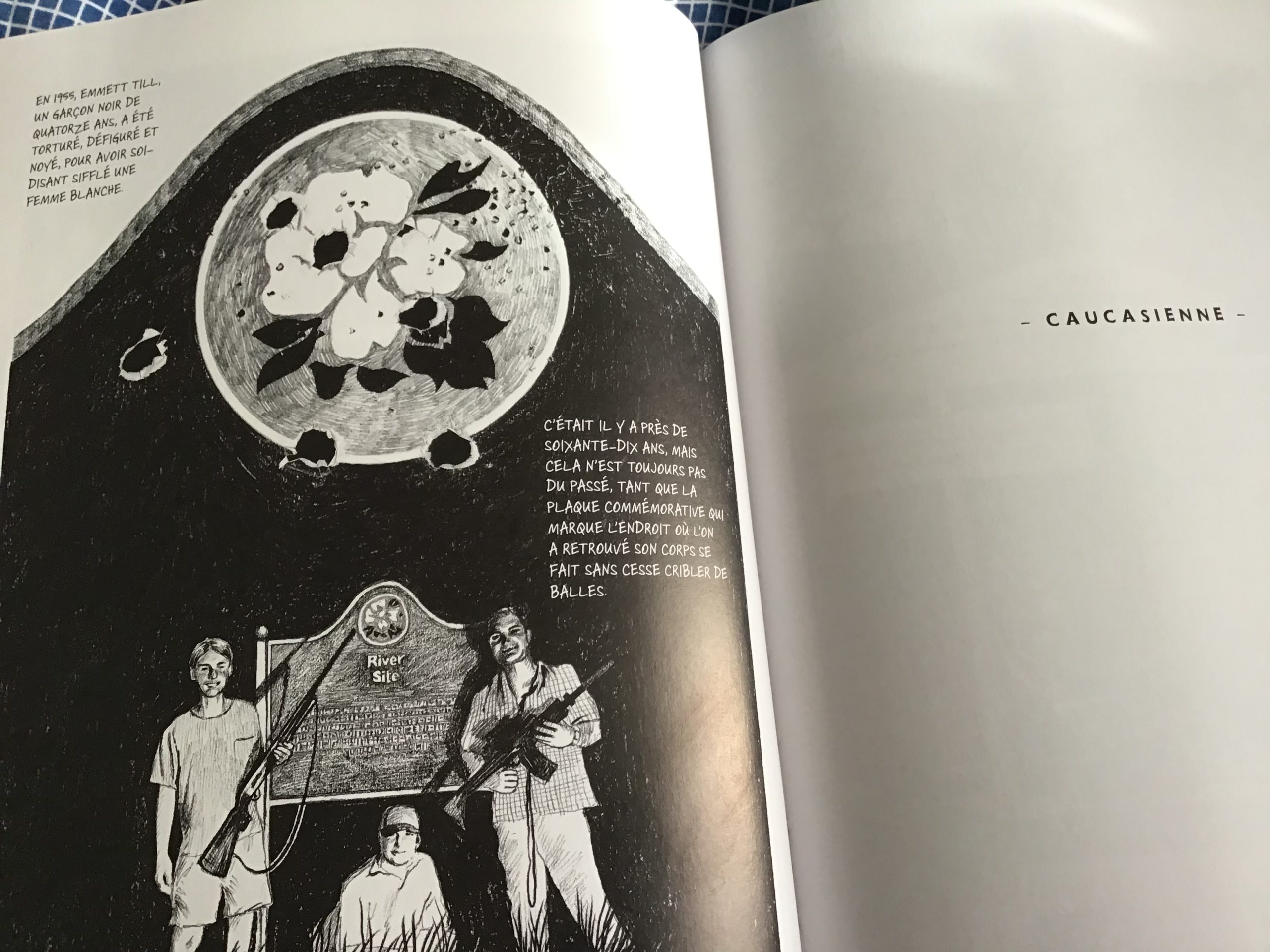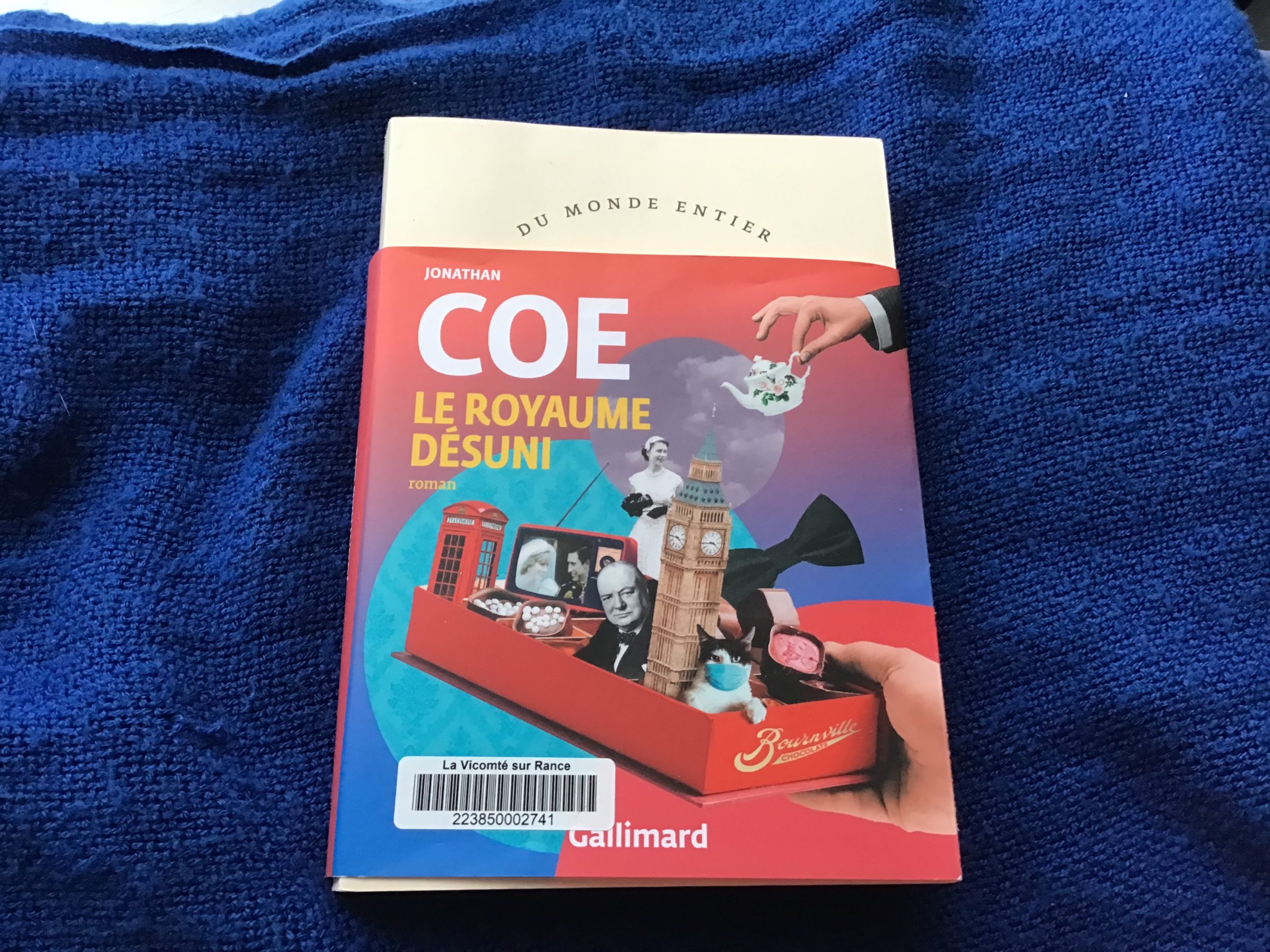Edition Gallmeister traduit de l’Américain par Stéphanie Levet
 Ce livre est absolument stupéfiant, l’auteur américain a fait la guerre 14/18, il en est revenu et a mis 10 ans à écrire ce livre. C’est la première fois que je lis un récit vu du côté américain, par quelqu’un qui a fait cette guerre. Il a pris l’identité de 113 de ses camarades, ceux de la compagnie « K » et, à travers des récits parfois très courts, il nous raconte mieux que bien des roman, la guerre dans toute son horreur. La lecture est éprouvante car l’auteur ne cherche pas à édulcorer la cruauté de ce qui s’est passé dans les tranchées, dans les assauts, sous les bombardements au gaz, dans les hôpitaux et au moment du retour dans des foyers. Aujourd’hui on n’ en parle plus souvent mais que savait-on alors du choc post-traumatique ? Bien sûr, ne pas savoir nommer cette douleur, ne l’empêchait pas d’exister. Et les derniers textes où l’on voit toute la souffrance de ces hommes blessés dans leur chair et ayant perdu leurs repères de valeurs humaines sont bouleversants.
Ce livre est absolument stupéfiant, l’auteur américain a fait la guerre 14/18, il en est revenu et a mis 10 ans à écrire ce livre. C’est la première fois que je lis un récit vu du côté américain, par quelqu’un qui a fait cette guerre. Il a pris l’identité de 113 de ses camarades, ceux de la compagnie « K » et, à travers des récits parfois très courts, il nous raconte mieux que bien des roman, la guerre dans toute son horreur. La lecture est éprouvante car l’auteur ne cherche pas à édulcorer la cruauté de ce qui s’est passé dans les tranchées, dans les assauts, sous les bombardements au gaz, dans les hôpitaux et au moment du retour dans des foyers. Aujourd’hui on n’ en parle plus souvent mais que savait-on alors du choc post-traumatique ? Bien sûr, ne pas savoir nommer cette douleur, ne l’empêchait pas d’exister. Et les derniers textes où l’on voit toute la souffrance de ces hommes blessés dans leur chair et ayant perdu leurs repères de valeurs humaines sont bouleversants.
Nous les verrons monter à l’assaut et mourir, pour la simple raison qu’un capitaine n’a pas su revenir par orgueil sur un ordre qu’il savait absurde. Nous les verrons râler sur la nourriture jamais suffisante, le plus souvent froide. Nous les verrons aller se divertir dans des cafés y rencontrer des prostitués et ramener les maladies qui vont avec. On trouve aussi un moment étrange de paix en pleine guerre sur les bords de la Moselle. On suivra un poète qui n’a jamais su à quel point il a marqué un simple soldat qui n’a pas osé lui dire combien il aimait l’entendre réciter des poèmes. On sera avec ceux qui rêvent d’être blessés pour échapper à cette horreur. On suivra même un petit malin qui réussira à faire cette guerre sans trop souffrir. Mais le coeur du récit, le plus insoutenable, c’est cet acte de barbarie : tuer des prisonniers sans défense. Cela marquera à jamais les hommes de la compagnie K. Et rendra fous ceux qui ont participé à ce crime de guerre, mais à l’époque on ne parlait pas de crime de guerre. C’était la guerre !
Ce livre est une réflexion sur la guerre absolument implacable et chacun des 113 témoignages sont autant de réflexions sur le fait qu’on n’a pas le droit de jouer ainsi avec la vie des hommes.
Citations
Le bien et le mal en temps de guerre.
– J’enlèverai le passage sur l’exécution des prisonniers.
– Pourquoi ? je lui ai demandé
– Parce que c’est cruel et injuste de tirer de sang-froid sur des hommes sans défense. C’est peut-être arrivé quelques fois, d’accord, mais ce n’est pas représentatif. Ça n’a pas pu se passer souvent.
– La description d’un bombardement aérien, ça serait mieux ? Ce serait plus humain ? Ce serait plus représentatif ?
– Oui, elle a dit, oui. Ça, c’est arrivé souvent on le sait.
– Alors c’est plus cruel quand le capitaine Matlock ordonne l’exécution de prisonniers, parce qu’il est tout simplement bête et qu’il estime que les circonstances l’exigent, que quand un pilote bombarde une ville et tue des personnes qui ne se battent même pas contre lui ?
– Ce n’est pas ausi révoltant que de tirer sur des prisonniers, s’est entêtée ma femme.
Et puis, elle a ajouté :
– Tu comprends le pilote ne peut pas voir l’endroit où tombe sa bombe, ni ce qu’elle fait, il n’est donc pas vraiment responsable. Mais les hommes de ton récit, eux, les prisonniers étaient sous leurs yeux … Ce n’est pas la même chose du tout.
Je suis parti d’un rire amer
– Tu as peut-être raison, j’ai dit. tu as peut-être formulé là quelque chose d’inévitable et de vrai.
Héros ou pas
J’ai attrapé mon téléphone pour avertir les canonniers et les mécaniciens qu’il y avait un périscope dissimulé sous un cageot. Le navire a viré d’un coup et au même moment l’artillerie a ouvert le feu. Aussitôt on a vu un sous-marin remonter en surface, vaciller puis se retourner dans un jet de vapeur.
Tout le monde m’a fait la fête et m’a demandé comment j’avais pu repérer que le cageot à tomates camouflait un périscope. Je n’en savais rien, en fait, j’avais simplement deviné juste, c’est tout. Alors comme j’étais un héros intelligent, on m’a donné la Navy cross. Si je m’étais trompé, s’il n’y avait rien eu sous le cageot, j’aurais été une ordure et le dernier des couillons, un déshonneur pour la troupe et, à tous les coups, ils m’auraient envoyé au trou. On me la fait pas à moi.
L’absurdité .
On a été momentanément détaché de notre division et rattachés aux Français, et pendant six jours et six nuits on a combattu sans sommeil et sans trêve. Comme on se battait sous les ordres des Français, c’étaient eux aussi qui nous donnaient le ravitaillement et les vivres. Quant le premier repas est arrivé, il y avait du vin rouge et une petite ration d’eau de vie pour chacun d’entre nous. On avait faim et froid, on était extrêmement fatigués, l’eau-de-vie nous a réchauffé les sangs et nous a rendu les longues nuits supportables.
Mais le deuxième jour, quand ils ont apporté le repas, le vin et l’eau-de-vie avaient disparu des rations des soldats américain. Les œuvres de bienfaisance françaises s’étaient élevées contre le fait qu’on nous distribue de l’alcool : on craignait que la nouvelle ne parvienne jusqu’aux États-Unis, où elle risquait de contrarier l’Union des femmes chrétiennes pour la tempérance, et le bureau des méthodistes pour la tempérance, la prohibition et les bonnes mœurs.
Un moment de paix pendant la guerre .
La nuit où on a pris la relève, les Français nous ont expliqué les règles du jeu et nous ont demandé de les respecter : le matin les Allemands pouvaient descendre au bord de l’eau pour nager, faire la lessive ou ramasser des fruits dans les arbres de l’autre côté du fleuve. L’après-midi, ils devaient disparaître et on avait toute liberté de nager, de jouer ou de manger des prunes de notre côté à nous. Ça marchait impeccablement.
Le matin les Allemands nous ont laissé un mot où il s’est excusé de devoir nous informer qu’on allait être bombardé dès ce soir là, à 10 heures, et que le tir de barrage allait durer vingt minutes. Et ça n’a pas raté, l’artillerie a ouvert le feu mais tout le monde s’était repliée d’un kilomètres vers l’arrière et était allé se coucher, et il n’y a pas eu de mal. On a passé douze jours magnifiques stationnés près de la Moselle et puis à notre grand regret, on a levé le camp. Mais on avait tous appris une chose : si les hommes de rang de chaque armée pouvaient simplement se retrouver au bord d’un fleuve pour discuter calmement, aucune guerre ne pourrait jamais durer plus d’une semaine.
La fin et l’oubli.
J’étais là à réfléchir , à essayer de me rappeler le visage des hommes avec qui j’avais servi, mais je n’y arrivais pas. Je me suis rendu compte, alors, que je ne me serai pas rappelé la tête de Riggin lui-même si je n’avais pas su avant qui il était. J’ai commencé à me sentir triste, tout ça s’est passé il y avait tellement longtemps, il y avait tellement de choses que j’avais oubliées . Je regrettais d’être venu au camp. Pig Iron et moi, on restait plantés là, à se regarder. On avait rien à se dire finalement. On a refermé l’ancien bâtiment et puis on est sortis.
 Ce livre est un projet de lecture avec mon petit fils de huit ans. Sa maman se désole car il ne lit plus que des mangas. J’ai fait une recherche dans les différentes maison d’édition et j’ai été étonnée à quel point c’est difficile de trouver un roman d’aventure. J’espère que celui-ci lui plaira mais je lui laisserai la parole.
Ce livre est un projet de lecture avec mon petit fils de huit ans. Sa maman se désole car il ne lit plus que des mangas. J’ai fait une recherche dans les différentes maison d’édition et j’ai été étonnée à quel point c’est difficile de trouver un roman d’aventure. J’espère que celui-ci lui plaira mais je lui laisserai la parole.