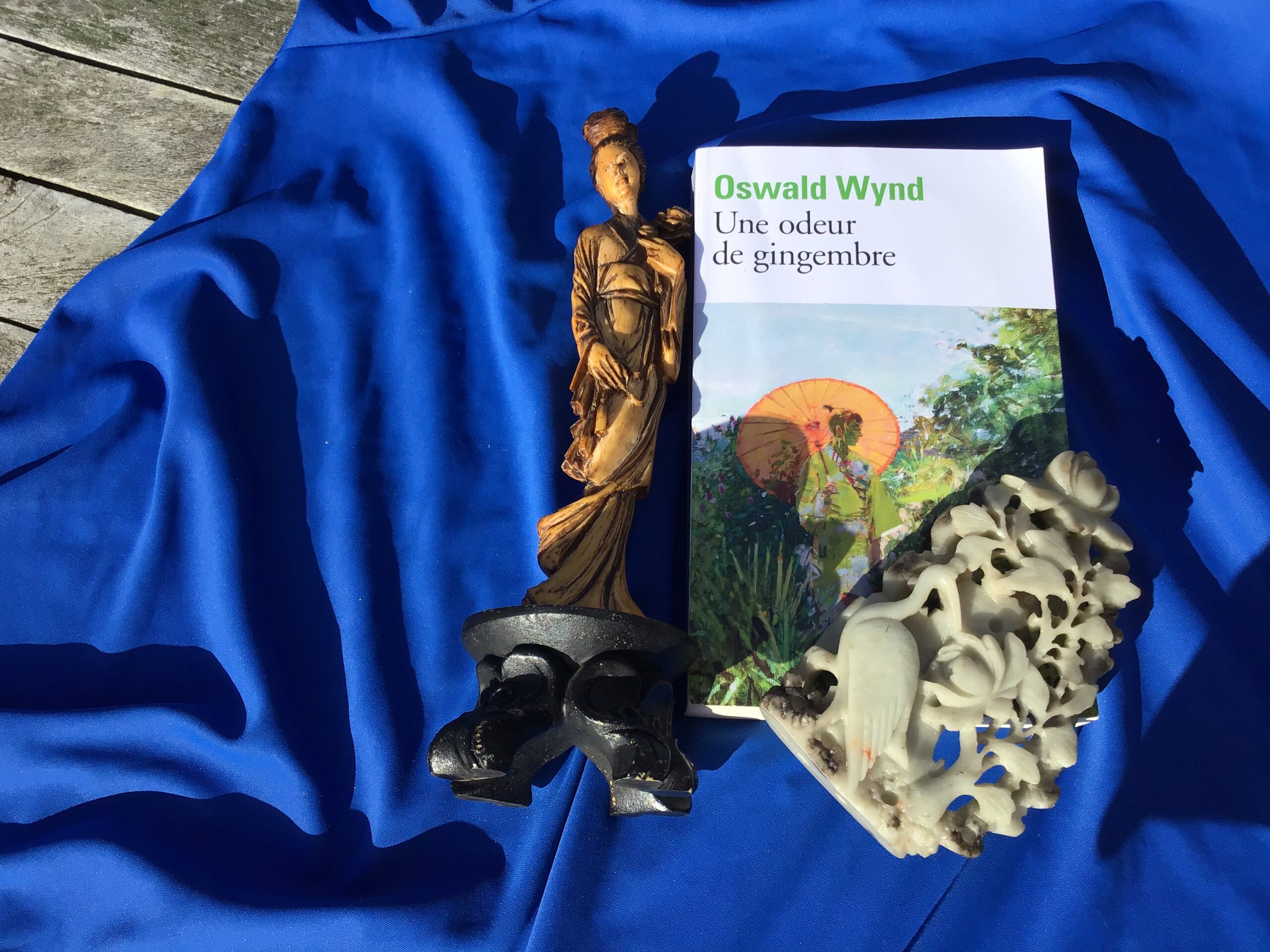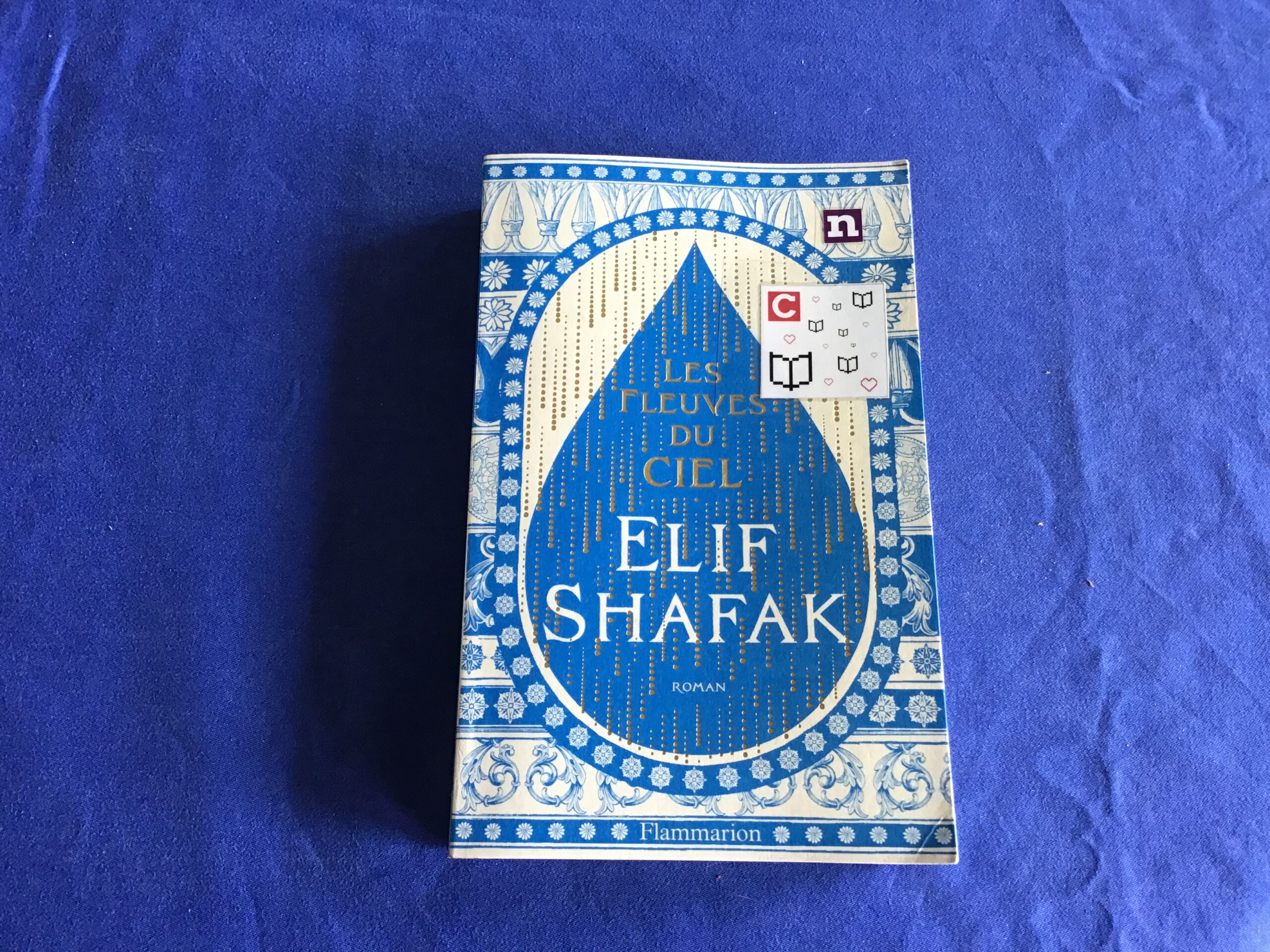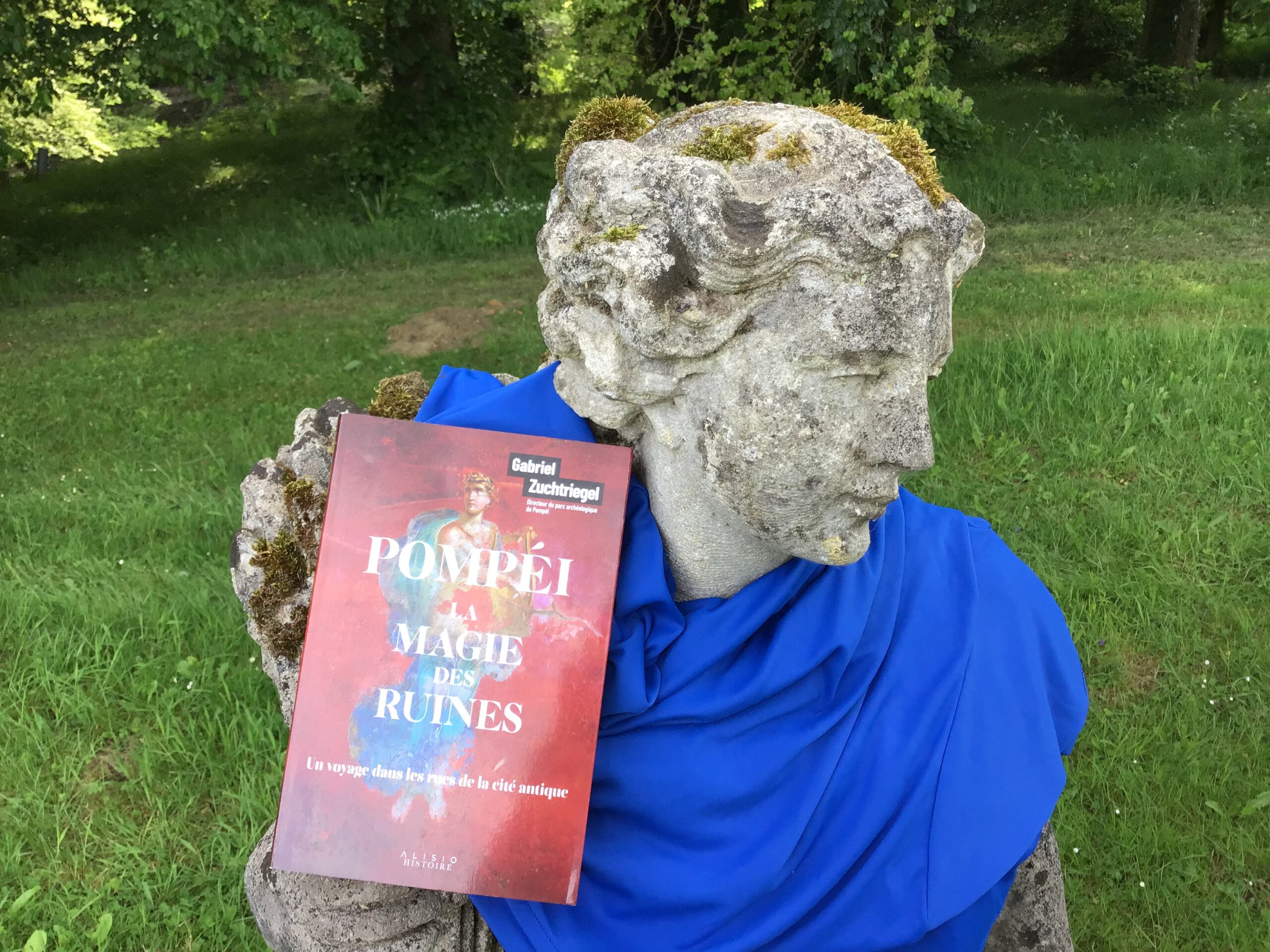Éditions de l’Olivier, 142 pages, Août 2025
 Je connaissais cet auteur pour ses nouvelles en particulier « la patience des buffles sous la pluie« , le sujet de ce livre, la vie de son frère schizophrène, me touche et j’ai voulu savoir comment il allait raconter cette terrible maladie. Un peu comme pour ses nouvelles en chapitres souvent très courts, l’auteur remonte le temps de vie partagée avec son frère aîné. Lui, il est le troisième garçon d’une famille aimante, mais depuis quarante ans il vit dans l’angoisse des coups de fil qui peuvent annoncer les mauvaises nouvelle d’Édouard . Le récit commence par le dernier coup de fil, celui de la responsable de la clinique où le malade aurait dû être depuis deux jours. C’est l’auteur qui rentrera chez lui pour découvrir son frère mort. Ensuite il faudra l’enterrer, puis se souvenir des moments tragiques où la maladie ne laissait aucun répit à cet homme qui pourtant se battait de toutes ses forces contre elle . On remonte ainsi les années jusqu’aux jours lumineux de l’enfance où les deux frangins avaient tissé des liens affectueux. On peut donc refermer ce petit récit sur un personnage plein de promesses, qui avait toujours des idées pour rire et s’amuser et qui, surtout, a su aimer sa famille et ses amis. On en oublierait presque les scènes de violence où le même Édouard vomissait sa haine contre ses parents, ses frères et tous ceux qui voulaient l’aider.
Je connaissais cet auteur pour ses nouvelles en particulier « la patience des buffles sous la pluie« , le sujet de ce livre, la vie de son frère schizophrène, me touche et j’ai voulu savoir comment il allait raconter cette terrible maladie. Un peu comme pour ses nouvelles en chapitres souvent très courts, l’auteur remonte le temps de vie partagée avec son frère aîné. Lui, il est le troisième garçon d’une famille aimante, mais depuis quarante ans il vit dans l’angoisse des coups de fil qui peuvent annoncer les mauvaises nouvelle d’Édouard . Le récit commence par le dernier coup de fil, celui de la responsable de la clinique où le malade aurait dû être depuis deux jours. C’est l’auteur qui rentrera chez lui pour découvrir son frère mort. Ensuite il faudra l’enterrer, puis se souvenir des moments tragiques où la maladie ne laissait aucun répit à cet homme qui pourtant se battait de toutes ses forces contre elle . On remonte ainsi les années jusqu’aux jours lumineux de l’enfance où les deux frangins avaient tissé des liens affectueux. On peut donc refermer ce petit récit sur un personnage plein de promesses, qui avait toujours des idées pour rire et s’amuser et qui, surtout, a su aimer sa famille et ses amis. On en oublierait presque les scènes de violence où le même Édouard vomissait sa haine contre ses parents, ses frères et tous ceux qui voulaient l’aider.
C’est une peinture tellement exacte de la maladie mentale, on est loin de la présentation romantique que l’on trouve parfois dans les romans, je me souviens de mes réserves sur ce roman qui a connu un grand succès « En attendant Bojangles« , une femme bipolaire, l’imaginer heureuse c’était impossible pour moi. J’ai trouvé beaucoup plus juste le point de vue de Jean-François Beauchemin » Le Roitelet » à propos d’un frère schizophrène. Mais David Thomas va plus loin encore, au plus près de la souffrance absolue des malades mentaux : son frère a souffert le martyre et son addiction aux drogues, cannabis , cocaïne et alcool ont sans doute aggravé ses délires paranoïaques. C’est écrit dans un style précis et parfois, quand c’est possible, poétique, pour moi il n’y a pas de doute si ce sujet vous touche ou touche un de vos proche la lecture de ce roman vous aidera à mieux supporter votre douleur et celle de la personne malade.
Extraits.
Début.
Le masque
C’était à un mariage. Le dernier où nous sommes allés ensemble, quelques mois avant sa mort. Il était là, assis au milieu de tout le monde, entouré de gens qui allaient et venaient, une coupe de champagne et élégamment maintenue au bout d’un poignet souple, de gens qui presque glissait dans un ballet fluide et élégant. C’est ça le bonheur (ou son image) glisser. Le malheur, lui, fige les êtres. Il était assis au milieu du mouvement, immobile, courbé, les épaules rondes en carapace, les mains jointes entre les genoux, avec un masque sur le visage, le masque de la souffrance.
Je suis tellement d’accord avec cet auteur.
Alors quand je vis dans un article sur Silvia Plath d’un écrivain critique qui ne semble pas avoir approché beaucoup d’aliénés : « Les malades mentaux font d’extraordinaires narrateurs car tout ce qu’ils disent est original, décalé, comique. Ce que l’on cherche dans un roman, c’est fuir la banalité. Beaucoup d’auteurs devraient faire un séjour en HP pour voir l’existence sous un angle différent » , j’ai envie d’emmener son auteur à Sainte-Anne, pas pour un reportage d’une semaine, non mais pour un mois ou deux, afin qu’ils voient de près la texture du supplice, qu’il la touche qui la sente ( l’haleine provoquée par certains médicaments) qu’il vive l’ennui, le vide, la peur, l’angoisse, la solitude, l’exclusion, l’épuisement, l’infantilisation, les dysfonctions du corps et les courts-circuits de l’esprit. Je voudrais qu’il prenne quarante kilos, qu’il transpire à tremper ses vêtements, qu’il perde ses dents que ses mains tremblent comme celle d’un parkinsonien, qu’il ait du mal à chier, à bander, à parler, à voir, à marcher sans trébucher et à comprendre où il est. Les hôpitaux psychiatriques ne sont pas des savanes peuplées d’animaux magnifiques, ils sont des enfers où errent des êtres liquidés de tout ce qui nous rend libres.
On ne le dit pas assez.
Toutes les études et les écritures sont formelles sur la forte conséquence de la toxicomanie sur les sujets souffrants de cette pathologie. L’alcool, mais surtout le cannabis et la cocaïne sont dévastateurs pour les psychotiques.
Les soins.
Le cerveau est un organe peu connu comparé à d’autres. Ce qui apparaît certain, c’est qu’il faut poursuivre vers la neurologie, intensifier les recherches et abandonner les pistes psychanalytiques. C’est déjà ça. De réels progrès ont été faits sur les effets secondaires des traitements, les diagnostics sont plus précis, les malades mieux suivis, mais les médecins manquent d’outils et de savoir pour réparer une mécanique extraordinairement complexe. Ce n’est pas la psychiatrie qui enferme le malade, c’est la maladie qui, aujourd’hui encore, est opaque.
La souffrance d’un fils et de sa mère.
Qui aurait pu croire que cette femme avait un fils schizophrène ? Qui aurait pu imaginer ce que son fils lui a reproché, les insultes, les hurlements qu’elle a reçus ? Qui aurait pu imaginer ce qu’elle a ressenti dans son corps, dans son ventre, lorsqu’elle l’entendait pleurer au téléphone ou qu’elle le voyait s’effondrer devant elle, incapable qu’il était de voir la moindre lumière, la moindre lueur dans sa vie, faisant l’inventaire de ses échecs, de ses impasses ? Et elle, face à la tristesse abyssale de son fils, devant trouver les mots, être à l’écoute, être présente, être là alors qu’il lui demande de ne pas l’être, enfin si, mais non, casse-toi mais ne m’abandonne pas, écoute-moi, mais ne m’appelle pas, je ne peux plus te supporter mais je ne peux pas vivre sans toi, salope, je t’aime. Et elle qui a tout encaissé, qui a tout pardonné tout. Elle l’a défendu. Toujours. Elle a acceptée. Tout. Elle a été, inlassablement la voix qui ramenait à une réalité que nous n’avions pas le choix d’accepter : « Vous ne ferez jamais marcher un paralytique. » Elle fut la première savoir ce qui se passait, la première à comprendre dès la fin de l’adolescence, quand il aura des comportements un peu … bizarres, excessifs, inappropriés, fantasques, elle saura. En quarante de maladie je ne l’ai jamais entendue prononcer le moindre mot désobligeant sur son fils. Elle s’est toujours interposée pour le défendre.