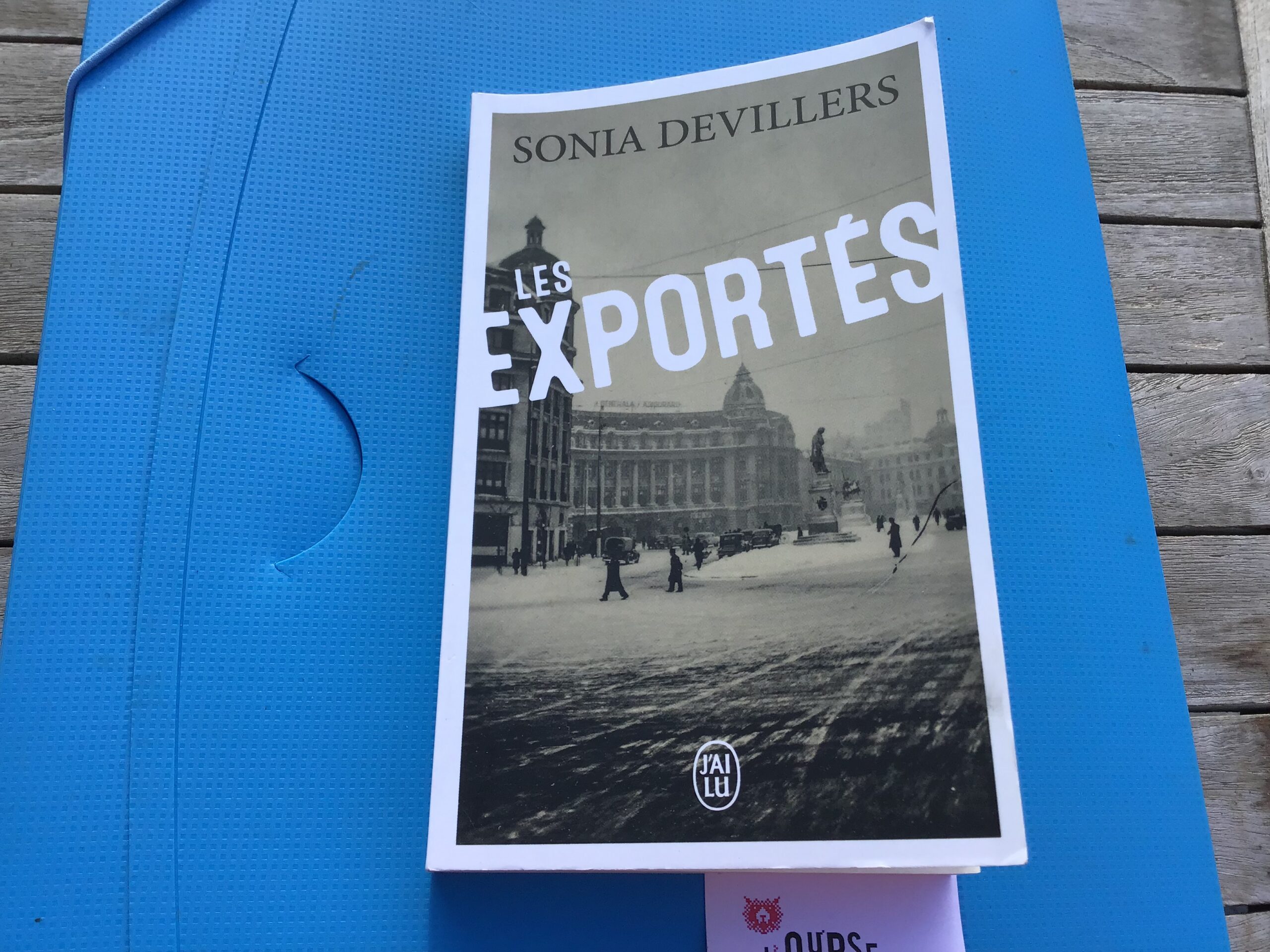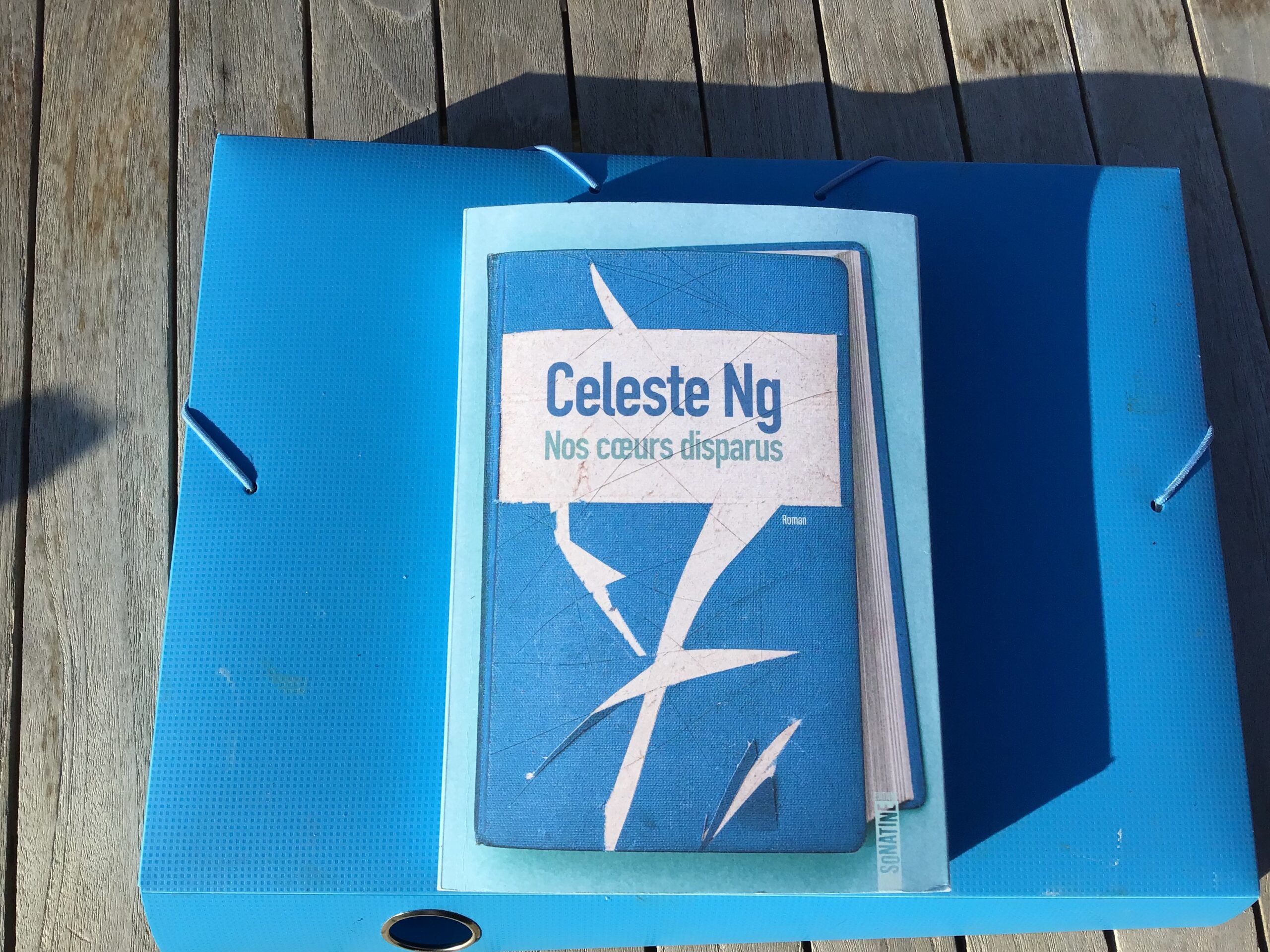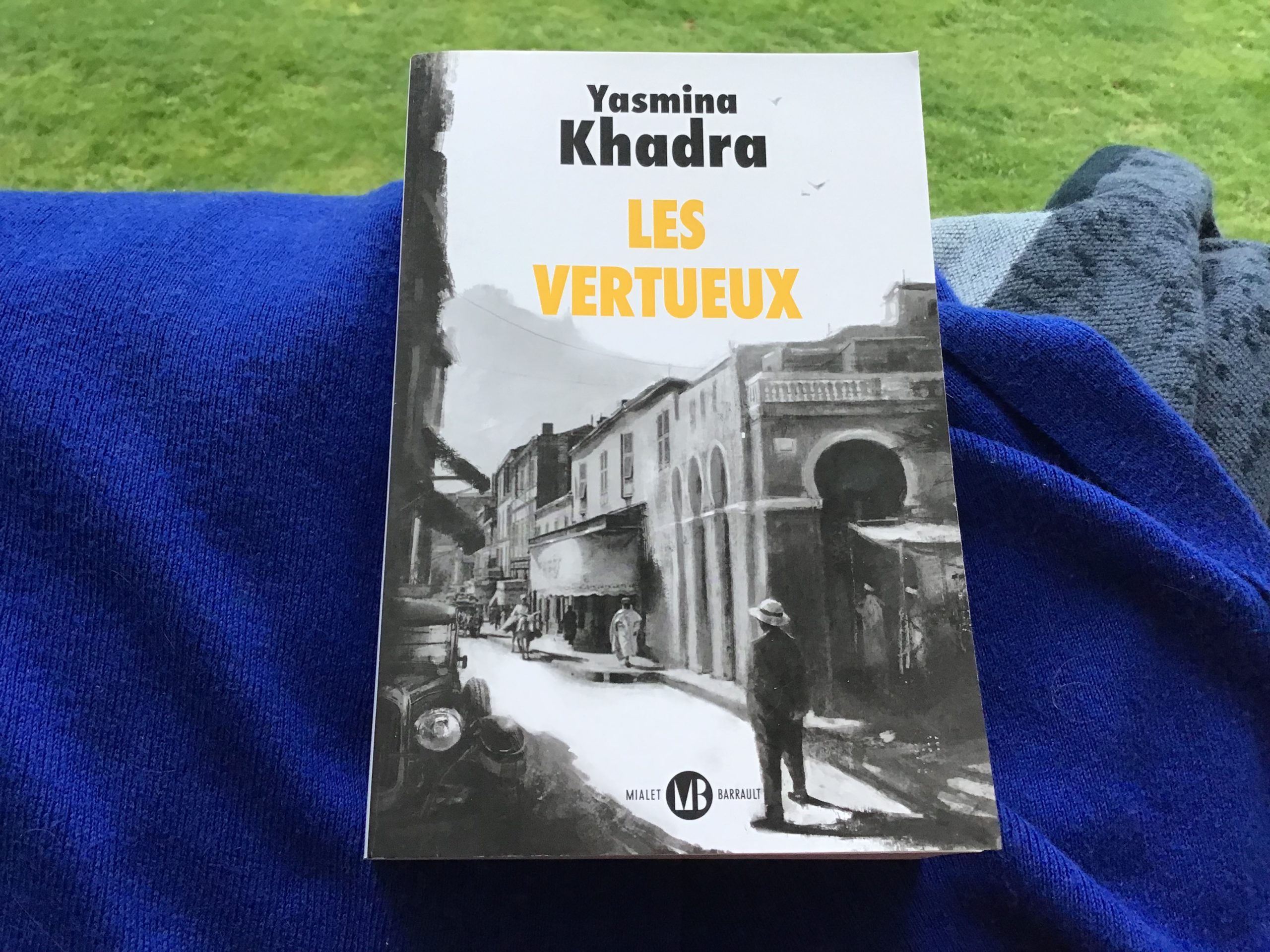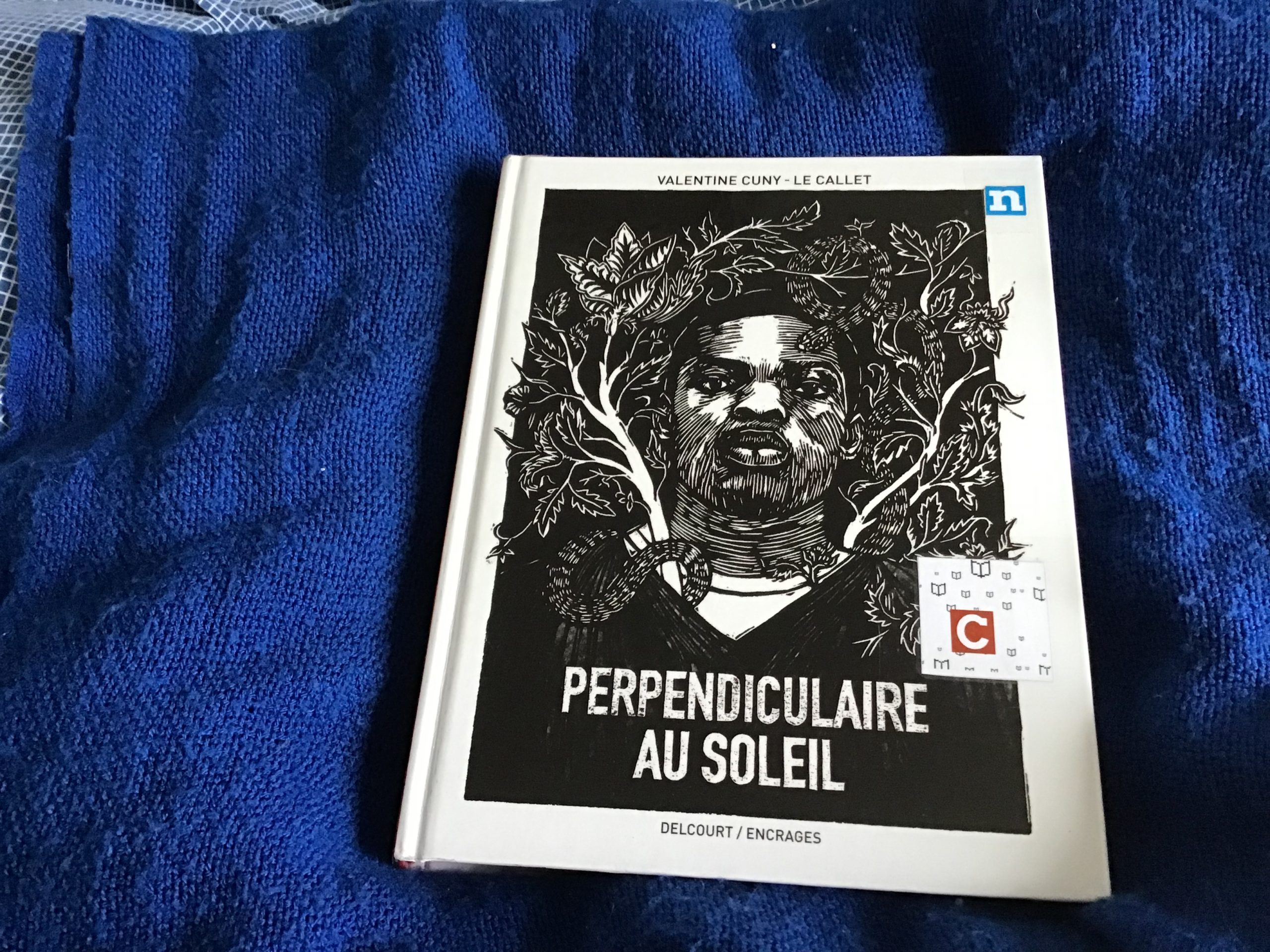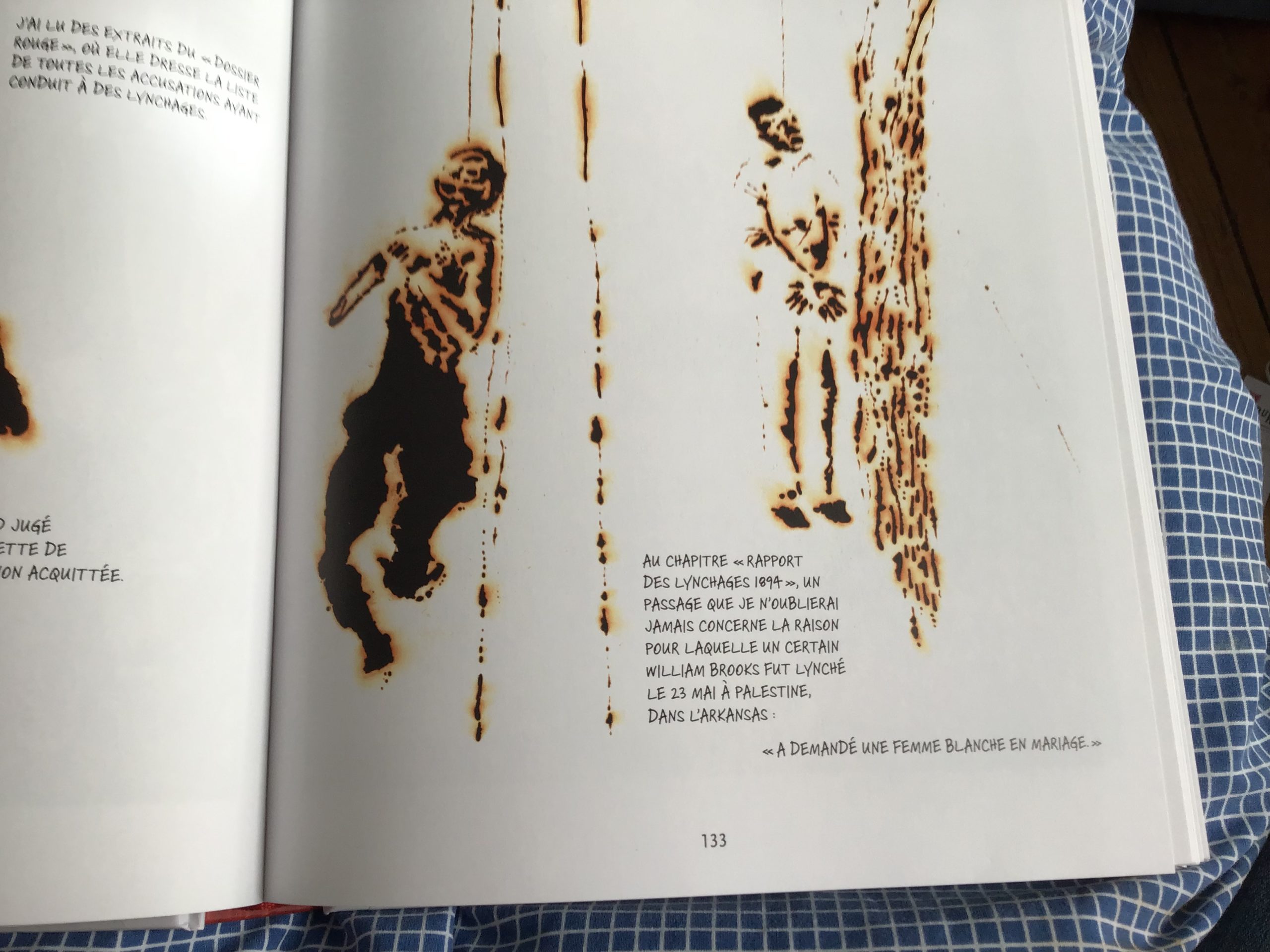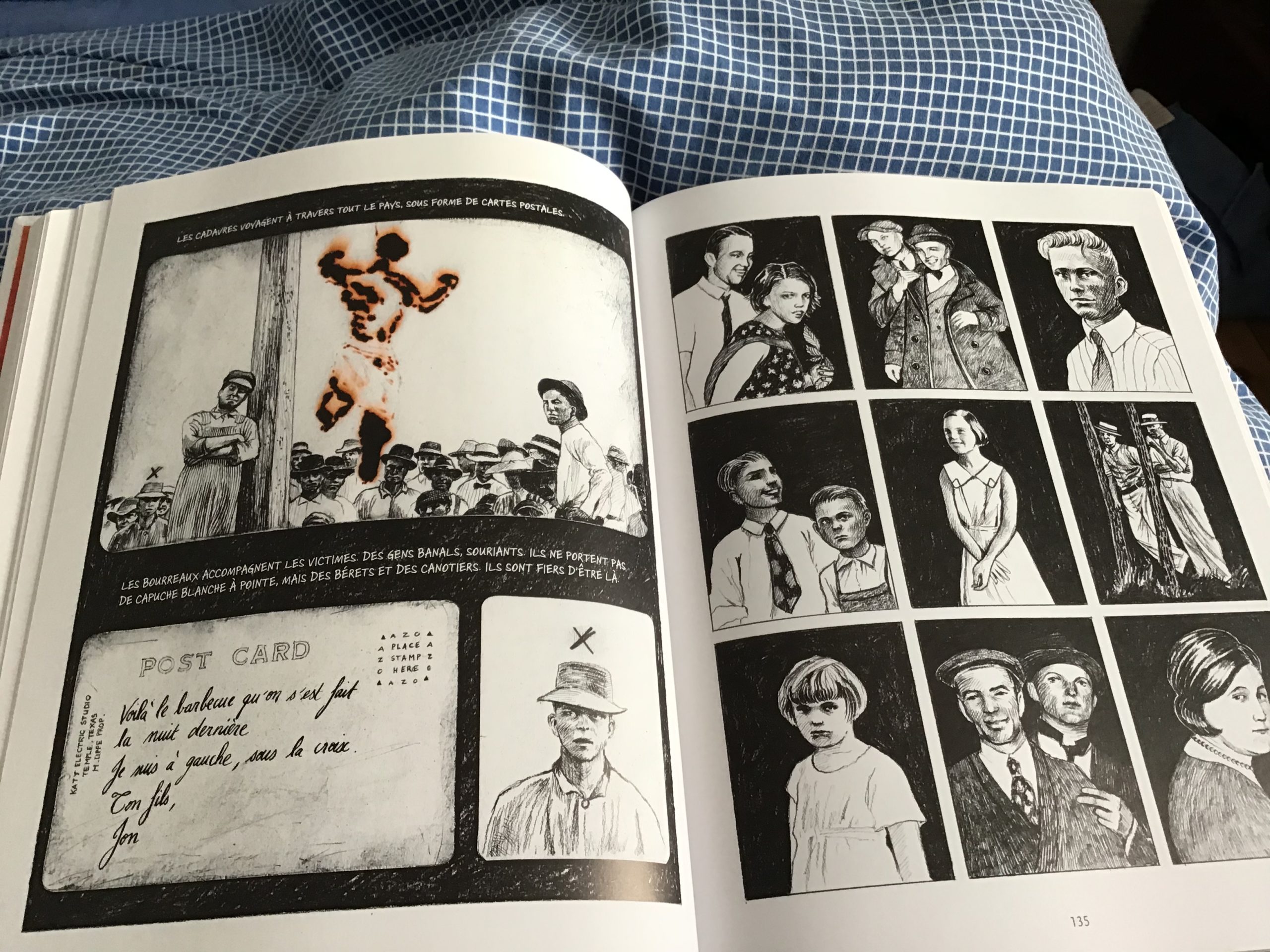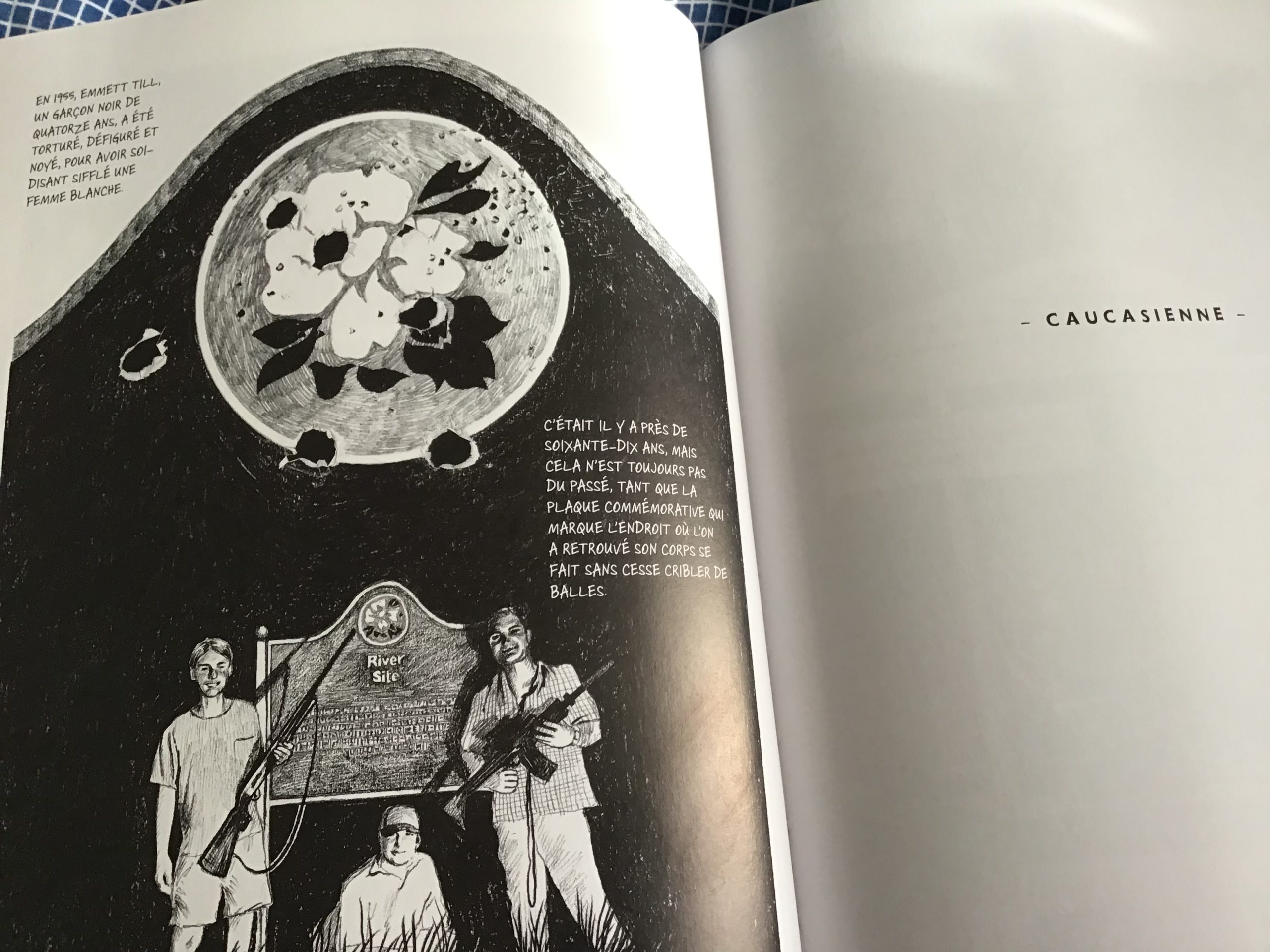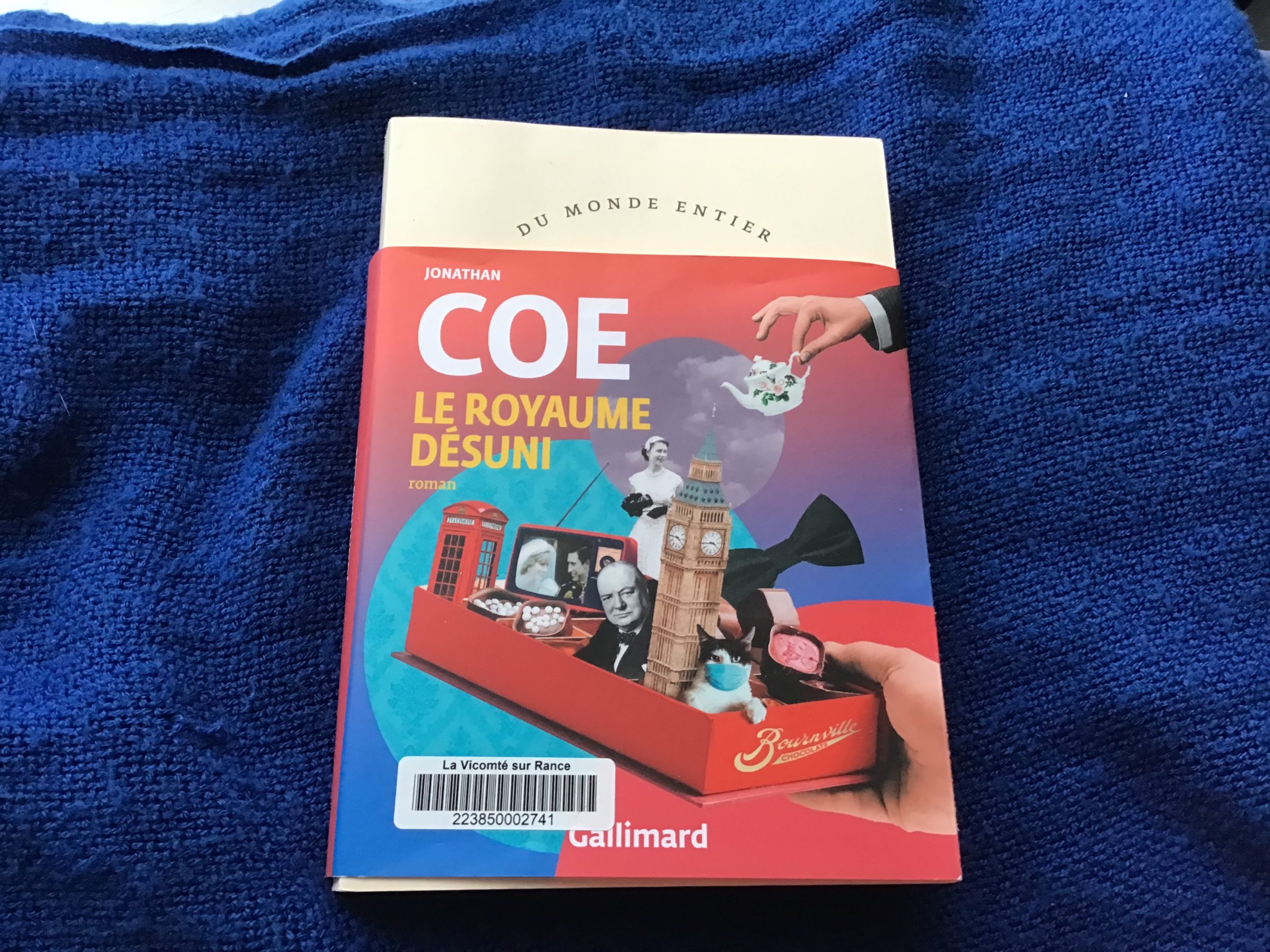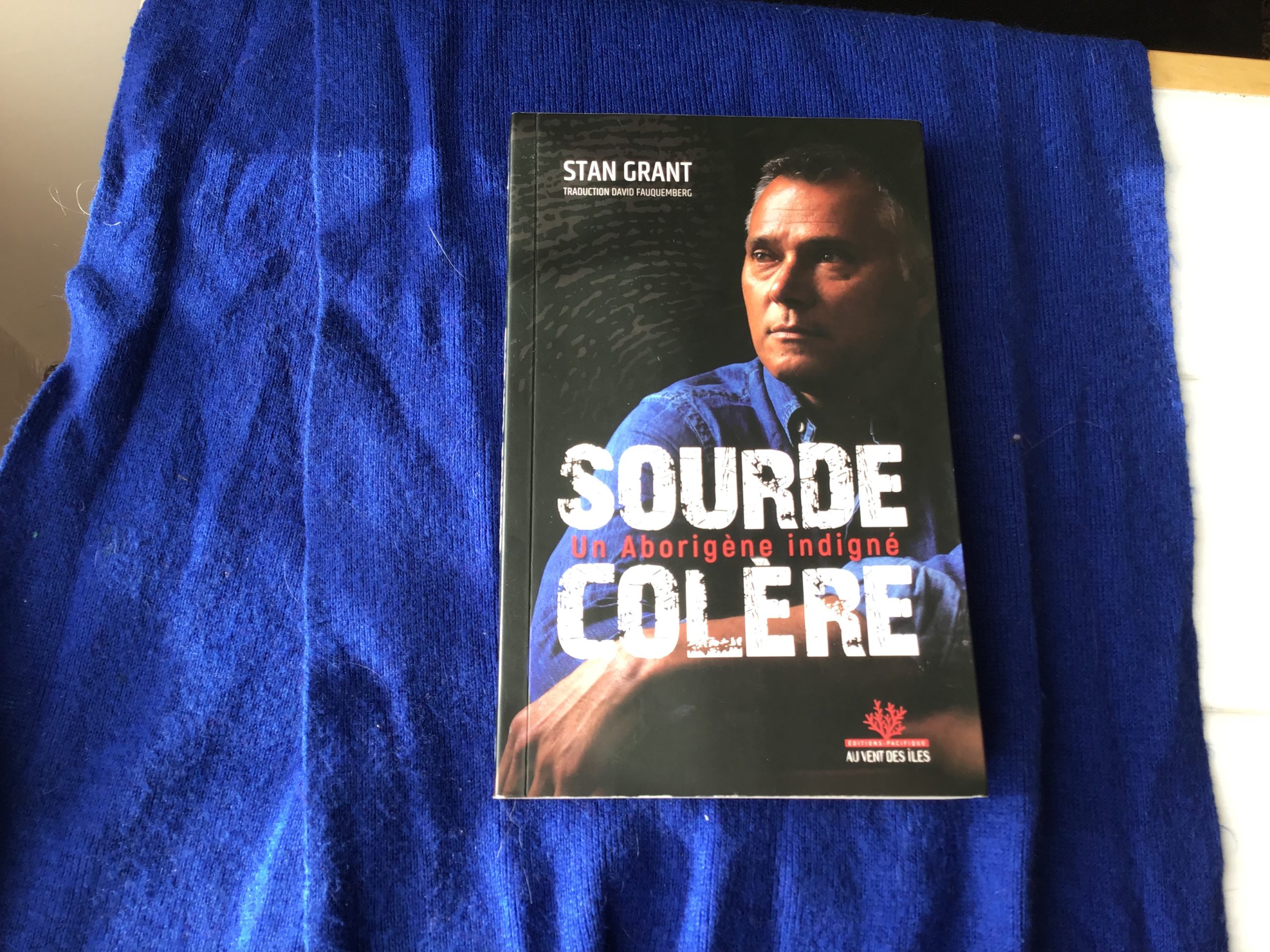Édition J’ai Lu
Après les déportations de masse, l’exportation de masse. Face à des chiffres spectaculaires, comment ne pas considérer que les communistes ont, dans les faits, achevé l’oeuvre des fascistes ? En débarrassant la Roumanie de ses juifs, ils sont parvenus enfin à ce que le maréchal Antonescu et son clan désignaient, en 1940, comme « le moment tant attendu de la délivrance ethnique ». une délivrance sans effusion de sans ; Un effacement corps et âme, doublé d’un juteux trafic.
 Quel livre ! La journaliste a mené une enquête fouillée pour comprendre le sort des juifs en Roumanie. Elle mêle de façon très judicieuse la vie de sa propre famille d’origine juive roumaine et l’histoire du pays. Il faut vraiment lire jusqu’au bout ce livre, car les questions qu’elle se pose dans le dernier chapitre je me les posais tout le long du livre.
Quel livre ! La journaliste a mené une enquête fouillée pour comprendre le sort des juifs en Roumanie. Elle mêle de façon très judicieuse la vie de sa propre famille d’origine juive roumaine et l’histoire du pays. Il faut vraiment lire jusqu’au bout ce livre, car les questions qu’elle se pose dans le dernier chapitre je me les posais tout le long du livre.
Anna Yes a aussi chroniqué ce livre et elle pourra voir combien ce livre m’a plu, (je l’avais lu une première fois sans mettre de billet )
Rappel historique, la Roumanie s’est retrouvée avec une forte minorité juive après la guerre 14/18 , car étant du côté des vainqueurs son territoire a été augmenté de provinces où vivaient de fortes minorités juives. Pendant la montée des nationalismes fascistes avant la guerre 39/45, ces minorités juives posent un problème important au régime nationaliste roumain. L’originalité de ce pays est de n’avoir pas déporté sa population juive de Bucarest. Ce que les archives montrent c’est que leur extermination était prévue mais le dirigeant de la Roumanie a compris que les Allemands pouvaient perdre la guerre , donc les neuf derniers mois de guerre ils ont changé de bord. La famille Deleanu, grands-parents de Sonia Devillers, était une famille juive très influente de Bucarest. Ils ont perdu tous leurs droits pendant la guerre mais pas la vie ! Ils épousent avec enthousiasme la cause communiste, et ne parlent jamais des exterminations qui ont eu lieu dans d’autres régions roumaines. Il faudra beaucoup de temps pour que ce pays accepte ses responsabilités sur l’extermination qu’elle voulue et organisée. Officiellement, la Roumanie voulait être le pays qui a défendu ses juifs.
Et puis, le communisme, a refermé le pays sur lui-même et la chasse aux juifs a recommencé. Mais, et c’est là le sujet du livre, il a su en faire une monnaie d’échange pour renflouer les caisses de cet état qui était très pauvre, car l’URSS leur a fait payer leur solidarité avec l’Allemagne. Le régime a donc échangé les juifs roumains contre ce qui manquait tant à ce pays : des cochons, des vaches, des fermes, des abattoirs …
Ainsi chaque juif qui est parti de ce pays peut savoir ce qu’il valait , car les comptes sont très bien tenus : tant de porcs pour le départ d’un juif.
À la tête de ce trafic humain, un passeur qui fait tout ce qu’il peut pour permettre aux juifs de sortir, Sonia Devillers essaie de cerner la personnalité de ce passeur, est-il un mafieux ou un sauveur ? Elle ne peut pas répondre à cette question.
La question qu’elle pose aussi à la fin de ce livre, qui lui a été suggérée par des lettres de Roumains, on peut être, choqué de voir que la vie de ses parents valait tant de porcs, ou de vaches, mais comme le disent les pauvres Roumains au moins, vous, vous pouviez sortir et vivre.
Ce qui est choquant aussi, c’est que tous ces faits ont été révélés depuis longtemps mais la presse française (elle cite Libération et le Monde) ne voulaient pas le dire car il y a eu si longtemps une Omerta sur la dénonciation de l’antisémitisme communiste. Il a fallu l’ouverture des archives de Roumanie, pour que ces faits choquants soient enfin révélés pour l’opinion publique européenne.
Il me reste aussi une question , échanger des êtres humains contre de l’argent que ce soit sous forme d’animaux ou de dollars, n’est ce pas ce que fait tout état pour récupérer des otages ? Il est vrai que ce qui est différent c’est qu’il s’agissait de Roumains persécutés parce que juifs donc otages dans leurs propres pays par leurs compatriotes.
Le livre est passionnant, et se lit très facilement mais il faut aussi savoir que c’est souvent insupportable en particulier les exterminations par les Roumains de la population juive sans aucune défense.
Extraits
Début.
Ils n’ont pas fui, on les a laissés partir. Ils ont payé pour cela une fortune. Des papiers leur ont été accordés, puis retirés, puis finalement accordés. Ils ne voulaient pas quitter leur pays. ils ne voulaient pas mais ils n’avaient plus le choix.
La jeunesse de sa grand-mère.
La jeunesse de Gabriela, en revanche, on y avait droit, avec emphase et trépidation : sa famille remarquable, sa ville pimpante Bucarest dite le « petit Paris des Balkans » dans l’entre-deux-guerres. Ma grand-mère se targuer de trouver dans les librairies les romans français « ,le lendemain de leur sortie à Saint-Germain. »
En 1940 .
En 1940, la Roumanie en proie à un immense désordre, subit la pire des humiliations. Les belles provinces qui lui avaient été rattachées à l’issue de la Première Guerre mondiale lui furent brutalement retirées par le pacte germano-soviétique. Ces territoires largement peuplés de juifs, allaient donc passer aux mains des Russes. Et cela, on ne le pardonnerait pas aux juifs, traités de vermine invasive d’abord, de traîtres par la suite. Les youpins et les rouges allaient pactiser, c’était certain. L’exaspération nationalistes n’avait alors d’égale que la détestation du « judéo-bolchevisme ». La nation semblait menacer de désintégration. La psychose battait son plein.
Le silence de ses grands parents.
J’aurais voulu l’entendre de la bouche de mes grands parents. Obtenir une bribe, ne serait-ce qu’une bribe, de ce qu’ils avaient ressenti face à une telle démonstration de force, une telle légitimation de la rage antisémite. J’ai entendu parler un peu, enfant, de la Garde de fer, de sa révolte, de la rafle de mon grand-père. Mais les mots étaient lisses. Les mots étaient vides. Les mots étaient prononcés d’un ton détaché. Ils plantaient le décor sans autre émotion. Une anecdote de plus. Sans plus mes grands-parents ont tous vécu, presque tout dit, mais c’est comme s’ils n’avaient rien senti.
La Shoa organisée par les Roumains (les moyens d’exécution sont insoutenables).
Enfin la tuerie du camp de Bogdanovka reste une des plus impressionnantes de toute la Seconde Guerre mondiale. En fait de camp, il s’agissait encore de batteries de porcs délabrées ouverte à tous les vents. Mais comme le disait le commandant alors qu’il gelait à pierre fendre : « la paille c’est pour les cochons pas pour les youpins ! » la décision d’en finir avec les huit mille détenus juifs fut prise en décembre 1941.
Négation de la Shoa sous le régime communiste.
Au delà des procès, la Roumanie communiste avait proscrit le mot « juif ». L’ethnologue Andrei Osteanu constate qu’à l’époque le terme a été éradiqué des romans comme des textes de sciences sociales. Sous prétexte de prendre le contre-pied de la littérature et de la presse d’avant-guerre, obsédées par le péril juif, le Parti refuse de nommer les juifs pour ne pas les stigmatiser. Mais ce faisant, il finit par les effacer. Et Andrei Osteanu de rappeler qu’en régime totalitaire, « si on en parle pas, c’est que ça n’existe pas ».
La situation de sa grand-mère à Paris.
Les exilés romains riches ne la recevaient pas parce qu’elle avait été communiste. Les intellectuels français, non plus. Ils étaient tous de gauche dans les années 1960 et 1970. Ils considéraient les communistes qui avaient fui comme des traîtres ou des fascistes déguisés. Gabriela ne se sentait aucune affinité avec une quelconque diaspora juive. Immigrée et sans travail, il était difficile de s’intégrer à la bourgeoisie parisienne. Gabriela n’avait sa place nulle part
Le troc.
L’argent, tout l’argent des familles roumaines qui voulaient s’enfuir, les douze mille dollars que mes grands-parents mettraient une vie à rembourser, avait servi à acheter des porcs. Des bataillons de porcs, des élevages entiers de porcs. Attention, pas n’importe quels porcs, des porcs de compétition, plus précieux, plus productifs, plus rentables que es citoyens qui quittaient le pays. Depuis la nuit des temps, ceux-là profitaient beaucoup et rapportaient peu : les juifs
Perec en 1981 dit ce que c’est être juif pour lui.
« Je ne sais pas très précisément ce que c’est qu’être juif, ce que ça me fait d’être juif. C’est une évidence, si l’on veut, mais une évidence médiocre, qui ne me rattache à rien. Ce n’est pas un signe d’appartenance, ce n’est pas lié à une croyance, à une religion, ou à une pratique, à un folklore, à une langue. Ce serait plutôt un silence, une absence, une question, une mise en question, un flottement, une inquiétude. Une certitude inquiète derrière laquelle se profile une autre certitude, abstraite, lourde, insupportable : celle d’avoir été désigné comme juif, et parce que juif victime, de ne devoir la vie qu’au hasard et à l’exil. »