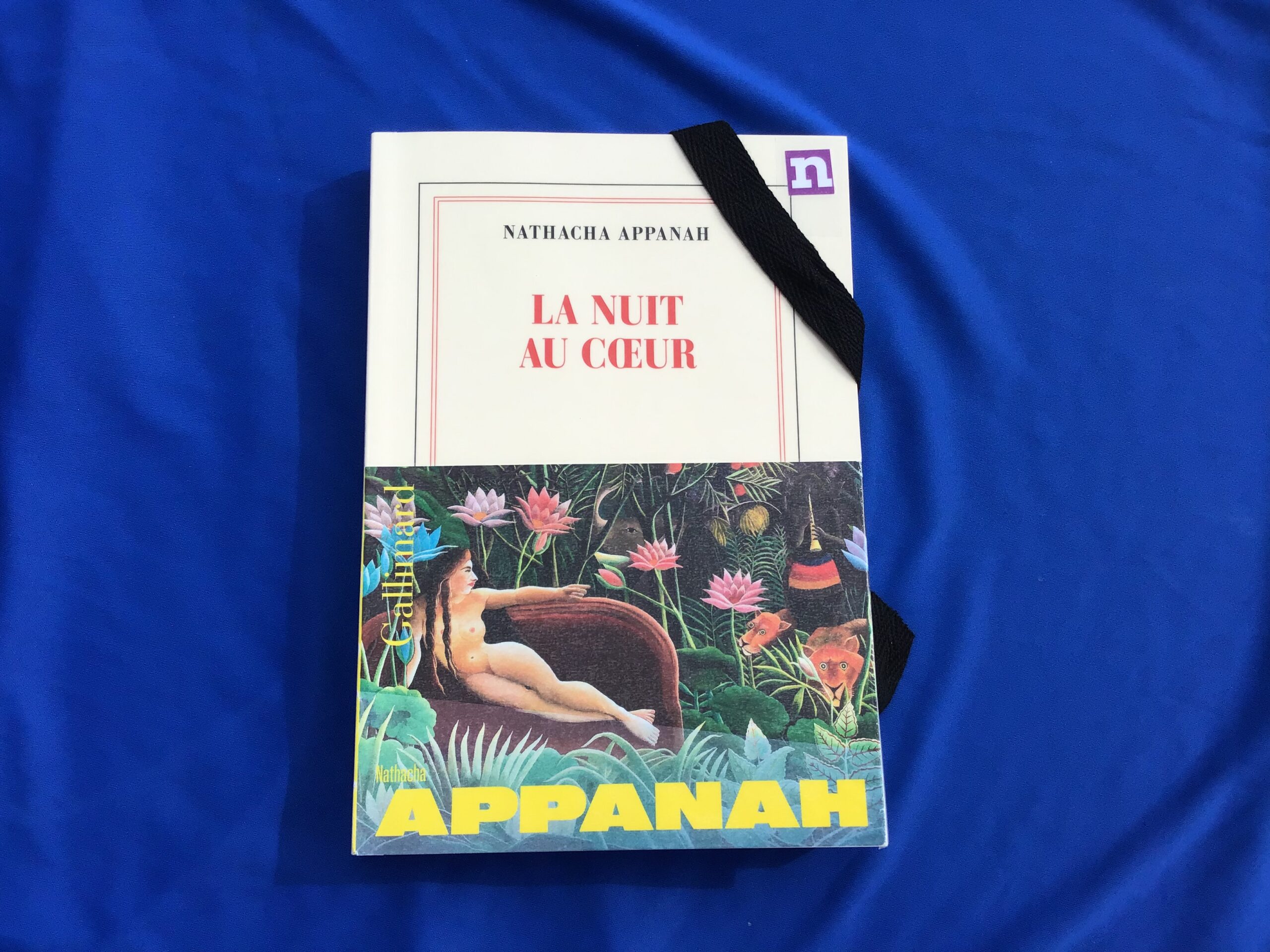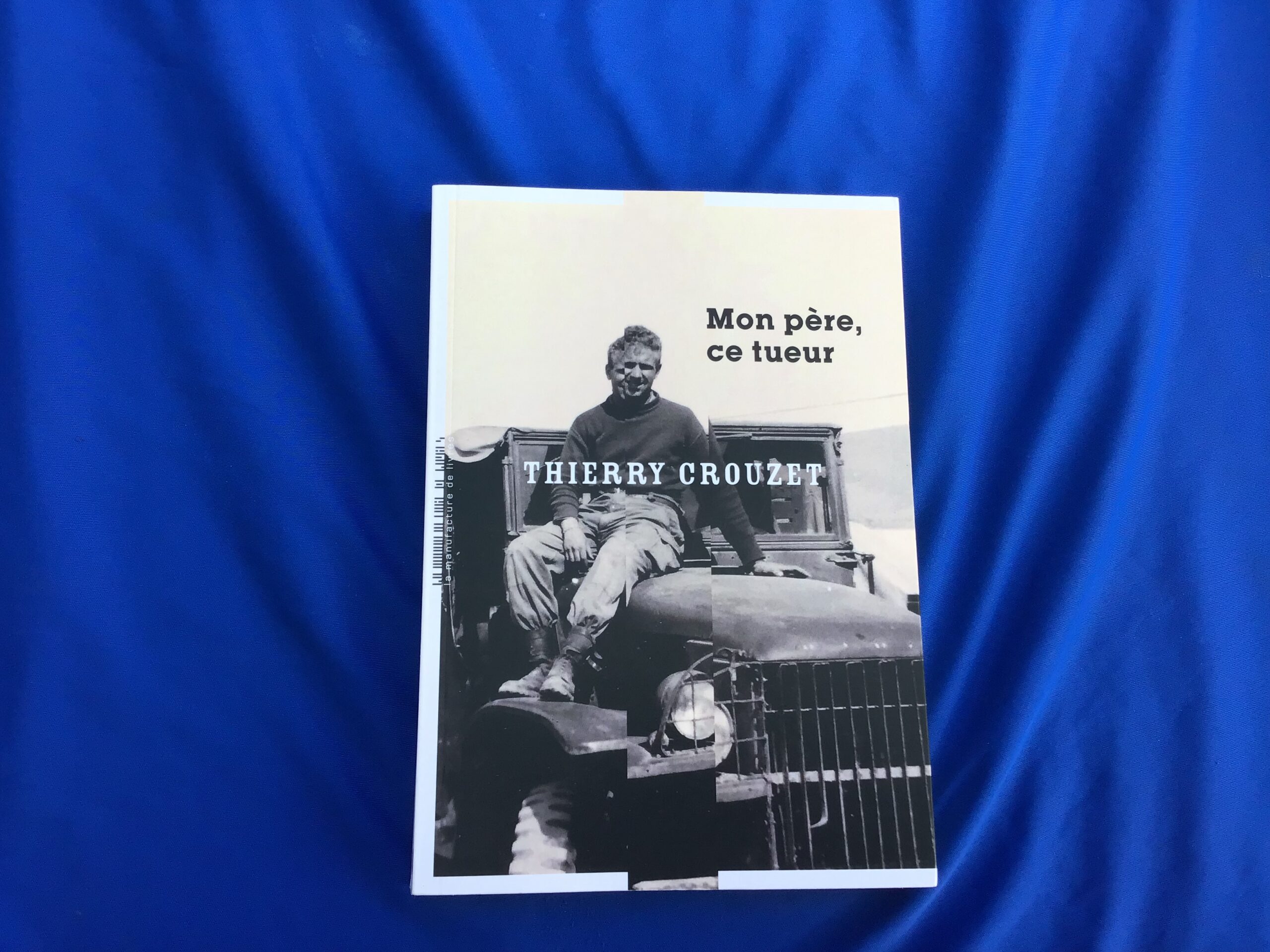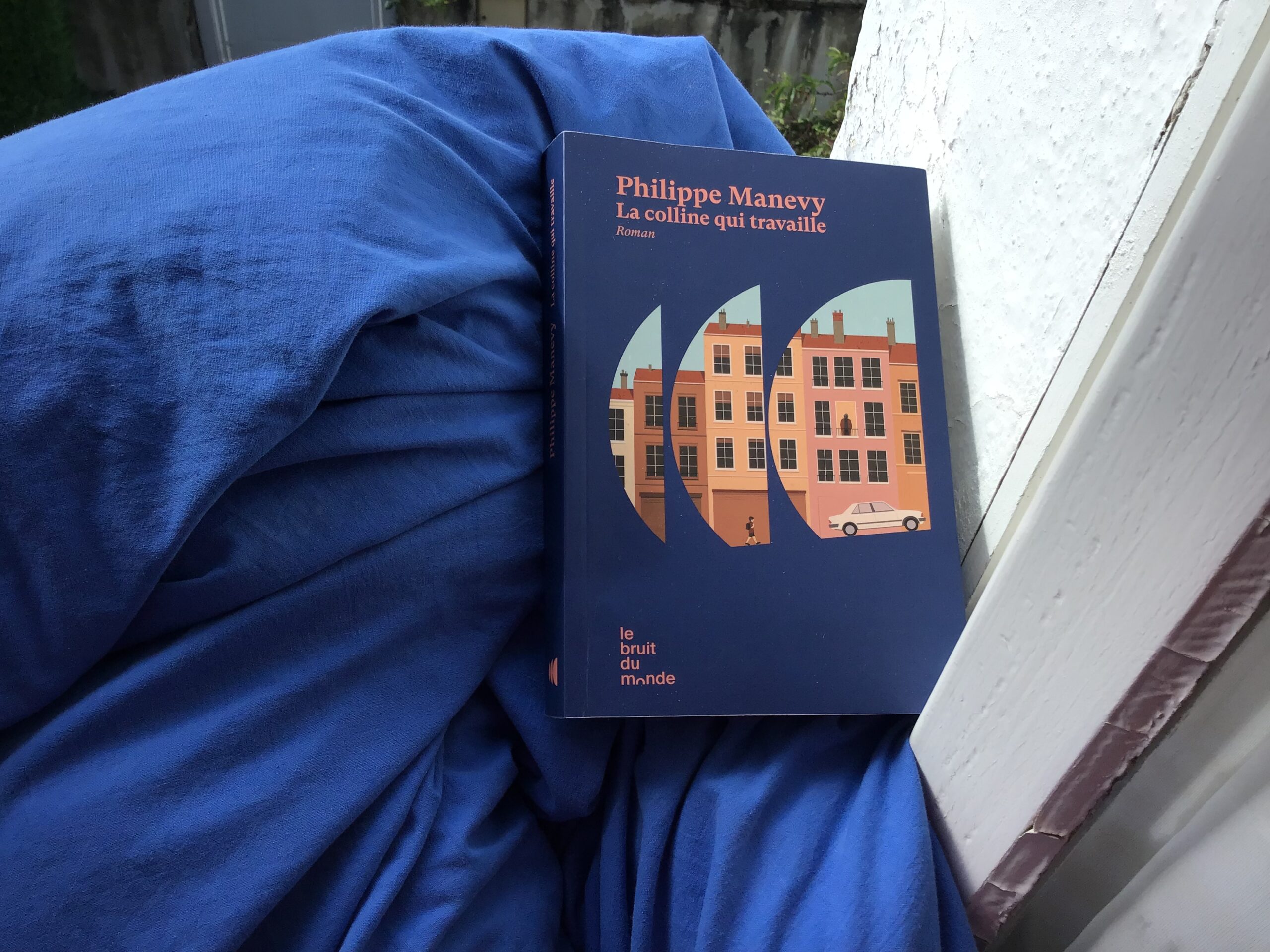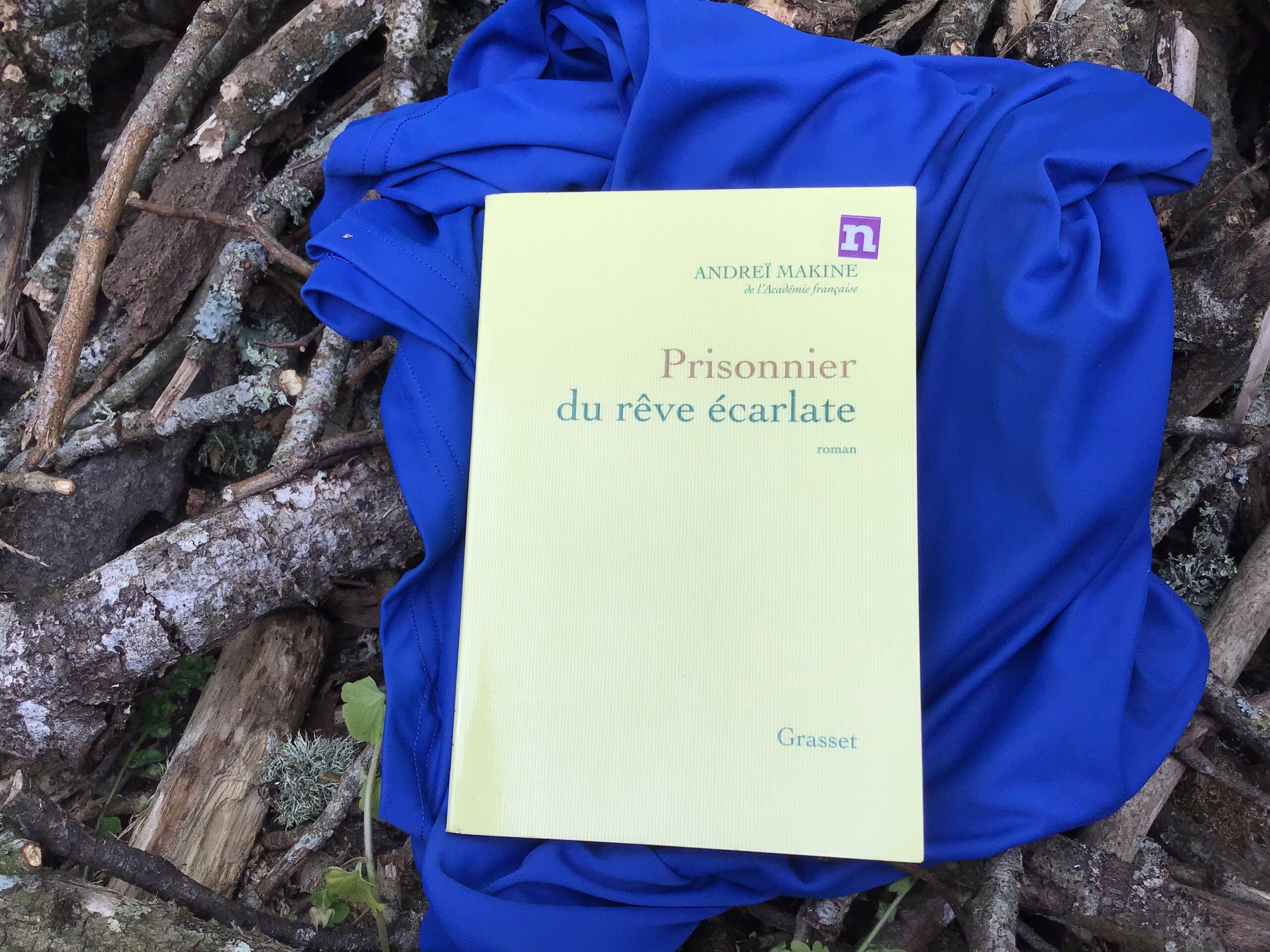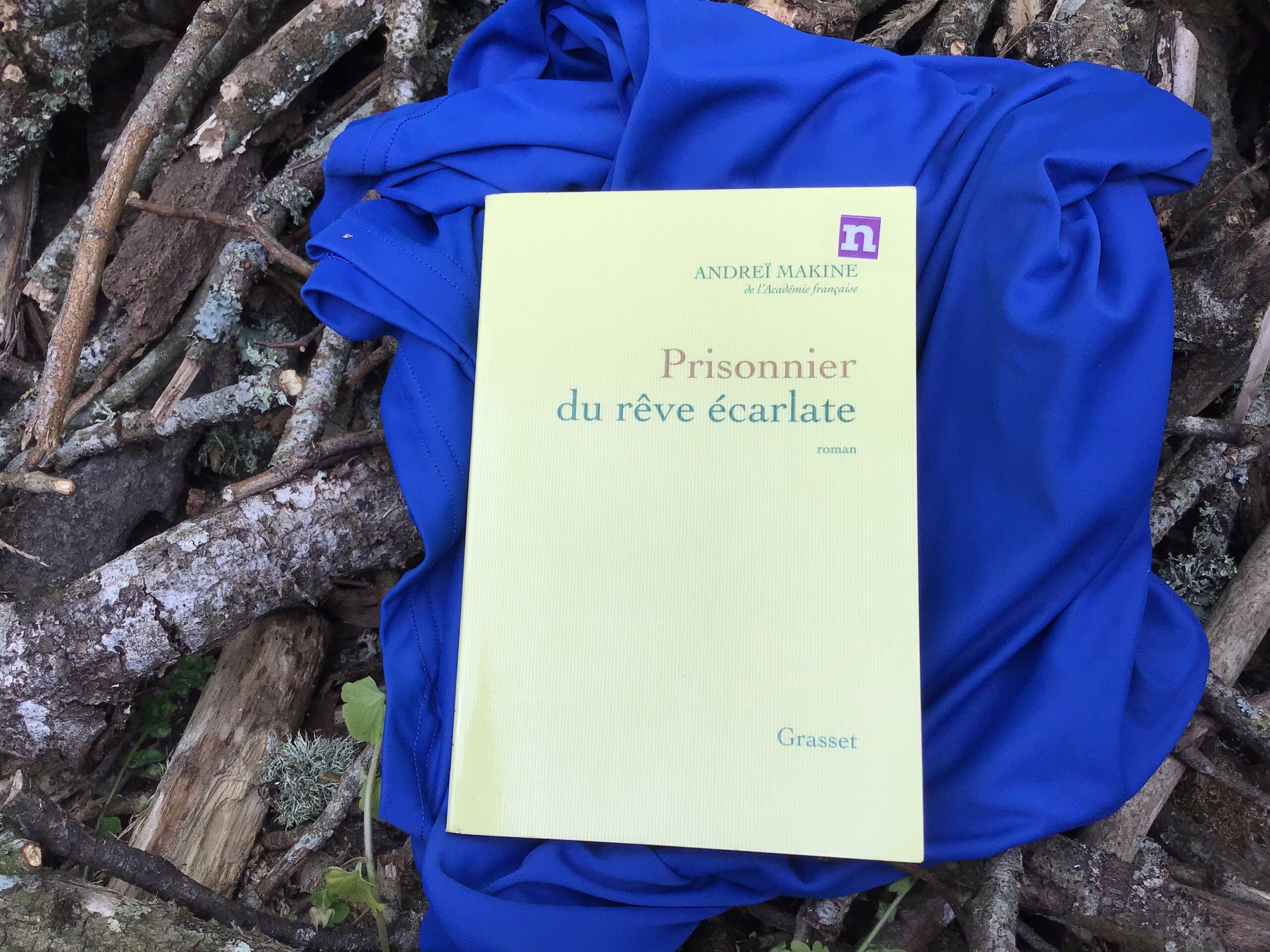
Éditions Grasset, 414 pages, janvier 2025.
Deux livres du même auteur à suivre, c’est un hasard mais qui montre aussi que j’aime beaucoup lire les romans de cet auteur dont voici la liste que vous trouverez sur luocine,
 Il m’arrive parfois d’avoir de légères réserves, cela vient aussi du choc qu’avait représenté pour moi, « le Testament français », ensuite j’ai trouvé qu’il se répètait un peu, mais cette critique est injuste car si chaque roman de cet auteur était le premier que je lisais de lui , je lui attribuerais à chaque fois 5 coquillages. Ce que je fais pour celui-ci.
Il m’arrive parfois d’avoir de légères réserves, cela vient aussi du choc qu’avait représenté pour moi, « le Testament français », ensuite j’ai trouvé qu’il se répètait un peu, mais cette critique est injuste car si chaque roman de cet auteur était le premier que je lisais de lui , je lui attribuerais à chaque fois 5 coquillages. Ce que je fais pour celui-ci.
On pourrait sous titrer ce roman « les multiples vies de Lucien Baert », l’ouvrier communiste de Douai. Car cet homme va connaître un destin très particulier, tout cela à cause d’un voyage que le partit communiste organise en 1939 en URSS, pour contrecarrer la propagande capitaliste qui dit que les ouvriers russes sont malheureux, très pauvres, et vivent sous la botte d’un dictateur Joseph Staline. La Russie de l’époque sait parfaitement organiser des voyages de propagande où des convaincus pas trop curieux voient ce qu’ils veulent bien voir. (Ma génération a bien connu cela avec les retours émerveillés des convaincus de la Chine maoïste en pleine révolution culturelle !) .
Lucien rate son train dans une gare isolée de Russie, ses amis repartent sans lui, commence alors sa seconde vie, celle d’un supposé espion français dans les geôles de Staline, comme la guerre est déclarée on envoie des « volontaires » que l’on sort du goulag se faire tuer sur le front. Au milieu des horreurs de cette guerre, un soldat russe comprend que tant que cet homme gardera une identité française, il ne sortira jamais du goulag , il lui propose de changer d’identité s’il meurt avant lui. Lucien commence alors une troisième vie sous l’identité de Matveï Belov condamné politique . Lucien-Matveï est pris par les allemands , torturé, puis repris par les soviétiques de nouveau torturé et remis au goulag pour y finir sa peine. lorsque le rapport Kroutchev dénonce les crimes de Staline le régime du goulag s’allège un peu, malheureusement pour lui , il participe à une révolte donc est condamné à quelques années de plus. Enfin libéré, il commence une vie de « russe ancien prisonnier » dans la Taïga avec Daria un femme qu’il sauve d’une mort atroce . Ensemble, ils mènent une vie simple et sont presque heureux . Mais son passé français le hante et Daria le pousse à retrouver ses racines. il parvient à se sauver sur un navire français. L’indifférence des touristes occidentaux qu’il cherche à aborder à Léningrad est caractéristique de l’égoïsme des touristes qui ne veulent en aucun cas l’aider. Il parvient finalement à fuir l’URSS grâce à un capitaine d’ un navire français.
Commence alors une troisième vie, cette d’un transfuge des camps qui va éclairer les intellectuels français sur la réalité soviétique. Après une période d’engouement, peu à peu Lucien Baert n’intéresse plus personne et lui sent qu’il perd pied dans ce monde si futile, il devient infréquentable et pour tout dire un peu fou. Il retournera en Russie pour y finir sa vie auprès de Daria sous le nom de Matveï Belov et connaitra l’horrible période où son pays est livré aux mafia qui ne cherchent qu’à s’enrichir par tous les moyens.
Cette traversée dans un demi-siècle de nos deux société est une plongée dans un désespoir sans fond, sauf sans doute la sincérité de gens simples qui ne veulent plus d’idéologie et qui essaient de se construire un monde heureux à leur portée sans illusion sur les valeurs humaines. La description de l’intelligentsia française est sans complaisance et malheureusement assez réaliste, la colère de Lucien à une de leur soirée est méritée mais va l’enfoncer un peu plus dans son isolement.
En refermant ce roman , je me suis demandé ce qui était préférable pour l’auteur : la force brutale des Russes ou l’hypocrisie lénifiante des intellectuels français . Je ne sais pas si ce roman répond à cette question mais en tout cas depuis , elle me hante et comme la force des Russes est de nouveau aux portes de l’Europe , elle me fait aussi très peur.
Extraits.
Début du prologue.
Écrasé sous le fardeau de sa vie un homme un fleur la miséricorde. Dieu le conduit à un amas où sont déposés les croix des destins. Le malheureux jette la sienne, en soulève une autre : non trop lourde ! Et celle-ci. ? Ah, pleine d’échardes ! La troisième, la suivante, encore une … Enfin, au coucher du soleil, la croix qu’il choisit lui paraît lisse et légère.
» Je la prends, elle ne pèse rien ! »
» C’est celle que tu portais ce matin », lui répond Dieu .
J’ai pensé à ce vieux conte en feuilletant un carnet qui, à travers la Russie répertoriait des dizaines de noms : les futurs héros d’un documentaire conçu par Stas Podlaski, un cinéaste « franco-polonais » a-t-il spécifié. Des amis communs m’ont demandé de jouer les guides.
Début du roman.
L’homme surgissait au soir, avançait sans hâte, mais ne se laissait pas approcher. Plus d’une fois, Matveï eut envie de le rejoindre, d’engager la conversation. La distance entre eux se réduisait, le vagabond semblait sur le point de se retourner. Et, soudain, il disparaissait au milieu des arbres.
» C’est dans ma tête, tout ça. Je suis crevé, je dors peu, alors je vois ce fantôme qui me tient compagnie… » se disait Matveï, s’efforçant de chasser une idée insidieuse : l’inconnu qui le précédait était… Son double !
La vision des prison russe en 1930 par les « bons » communistes français.
Elle cite le témoignage, dans « L’Humanité » , de Marie-Claude Vaillant Couturier qui vient de visiter Moscou : » Les condamnés en URSS touchent un salaire et peuvent tout acheter, sauf des boissons alcoolisées. Ils peuvent se payer une chambre individuelle, ils lisent, écrivent, voient des films, font de la musique… »
Les russes anciens prisonniers de guerre.
Il est envoyé non pas dans le camp où il était emprisonné avant la guerre, celui de l’Oural, mais plus à l’ouest, à la construction d’une voie ferrée à travers la taïga et les marécages.
Les raisons de poursuivre cette vie n’existent plus. Les moyens d’en finir sont abondants et le nombre de prisonniers qui se suicident le surprend. Souvent, ce sont d’anciens militaires qui ont eu le malheur comme lui d’avoir été arrêtés par les Allemands. Il connaît le verdict de Staline : « Je n’ai pas de soldats fait prisonniers. » Donc, capturé, on doit lutter et mourir.
Ce que savait l’Amérique du système totalitaire soviétique.
C’est à Boston qu’il fait un constat stupéfiant : un universitaire qui n’a jamais mis le pied en Russie est plus renseigné qu’un prisonnier ayant passé de longues années derrière les barbelés. Ce professeur lui parle comme s’il s’adressait à un étudiant un peu lent à comprendre. Julia traduit : » J’ai consacré mon doctorat au phénomène totalitaire et permettez-moi de vous signaler que dès les abus dès le début des années 30, les économistes américains, ignorant tout des camps soviétiques, en ont démontré la probable existence. Ils ont analysé le commerce des matières premières et les prix plus bas, qu’un simple « dumping », pratiquer par l’URSS. Cela supposait une main-d’œuvre quasi bénévole ou, plutôt, une masse d’ouvriers sans salaire. Bref un réservoir d’esclaves ! »
Lucien s’empresse de partager cet avis : c’est vrai un prisonnier ne coûtait pas cher, travaillait douze heures par jour et mourait vite, ce qui évitait les éventuels frais médicaux et, plus tard, le paiement d’une retraite.
L’érudition de ces « soviétologues » l’embarrasse : si grâce aux calculs financiers, on peut déduire l’existence des camps, a-t-on besoin des témoins comme lui ?
La fracture entre l’ancien prisonnier de Staline et des intellectuels parisiens.
Toujours muet, il sait qu’aucun témoignage ne pourra ébranler les jugements paresseux qui circulent dans ce salon. Un récit s’égrène en lui : ses camarades des unités disciplinaires, les attaques qui ne laissaient que quelques survivants. Des visages qui disparaissaient avant qu’on puisse retenir leurs traits, des aveux dont le souvenir continuait à résonner en lui, sans qu’il sache qui les avait prononcés. Et d’autres visages, impossibles à reconnaître car trop défigurés par les blessures comme celui de Martveï Bélov. Et les débris des corps qui s’enlaçaient, mêlant leurs entrailles. Et ce cri « Pour la Patrie pour Staline ! », sortant des poumons de ceux qui haïssaient Staline mais qui, se jetant à l’assaut n’avait que ce cri pour défier la mort.
Ses mots silencieux expriment un constat qu’il pourrait adresser aux invités : si vous êtes tranquillement assis dans ce beau salon, c’est grâce au jeune Altaï qui refusait de tuer ses semblables, même s’ils étaient allemands. Et aussi grâce à un soldat qui avant de mourir m’a offert son identité. Vous pouvez mener vos causeries d’intellos, désigner les ennemis du progrès, jouer à vos petites révolutions culturelles ou sexuelles, écrire dans vos journaux qui censurent tout ce qui ne vous plaît pas. Oui, c’est grâce à ce disciplinaire au visage arraché que vous pouvez boire, manger, fumer vos clopes qui endorment toute vérité gênante et puis aller copuler, à deux ou à plusieurs puisque la vie vous doit cela. Mais vous n’êtes pas des gagnants, non car vous êtes très laids. D’une laideur incurable ! En vivant, en mentant, en baisant comme vous le faites, on vit sans aimer… Donc on ne vit pas !
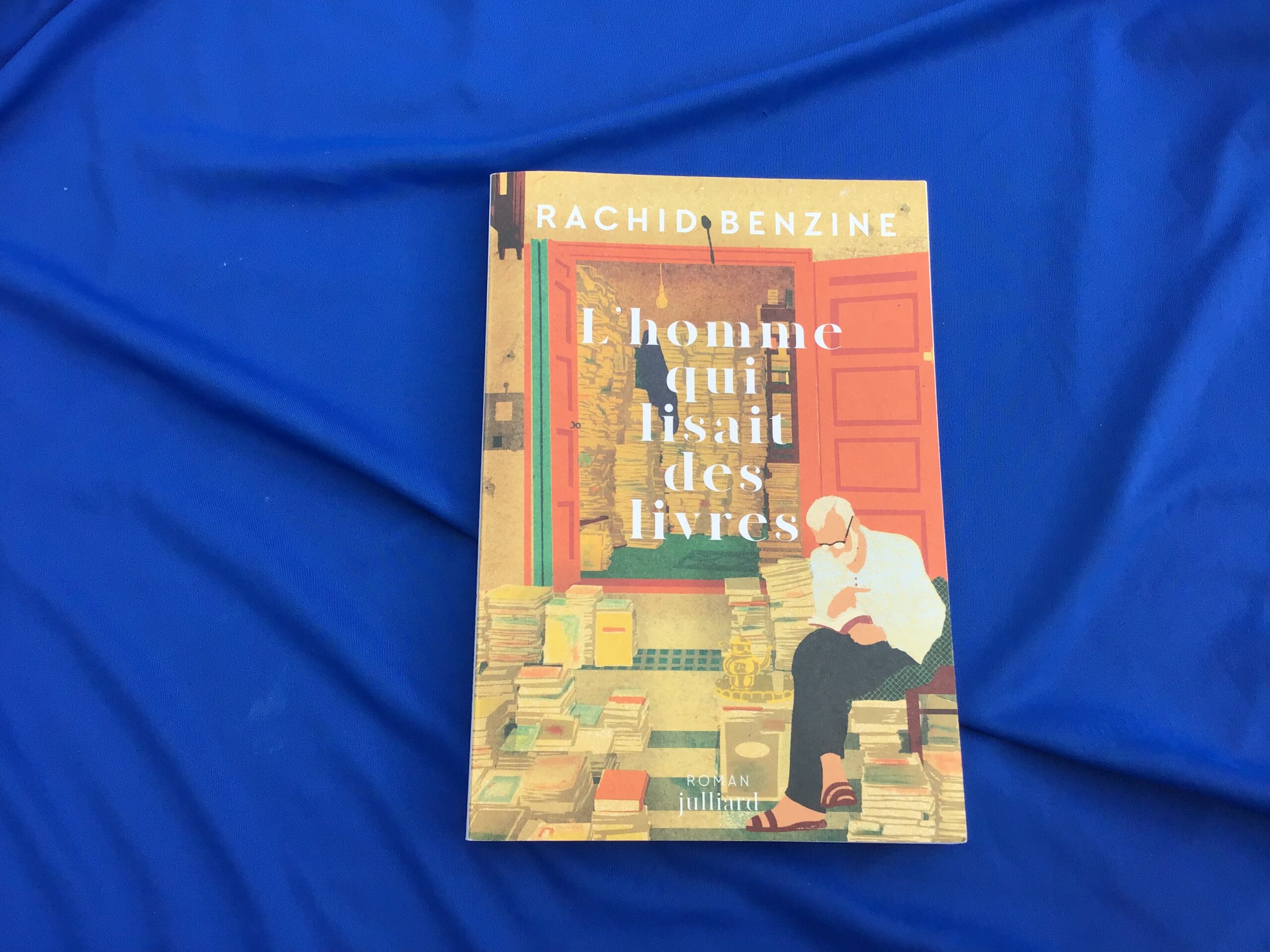
 Ce court roman, a plus l’allure d’un conte que d’un témoignage réaliste sur la condition d’une famille palestinienne. L’auteur dans un style très épuré, exprime la souffrance de tout un peuple qui a été victime de la création de l’état d’Israël. La famille doit quitter son village d’origine en 1947 pour arriver dans un premier camp Aqabat Jabr, puis revient à Gaza où elle peut passer quelques années presque heureuses. Mais évidemment on connaît la suite.
Ce court roman, a plus l’allure d’un conte que d’un témoignage réaliste sur la condition d’une famille palestinienne. L’auteur dans un style très épuré, exprime la souffrance de tout un peuple qui a été victime de la création de l’état d’Israël. La famille doit quitter son village d’origine en 1947 pour arriver dans un premier camp Aqabat Jabr, puis revient à Gaza où elle peut passer quelques années presque heureuses. Mais évidemment on connaît la suite.