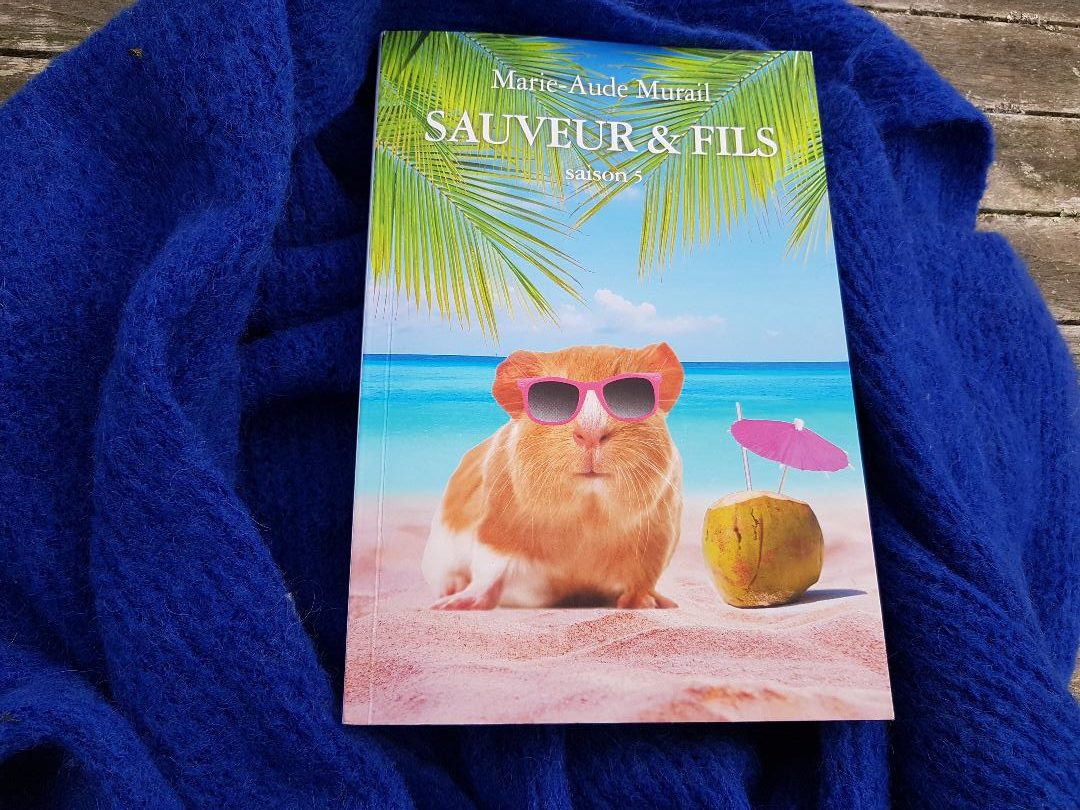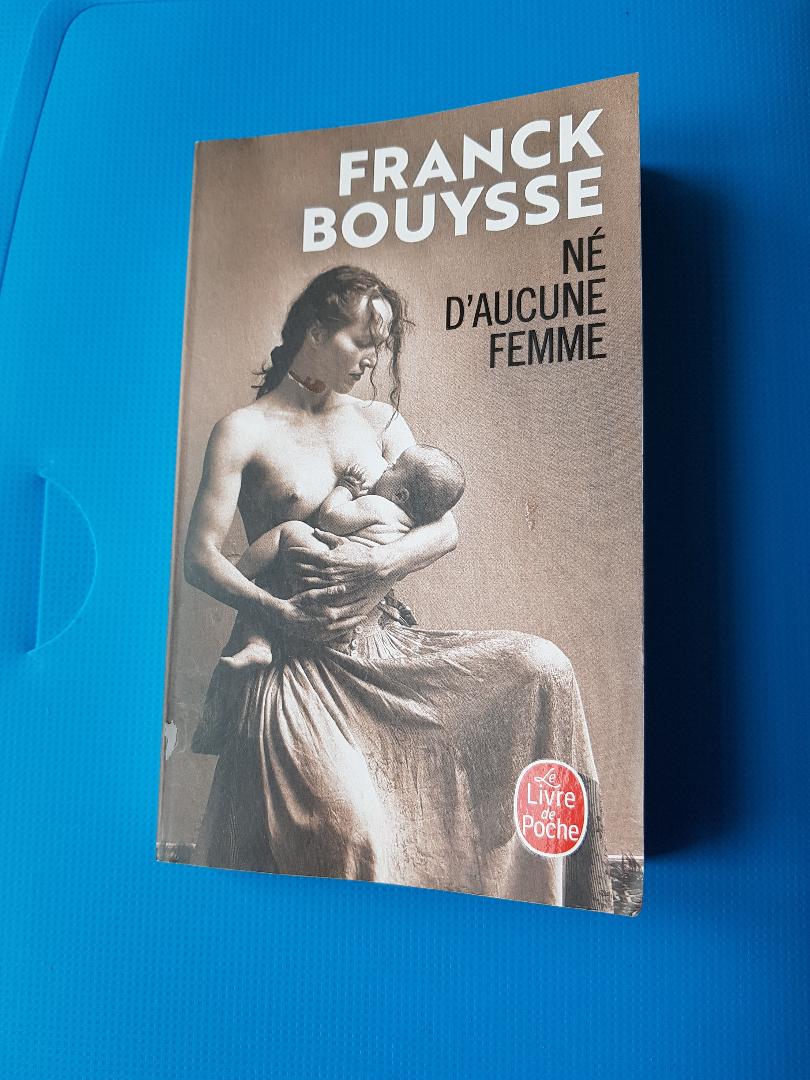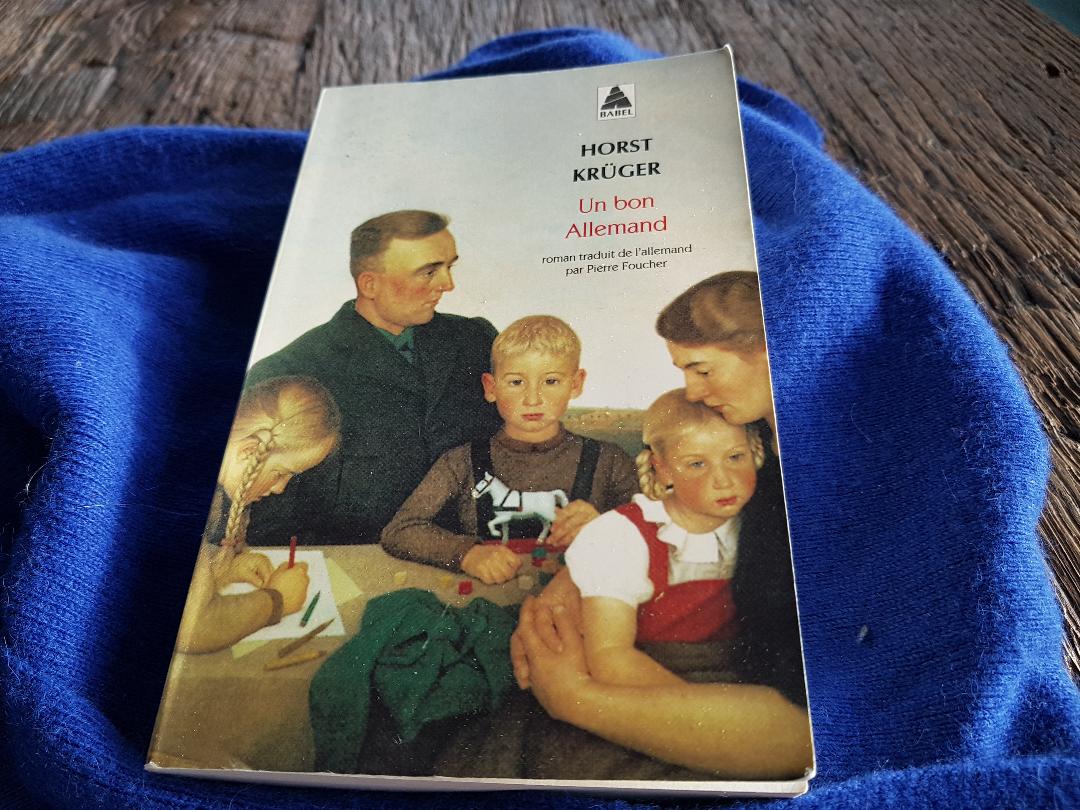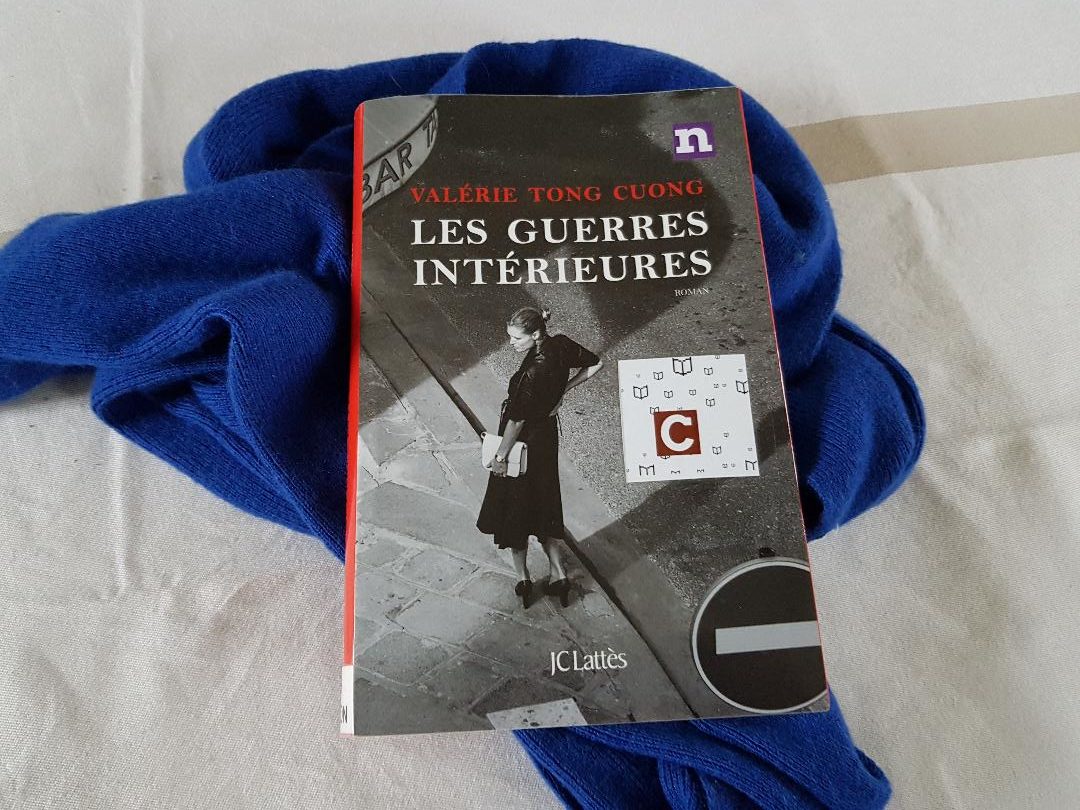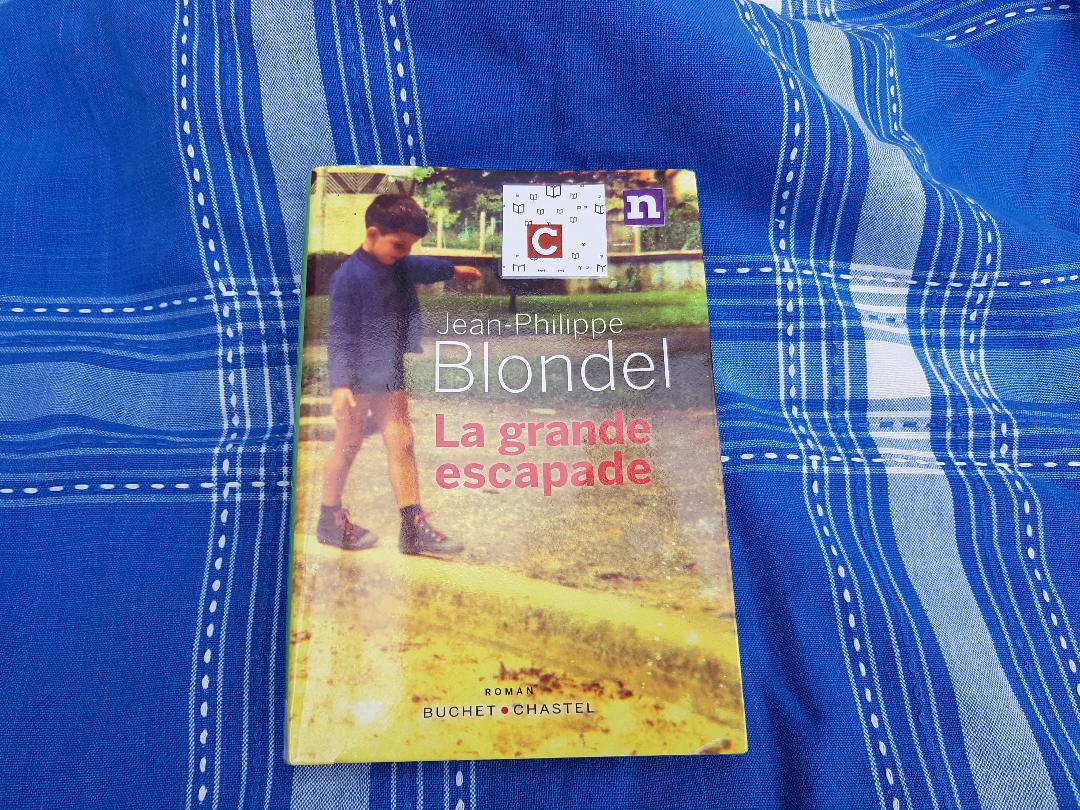Traduit de l’anglais (États -Unis) par Vincent Raynaud, Édition Globe.
 Je mets rarement les livres de ma liseuse sur mon blog car je pense que j’aurais toujours le temps de le faire et puis j’oublie car ils sont toujours à mes côtés. C’est un peu les cas de « Hillbilly élégie ». D’abord je dois dire que le titre m’étonne, autant je trouve que cet essai décrit très bien cette population regroupée sous le nom de « Hillbilly » autant je ne trouve aucun caractère élégiaque à ce récit. Sauf, et c’est sans doute l’explication du titre, l’incroyable ténacité de ses grands-parents à qui il doit tout. D’ailleurs il leur adresse ce livre
Je mets rarement les livres de ma liseuse sur mon blog car je pense que j’aurais toujours le temps de le faire et puis j’oublie car ils sont toujours à mes côtés. C’est un peu les cas de « Hillbilly élégie ». D’abord je dois dire que le titre m’étonne, autant je trouve que cet essai décrit très bien cette population regroupée sous le nom de « Hillbilly » autant je ne trouve aucun caractère élégiaque à ce récit. Sauf, et c’est sans doute l’explication du titre, l’incroyable ténacité de ses grands-parents à qui il doit tout. D’ailleurs il leur adresse ce livre
Pour Mamaw et Papaw, mes Terminators à moi
Dans son introduction, il explique très bien qu’il est exceptionnel, non parce qu’il est diplômé de Yale, mais parce qu’il vient de la « Rust-Belle » c’est à dire d’une région de l’Ohio qui produisait autre fois de l’acier et qui maintenant est peuplée de gens dans la misère des petits boulots ou du chômage. Cet essai m’a permis de rencontrer une partie de la population américaine que l’on ne connaît pas très bien. Issues de l’émigration écossaise et irlandaise, ces familles très soudées se sont regroupées dans cette région autour des aciéries nord américaines. Ces usines demandaient des hommes forts et résistants à la fatigue et la souffrance au travail. On voit très bien le genre de personnalités masculines que cela pouvait engendrer. Aujourd’hui, il n’y a plus d’aciéries et il ne reste que la misère et les mauvais comportements. Mais aussi un esprit clanique qui empêche les « Hillbilly » de partir dans des régions où l’on trouve du travail. J.D Vance est issue d’une de ces familles , et il est très bien placé pour nous décrire ce qui détruit ce groupe social. Sa mère est dépassée par la misère, les nombreux maris et la drogue, il lui reconnaît une qualité : elle a toujours choisi des hommes qui étaient gentils avec les enfants. J.D n’a donc pas été maltraité par ses nombreux beaux-pères. Mais ce qui l’a sauvé de la répétition du modèle parental, c’est la stabilité que lui a offert le foyer de ses grands-parents. Pour lui, la clé de la défaite et le plongeon dans la misère c’est l’instabilité du foyer et la clé du sauvetage c’est au contraire un foyer stable où l’enfant peut trouver des modèles sur lesquels s’appuyer pour affronter les différentes difficultés de la vie en particulier l’école. Venant de ce milieu très pauvre et violent, il peut en décrire les rouages de l’intérieur. Une idée qui revient souvent chez lui, c’est l’importance de prendre conscience que l’individu fait des choix : avoir un bébé sans avoir fini l’école c’est un choix, prendre de la drogue c’est un choix, frapper un enfant c’est un choix … Mais plus que tout offrir à un enfant un milieu stable l’aidera à se construire, car tous les pièges du déclassement social sont là juste derrière la porte de son foyer : l’alcool, le chômage, la violence, la drogue, l’échec scolaire… Si aucun adulte n’a eu confiance dans le jeune alors il tombera certainement, dans ces pièges. (Et pourront alors devenir le héros des romans sur les déclassés des USA que certains d’entre nous aimons tant !)
Pourquoi n’ai-je mis que trois coquillages ? Car j’ai trouvé le livre répétitif , la vie et l’amour de ses grands parents sont vraiment très touchants et m’ont beaucoup intéressée et même si je comprends bien que J.D Vance ait été obligé de passer par une description minutieuse du milieu des « Hillbilly »pour nous faire comprendre, à la fois, d’où il venait et pourquoi, il est le seul de sa communauté à être sorti de Yale, c’est très (trop, pour moi !) long .
Et depuis j’ai lu les billets de Ingamic qui pour des raisons différentes a aussi quelques réserves sur ce livre. De Kathel et de Keisha .
Citations
Sa famille
Pour employer un euphémisme, j’ai une relation « compliquée » avec mes parents, dont l’un s’est battu toute sa vie ou presque contre une forme d’addiction. Ce sont mes grands-parents qui m’ont élevé. Aucun d’eux n’a terminé le lycée et très peu de gens dans ma famille, même élargie, sont allés à l’université. Les statistiques le prouvent : les gosses comme moi sont promis à un avenir sombre. S’ils ont de la chance, ils parviendront à ne pas se contenter du revenu minimum, et s’ils n’en ont pas ils mourront d’une overdose d’héroïne – comme c’est arrivé à des dizaines de personnes la seule année dernière, dans la petite ville où je suis né.
Le contexte social
Au contraire, je me reconnais dans les millions de Blancs d’origine irlando-écossaise de la classe ouvrière américaine qui n’ont pas de diplômes universitaires. Chez ces gens-là, la pauvreté est une tradition familiale -leurs ancêtres étaient des journaliers dans l’économie du Sud esclavagiste, puis des métayers, des mineurs, et, plus récemment, des machinistes et des ouvriers de l’industrie sidérurgique. Là où les Américains voient des « Hilliliies », des « Rednecks » ou des « Whiste trash », je vois mes voisins, mes amis, ma famille.
Sa ville
Près d’un tiers de la ville, environ la moitié de la population locale, vit sous le seuil de pauvreté. Et la majorité des habitants, elle, juste au-dessus. L’addiction aux médicaments s’est largement diffusée, les gens se les procurent sur ordonnance. Les écoles publiques sont si mauvaises que l’État du Kentucky en a récemment pris le contrôle. Les parents y mettent leurs enfants parce qu’ils n’ont pas les moyens de les scolariser ailleurs. De son côté, le lycée échoue de façon alarmante à envoyer ses élèves à l’université. Les habitants sont en mauvaise santé et, sans les aides du gouvernement, ils ne peuvent même pas soigner les maladies courantes. Plus grave encore, cette situation les rend aigris – et s’ils hésitent à se confier aux autres, c’est simplement parce qu’ils refusent d’être jugés.
Exemple sordide
J’étais en première quand notre voisine Pattie téléphona à son propriétaire pour lui demander de faire réparer des fuites d’eau du plafond de son salon. Lorsque celui-ci se présenta, il trouva Pattie seins nus, défoncée et inconsciente sur son canapé. À l’étage, la baignoire débordait – d’où les fuites. Visiblement, elle s’était fait couler un bain, avait avalé des cachets puis était tombée dans les vapes. Le sol de l’étage était endommagé, ainsi qu’une partie des biens de la famille. Voilà le vrai visage de notre communauté : une junkie à poil qui bousille le peu de chose qu’elle possède. Des enfants qui n’ont plus ni jouets ni vêtements à cause de l’addiction de leur mère.
Son cas personnel
Je ne dis pas que les capacités ne comptent pas. Elles aident, c’est certain. Mais comprendre qu’on s’est sous estimé soi-même est une sensation puissante – que votre esprit a confondu incapacité et efforts insuffisants. C’est pourquoi, chaque fois qu’on me demande ce que j’aimerais le plus changer au sein de la classe ouvrière blanche, je réponds : « Le sentiment que nos choix n’ont aucun effet. » Chez moi, les marines ont excisé ce sentiment comme un chirurgien retire une tumeur.
Tu peux le faire tout donner
Faire des choix
Quand les temps étaient durs, quand je me sentais submergé par le tumulte et le drame de ma jeunesse, je savais que des jours meilleurs m’attendaient, puisque je vivais dans un pays qui me permettrait de faire les bons choix, choix que d’autres n’auraient pas à leur disposition. Aujourd’hui, lorsque je pense à ma vie et à tout ce qu’elle a de réellement extraordinaire – une épouse magnifique, douce et intelligente, la sécurité financière dont j’avais rêvé enfant, des amis formidables et une existence pleine de nouveautés –, je me sens plein de reconnaissance pour les États-Unis d’Amérique. Je sais, ça sonne ringard, mais c’est ce que j’éprouve.
La classe populaire la désinformation et la presse
Certaines personnes pensent que les Blancs de la classe ouvrière sont furieux ou désabusés à cause de la désinformation. À l’évidence, il existe une véritable industrie de la désinformation, composée de théoriciens conspirationnistes et d’extrémistes notoires, qui racontent les pires idioties sur tous les sujets, des prétendues croyances religieuses d’Obama à l’origine de ses ancêtres. Mais les grands médias, y compris Fox News, dont la malignité n’est plus à démontrer, ont toujours dit la vérité sur la citoyenneté d’Obama et sa religion. Les gens que je connais savent pertinemment ce que disent les grands médias en la matière. Simplement, ils ne les croient pas. Seuls 6 % des électeurs américains pensent que les médias sont « tout à fait dignes de confiance ». Pour beaucoup d’entre nous, la liberté de la presse – ce rempart de la démocratie américaine – n’est que de la foutaise. Si on ne se fie pas à la presse, qui reste-t-il pour réfuter les thèses conspirationnistes qui envahissent sans partage Internet. Barack Obama est un étranger qui fait tout ce qu’il peut pour détruire notre pays. Ce que les médias nous disent est faux. Dans la classe ouvrière blanche, beaucoup ont une vision très négative de la société dans laquelle ils vivent. Voici
La liste est longue. Impossible de savoir combien de gens croient à une ou plusieurs de ces histoires. Mais si un tiers de notre communauté met en doute la nationalité du président – malgré d’innombrables preuves –, il y a tout lieu de penser que d’autres thèses conspirationnistes sont elles aussi à l’oeuvre. Ce n’est pas du simple scepticisme libertarien à l’égard des pouvoirs publics, sain dans toute démocratie. Il s’agit d’une profonde défiance à l’encontre des institutions de notre pays, qui gagne le cœur de la société.
Changement de classe sociale
Nous vantons les mérites de la mobilité sociale, mais elle a aussi son revers. Celle-ci implique nécessairement une forme de mouvement – vers une vie meilleure, en principe –, mais aussi un éloignement de quelque chose. Or on ne choisit pas toujours les éléments dont on s’éloigne.
Conséquences d’une enfance difficile
Ceux qui ont subi de multiples expériences négatives de l’enfance ont une plus forte probabilité d’être victimes d’anxiété et de dépression, d’avoir des maladies cardiaques, d’être obèses et de souffrir de certains cancers. Ils ont aussi une plus forte probabilité de connaître des difficultés à l’école et de ne pas réussir à avoir des relations stables à l’âge adulte. Même le fait de trop crier peut miner le sentiment de sécurité chez un enfant, affaiblir sa santé mentale et entraîner à l’avenir des problèmes de comportement.
 Chacun ses doudoux ! quand je trouve que le monde va mal et qu’un fond de tristesse m’envahit, je cours chez Sauveur Saint-Yves et pour moins de quarante cinq euros et un peu plus d’une heure de consultation, ce thérapeute me redonne confiance dans l’humain. Je sais que cette série d’adresse aux adolescents ce que je ne suis plus depuis si longtemps et que j’ai déjà fait deux billets à propos de cette série (sur le « un » et le « deux« ) . Mais la période est franchement pas folichonne et donc je régresse avec une joie non dissimulée. D’autant plus facilement que Noukette et Jérôme se sont ligués pour avoir trouvé chez cette auteure leur dose de réconfort. Ils parlaient de la saison 6 mais peu importe, on y trouve toujours de quoi sourire et s’attacher aux personnages. J’aurais peut être dû acheter la six , car j’ai été un tout petit peu déçue. Le premier et le deuxième tome m’avaient complètement séduite, là, je suis un peu restée en dehors des récits et même des personnages que je connais trop bien maintenant. Ce n’est qu’une légère critique pour un ado cela sera parfait mais pour la grand mère d’un ado, il lui en faut sans doute un peu plus pour soulever le morosité ambiante.
Chacun ses doudoux ! quand je trouve que le monde va mal et qu’un fond de tristesse m’envahit, je cours chez Sauveur Saint-Yves et pour moins de quarante cinq euros et un peu plus d’une heure de consultation, ce thérapeute me redonne confiance dans l’humain. Je sais que cette série d’adresse aux adolescents ce que je ne suis plus depuis si longtemps et que j’ai déjà fait deux billets à propos de cette série (sur le « un » et le « deux« ) . Mais la période est franchement pas folichonne et donc je régresse avec une joie non dissimulée. D’autant plus facilement que Noukette et Jérôme se sont ligués pour avoir trouvé chez cette auteure leur dose de réconfort. Ils parlaient de la saison 6 mais peu importe, on y trouve toujours de quoi sourire et s’attacher aux personnages. J’aurais peut être dû acheter la six , car j’ai été un tout petit peu déçue. Le premier et le deuxième tome m’avaient complètement séduite, là, je suis un peu restée en dehors des récits et même des personnages que je connais trop bien maintenant. Ce n’est qu’une légère critique pour un ado cela sera parfait mais pour la grand mère d’un ado, il lui en faut sans doute un peu plus pour soulever le morosité ambiante.