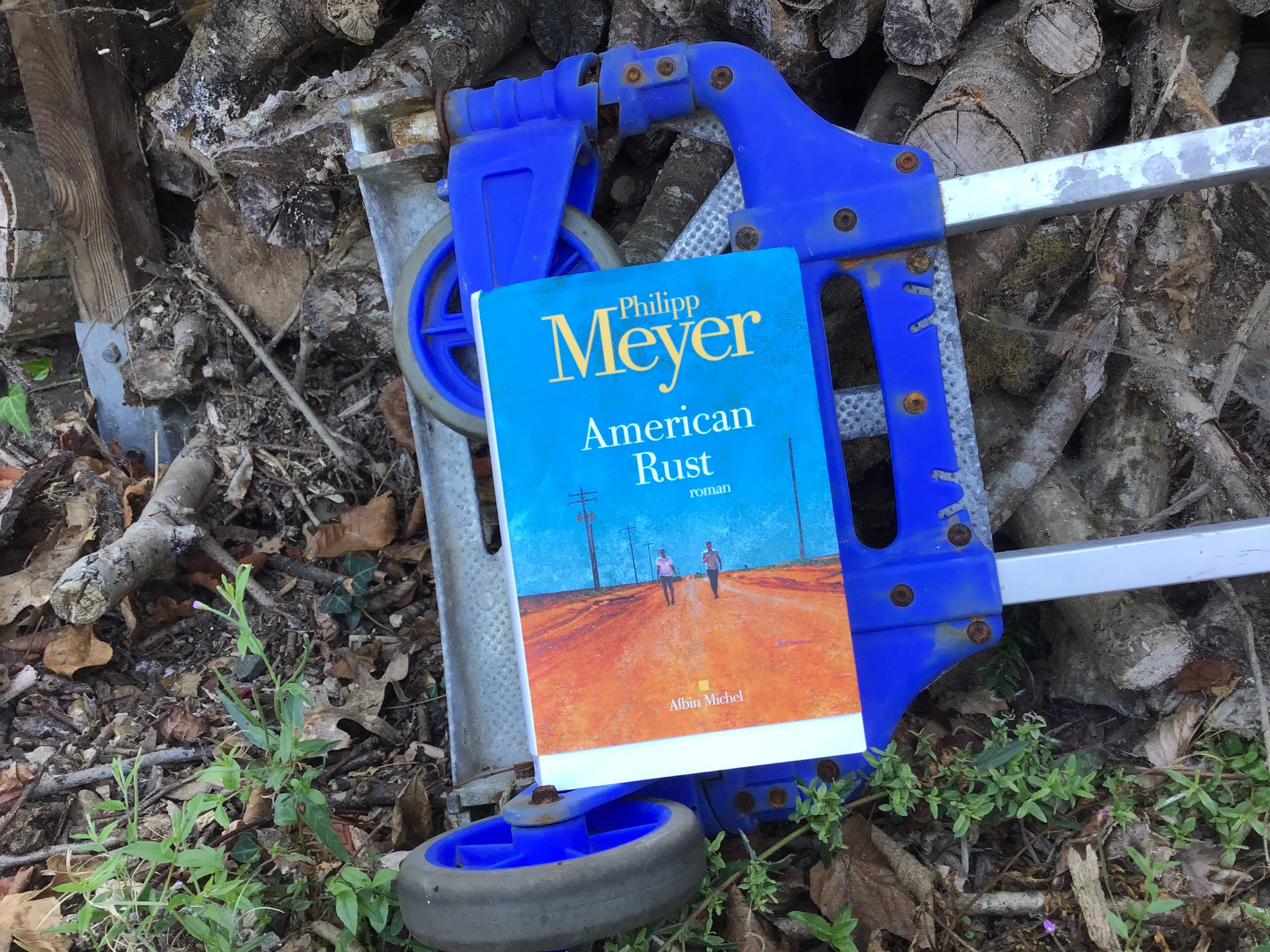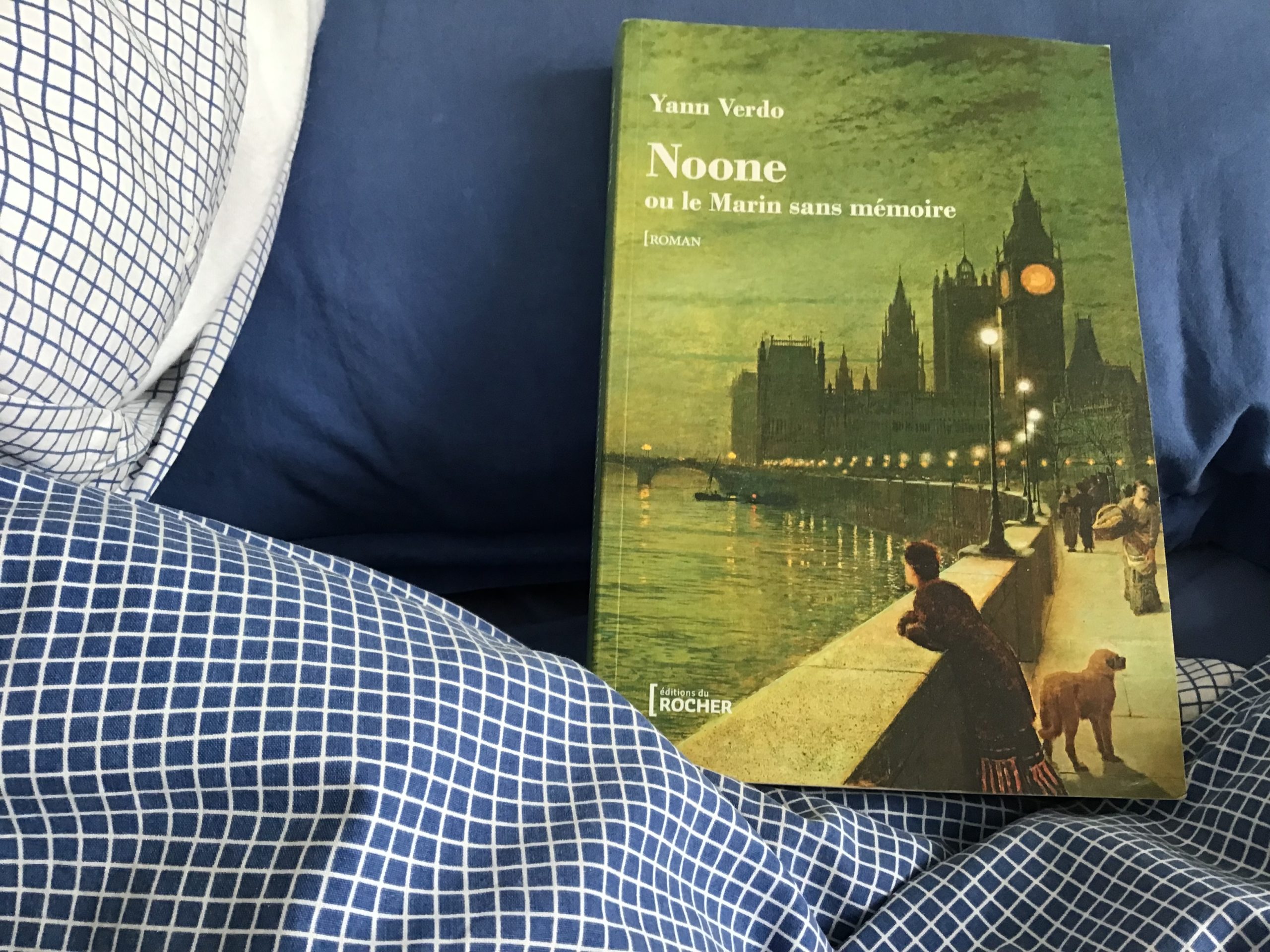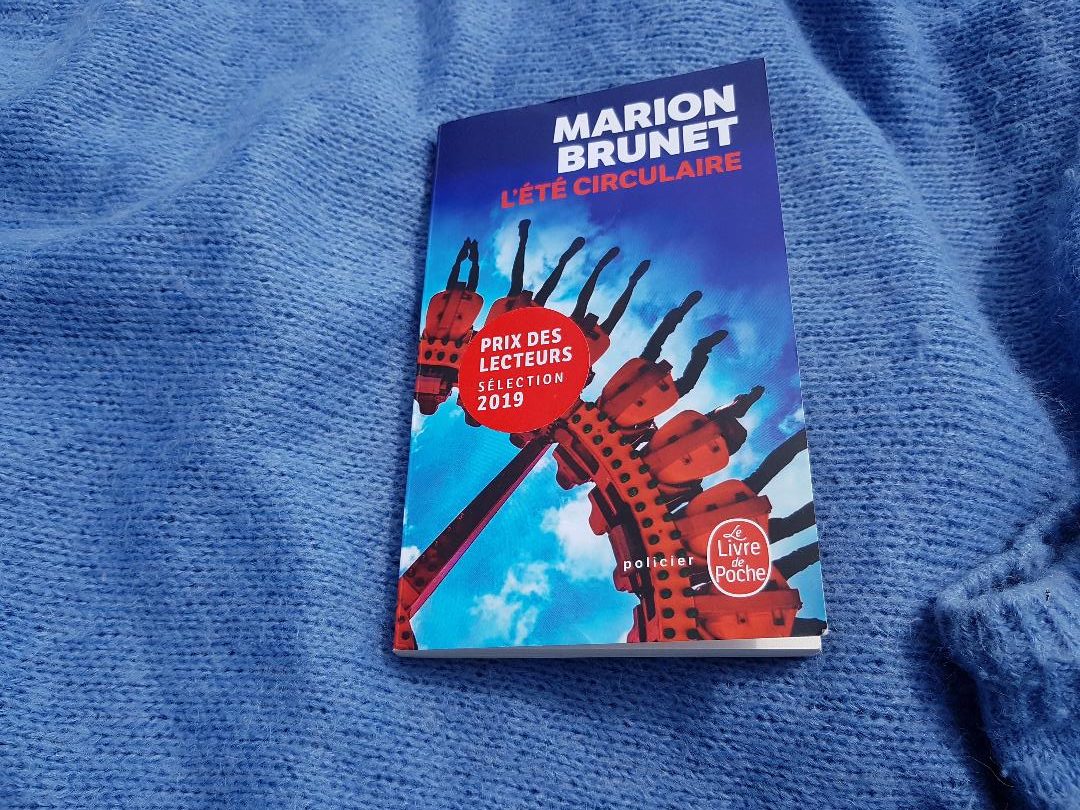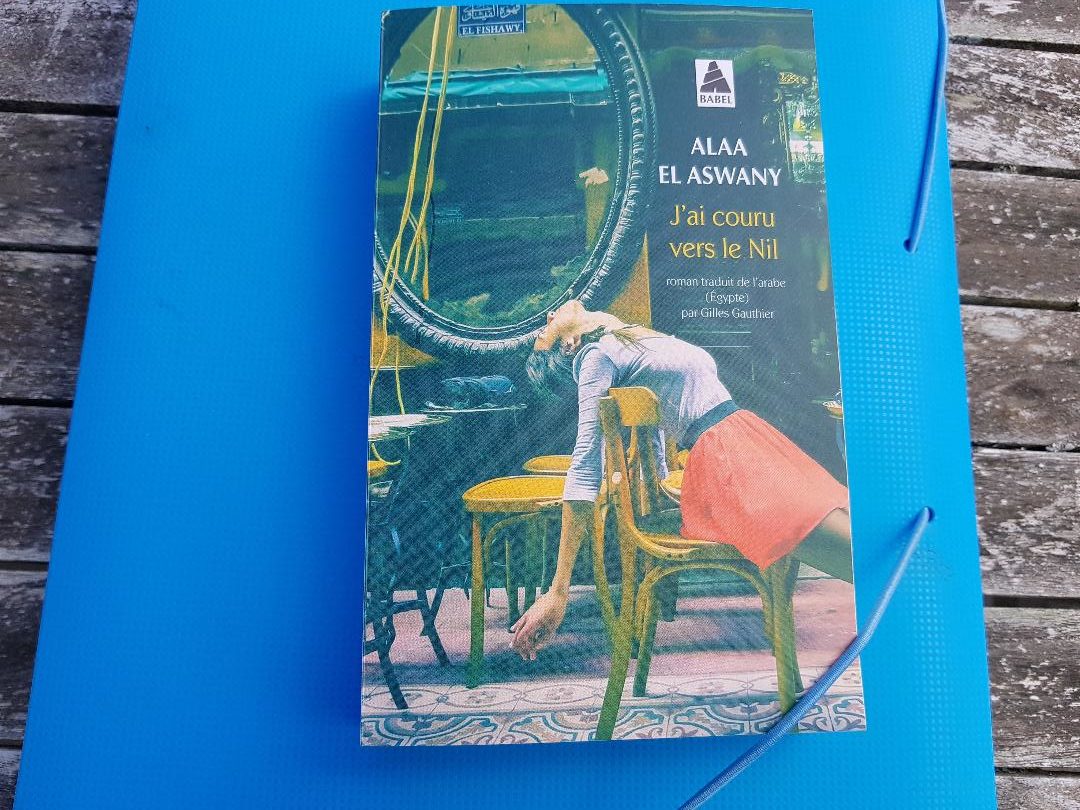Édition du Rocher
Lu dans le cadre du club de lecture de la médiathèque de Dinard
parole d’un résident d’un Ehpad
« C’est long de mourir. »
 Un bol de bonne humeur, des sourires à gogo et même un éclat de rire. Et aussi, des moments d’une grande sensibilité et d’émotion. Au milieu de livres tragiques celui-ci m’a fait un bien fou.
Un bol de bonne humeur, des sourires à gogo et même un éclat de rire. Et aussi, des moments d’une grande sensibilité et d’émotion. Au milieu de livres tragiques celui-ci m’a fait un bien fou.
Peut-être avez vous entendu parler du célèbre arnaqueur Victor Lustig qui s’est vanté d’avoir vendu la Tour Eiffel à un riche ferrailleur Parisien. Il serait l’ancêtre du narrateur Thomas Poisson. La quête vers cet ancêtre peu glorieux permet à l’auteur de nous décrire des français contemporains. Ceux qui, avec un gilet jaune, ont occupé les ronds points de la France en 2018. Thomas Poisson est au chômage depuis peu et fréquente la médiathèque de sa ville. Là il rencontre Frankie qui a eu le malheur de changer une roue en pleine manifestation des gilets jaune et qui a eu du mal à expliquer à la police ce qu’il faisait un cric à la main devant les forces de l’ordre. Il y a aussi Mansour ce fils de harki . Le récit de la vie de son père est un des moments d’émotion que j’évoquais au début de mon billet. Il y a aussi Françoise qui fait les meilleures confiture que Valentin, le fils de Thomas, n’ait jamais goûtées. Elle aime bien être sur les ronds points car elle s’y sent moins seule que chez elle. Enfin, il y a le père de Thomas qui termine sa vie en Ehpad.
Et puis il y a Carine, sa femme qui supporte de plus en plus mal les maladresses de son mari. Tous ces personnages forment un groupe humain que nous rencontrons tous les jours, dont nous faisons sans doute partie, cela fait du bien de passer du temps avec eux sous la plume d’un auteur qui a tant de compassion pour ses contemporains. Ce n’est peut-être pas le roman du siècle, mais un livre qui fait tant de bien, que je lui ai finalement mis cinq coquillages pour partager avec vous ce petit moment de bonheur.
Citations
Le talent des bibliothécaires.
Une scène à faire douter un malentendant du bon fonctionnement de son sonotone. Je me suis dit que la formation des bibliothécaires devait les préparer à cela. Une aptitude validée par un examen, j’imagine, ou les épreuves consistent en une mise en situation de communication silencieuse : orienter vers la section « Histoire égyptienne « sans prononcer un mot, et ramener au calme d’un simple regard un groupe d’adolescents agités, donner son avis, positif ou négatif, sur un ouvrage en clignant des yeux… Personne ne maîtrise l’expression silencieuse mieux que les bibliothécaires. Entre eux, ils échangent sur des fréquences que seuls les chiens et les chauve-souris peuvent percevoir.
Un moment d’intense émotion, à propos de son père ancien Harki.
Un jour en rentrant de l’école – ce devait être à la fin des années soixante, mon père avait trouvé du travail chez Renault et nous avions quitté les camps -, je lui ai demandé ce que c’était qu’un collabo. Il m’avait expliqué. À l’école, il y en a qui disent que tu es un collabo. C’est vrai, Papa ? je lui avais demandé. Je me souviens de la tristesse dans son regard. Non seulement on l’avait trompé, mais comme si cela ne suffisait pas, on lui crachait dessus désormais. Mon père est mort il y a trois ans. J’avais huit ans lorsque je lui ai posé cette question. Jamais je n’oublierais le regard de mon père ce jour-là . D’abord parce que c’était par ma voix qu’il apprenait ce que les autres pensaient ou du moins colportaient sur les harkis. Ensuite parce que ce regard résume à lui seul tout ce qu’il m’a transmis, son histoire et la souffrance qui l’accompagnait. Mon père était un type bien et la vie ne l’avait pas mieux traité pour autant.
Humour qui fait du bien (aux maladroits, surtout).
Le tapis ne craignait rien. C’est un modèle bleu foncé venu remplacer le tapis artisanale berbère, souvenir du même voyage au Maroc, en laine blanche finement décoré de motifs géométriques noirs. Lui trop clair, trop fragile, moi, trop maladroit. Nous nous n’étions pas destinés à vivre ensemble.
Éclat de rire .
Bruno s’est bien foutu de moi ce soir. En attrapant mon porte monnaie dans mon sac, j’ai fait tomber la bombe de déodorant que tu m’as donnée pour remplacer ma bombe de défense au poivre. « Pour nous les hommes » il m’a dit. J’ai dû lui expliquer pourquoi je me promener avec une bombe de d’Axe marine. La seule chose qu’il a trouvé à dire, c’est que ça pouvait toujours servir si je tombais sur un agresseur qui sentait la transpiration ….
Je suis tellement d’accord, enfin, pour l’humanité j’ai un petit doute.
La pizza hawaïenne est incompréhensible, un ornithorynque gastronomique, un assemblage disparate qui défie la logique élémentaire sans avoir toutefois la sympathie de l’inclassable animal. C’est un outrage à la gastronomie italienne, et même une raison suffisante de douter du bien-fondé de l’existence de l’humanité.