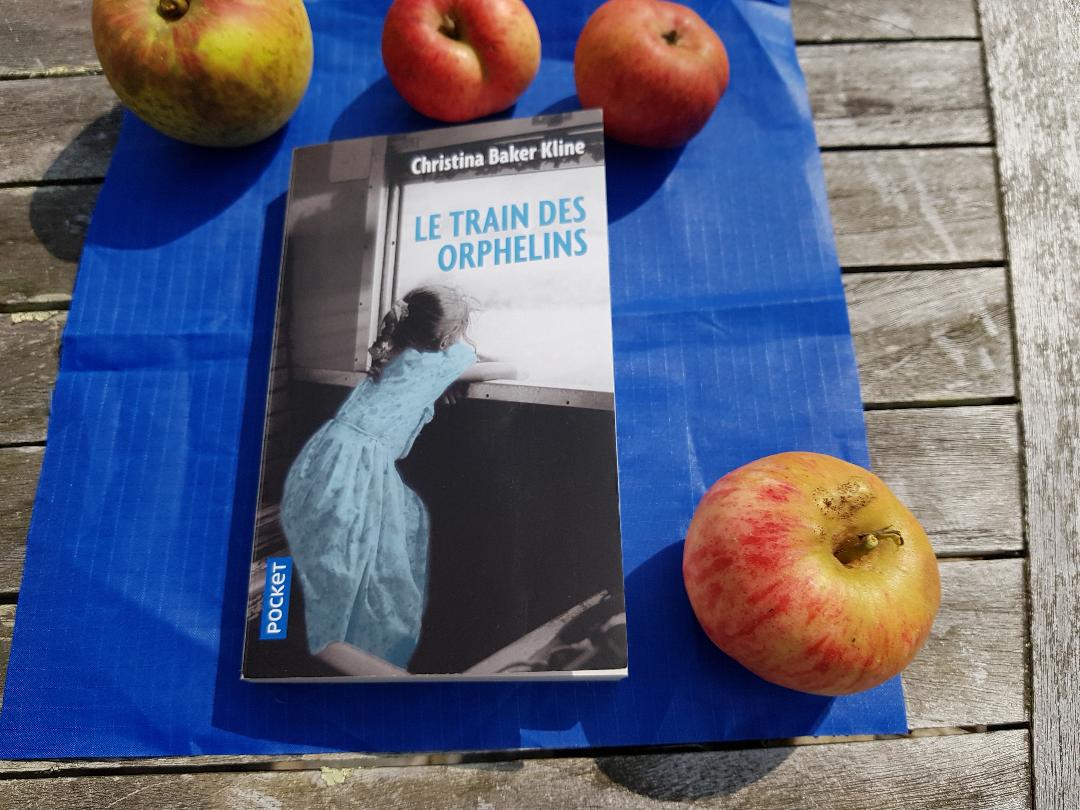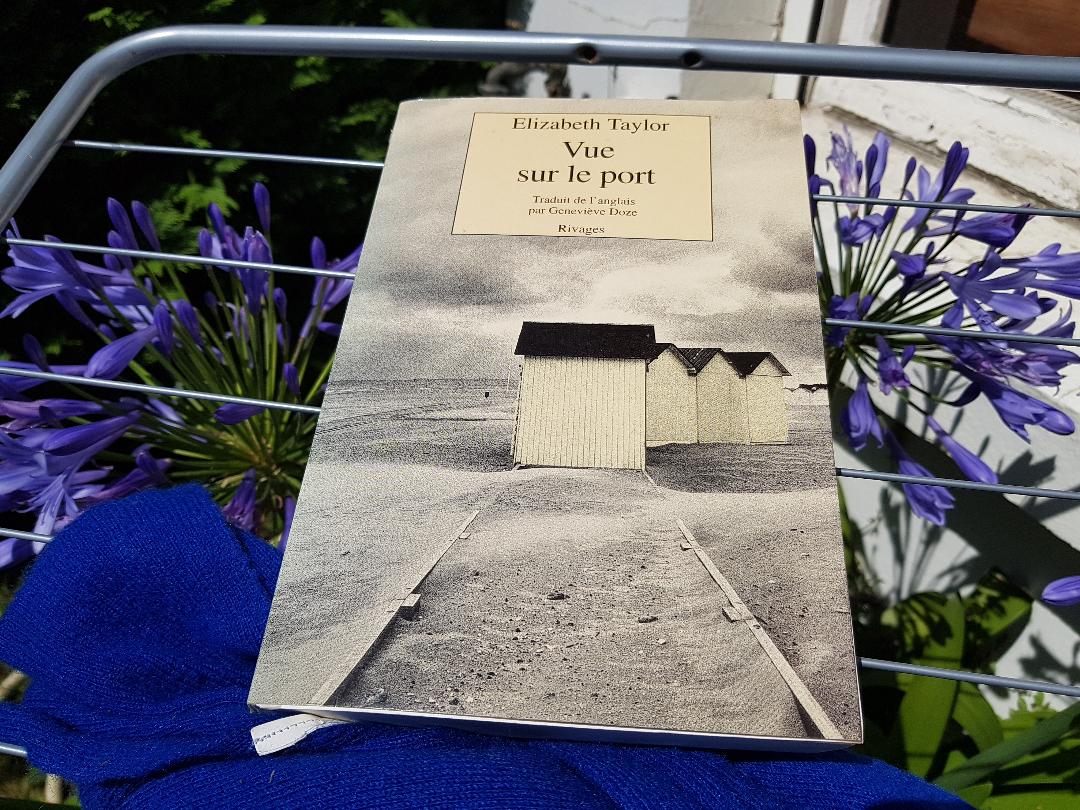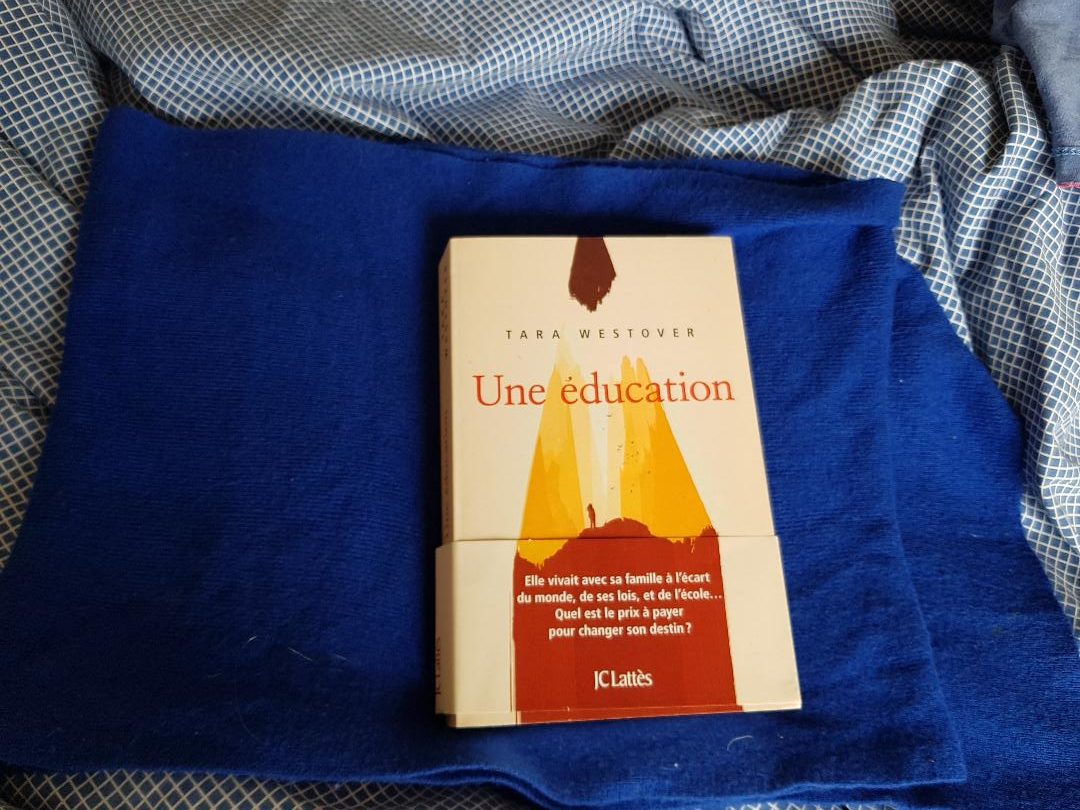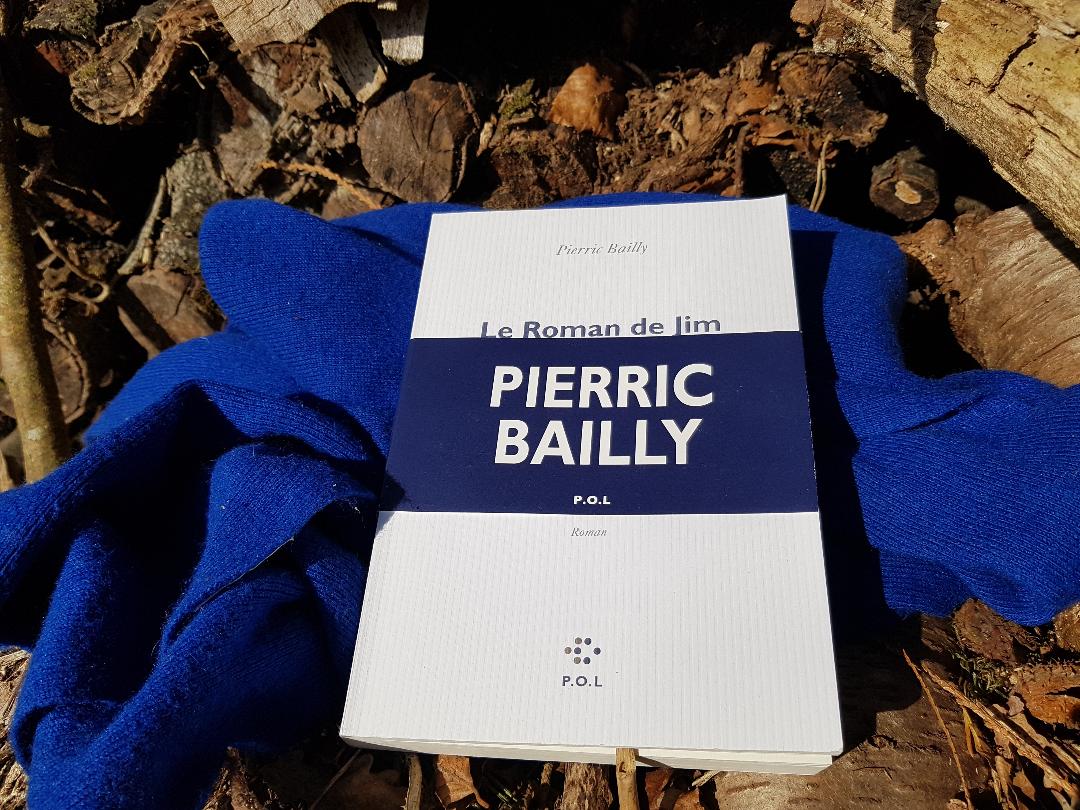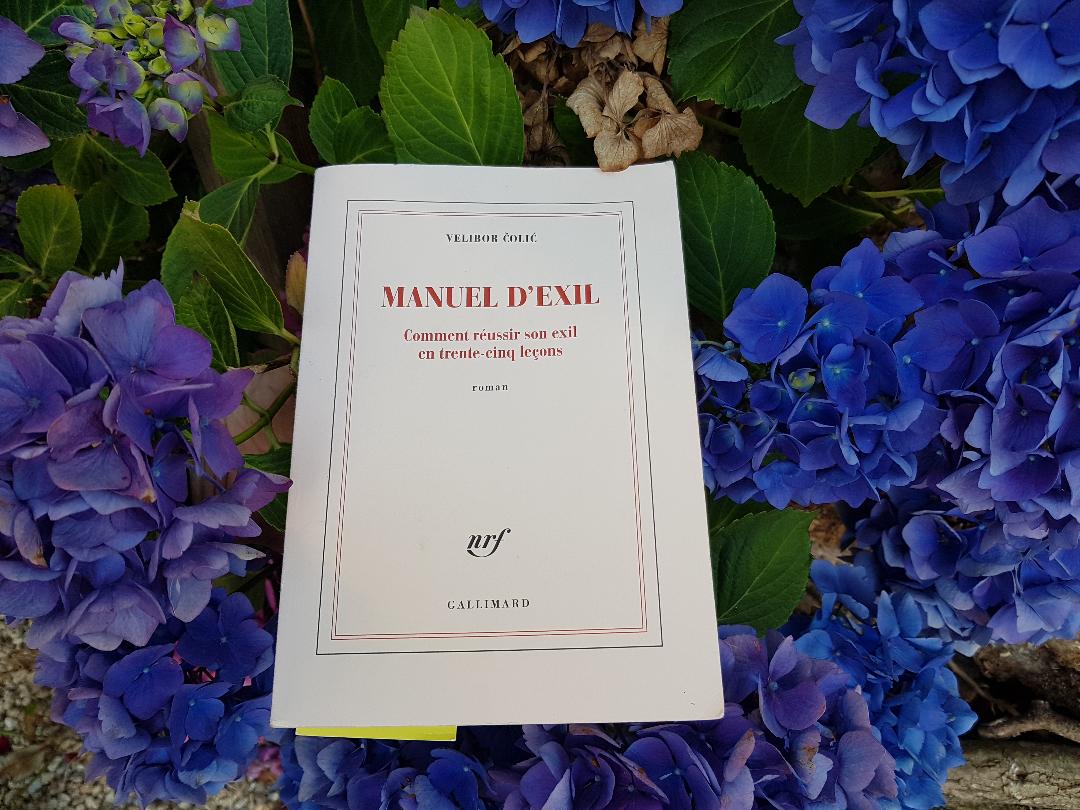Traduit de l’anglais (États-Unis) par Carla Lavaste. Édition Pocket
 Roman reçu en cadeau, et que j’ai lu d’une traite car l’histoire est saisissante et bien racontée. J’aime bien découvrir à travers un roman un fait historique dont je n’avais jamais entendu parler. Aux USA « Terre d’accueil et de liberté » pour des populations européennes chassées par la misère de leur pays, une pratique peu reluisante a vu le jour entre les deux guerres. Une oeuvre chrétienne chargeait à New-York un train avec des orphelins pour leur éviter l’orphelinat. Il arrivaient dans le Midwest et dans les gares les attendaient des couples en mal d’enfants. Une affiche avec cette annonce était collée sur les murs
Roman reçu en cadeau, et que j’ai lu d’une traite car l’histoire est saisissante et bien racontée. J’aime bien découvrir à travers un roman un fait historique dont je n’avais jamais entendu parler. Aux USA « Terre d’accueil et de liberté » pour des populations européennes chassées par la misère de leur pays, une pratique peu reluisante a vu le jour entre les deux guerres. Une oeuvre chrétienne chargeait à New-York un train avec des orphelins pour leur éviter l’orphelinat. Il arrivaient dans le Midwest et dans les gares les attendaient des couples en mal d’enfants. Une affiche avec cette annonce était collée sur les murs
Les familles d’accueil faisaient leur choix et signaient une convention : ils devaient les nourrir et les loger contre de menus services et les envoyer à l’école. Les bébés étaient le plus souvent adoptés et les plus grands, surtout les garçons étaient choisis par des fermiers pour l’appoint qu’ils pouvaient apporter au travail de la ferme. Aucun contrôle n’était exercé et donc l’école était une option au bon vouloir des gens qui accueillaient ces enfants.
Le roman a choisi pour raconter cette histoire une petite fille irlandaise qui changera plusieurs fois de prénom, Niamh son prénom irlandais, Dorothy dans l’horrible première famille et Viviane chez les gens qui l’ont aimée et qui ont voulu lui donner le prénom de leur fille morte de la diphtérie . Le seul objet qui la relie à son origine est un médaillon en étain avec le symbole irlandais de l’amour ; » le cladagh »
Il lui avait été offert par une grand-mère dont elle se souvient avec tendresse. Mais quand elle sera orpheline personne ne cherchera à la récupérer ni sa famille irlandais avec qui elle n’a plus aucun contact ni sa famille(éloignée) américaine qui devait sans doute se battre avec sa propre misère. Elle partira donc dans un de ces trains et connaîtra deux horribles familles avant de rencontrer ceux qui deviendront ses parents adoptifs . Cette histoire nous est racontée au gré des rangements dans un grenier par une autre enfant placée en famille d’accueil, Molly qui a écopé de cinquante heures de travaux d’intérêt général. Ces deux femmes l’une dans l’année de ses 18 ans l’autre dans ses 93 ans finiront par s’entendre. Elles ont en commun de savoir ce que c’est que de vivre dans une famille d’accueil.
J’ai quelques réserves sur la fin trop en happy-end à mon goût , en particulier pour la jeune Molly mais cela n’enlève rien à l’intérêt du roman.
Citations
Une jeune placée en famille d’accueil
S’il y a bien une chose qu’elle déteste à propos des familles d’accueil, c’est d’être à la merci de gens qu’elle connaît à peine et de dépendre de leur moindre lubie. Ne rien attendre de qui que ce soit, voilà ce qu’elle a appris. Ses anniversaire sont souvent oubliés et c’est tout juste si elle est invitée à participer aux différentes fêtes qui jalonnent l’année. Elle doit se contenter de ce qu’elle reçoit, et c’est rarement ce qu’elle a demandé.
Le train d orphelins
« Les enfants, vous voici à bord de ce que l’on appelle un train d’orphelins et vous avez la chance d’en faire partie. Vous laissez derrière vous un lieu diabolique où règne l’ignorance, la pauvreté et le vice. À la place, vous allez découvrir la noblesse de la vie à la campagne. »