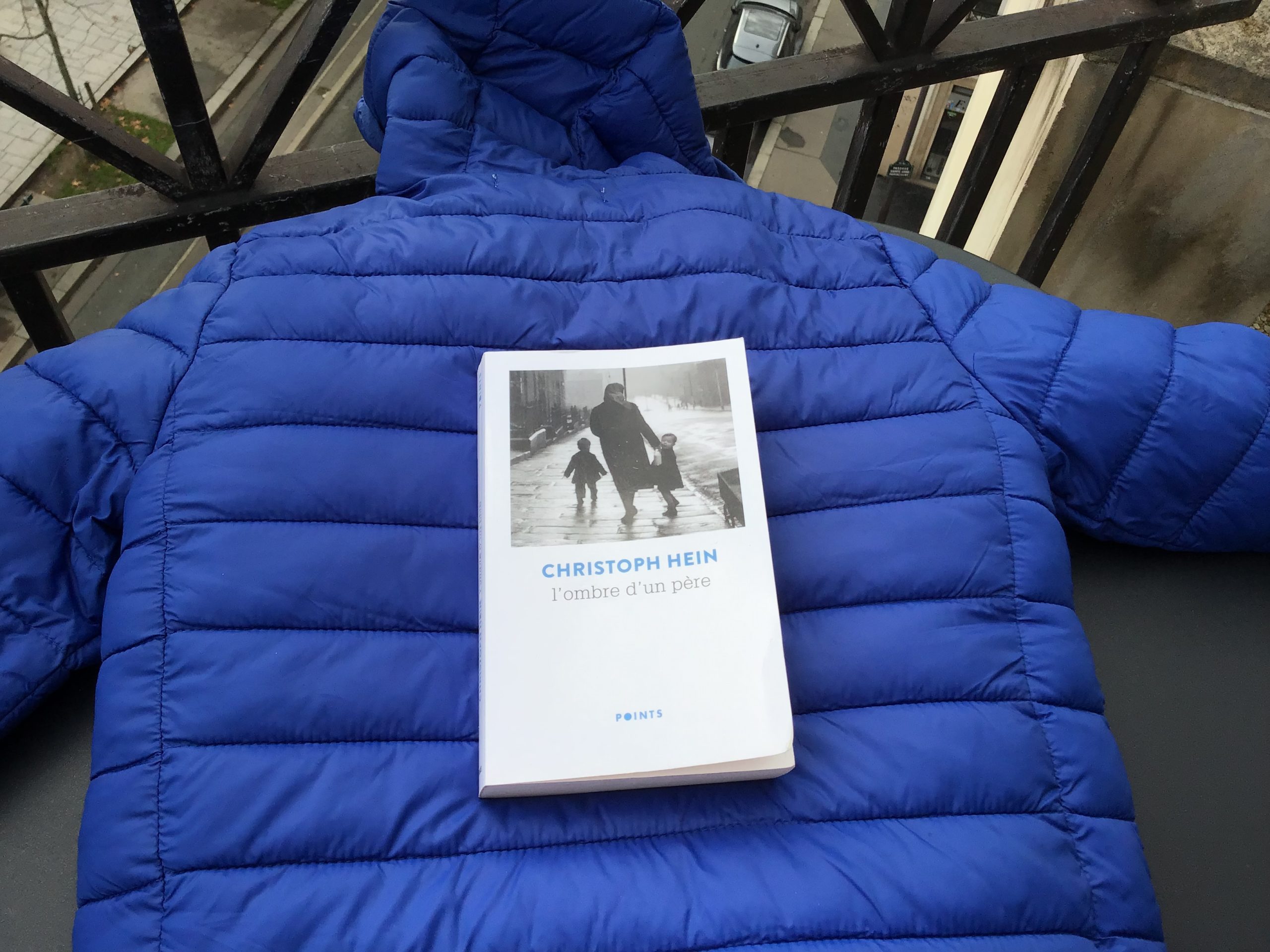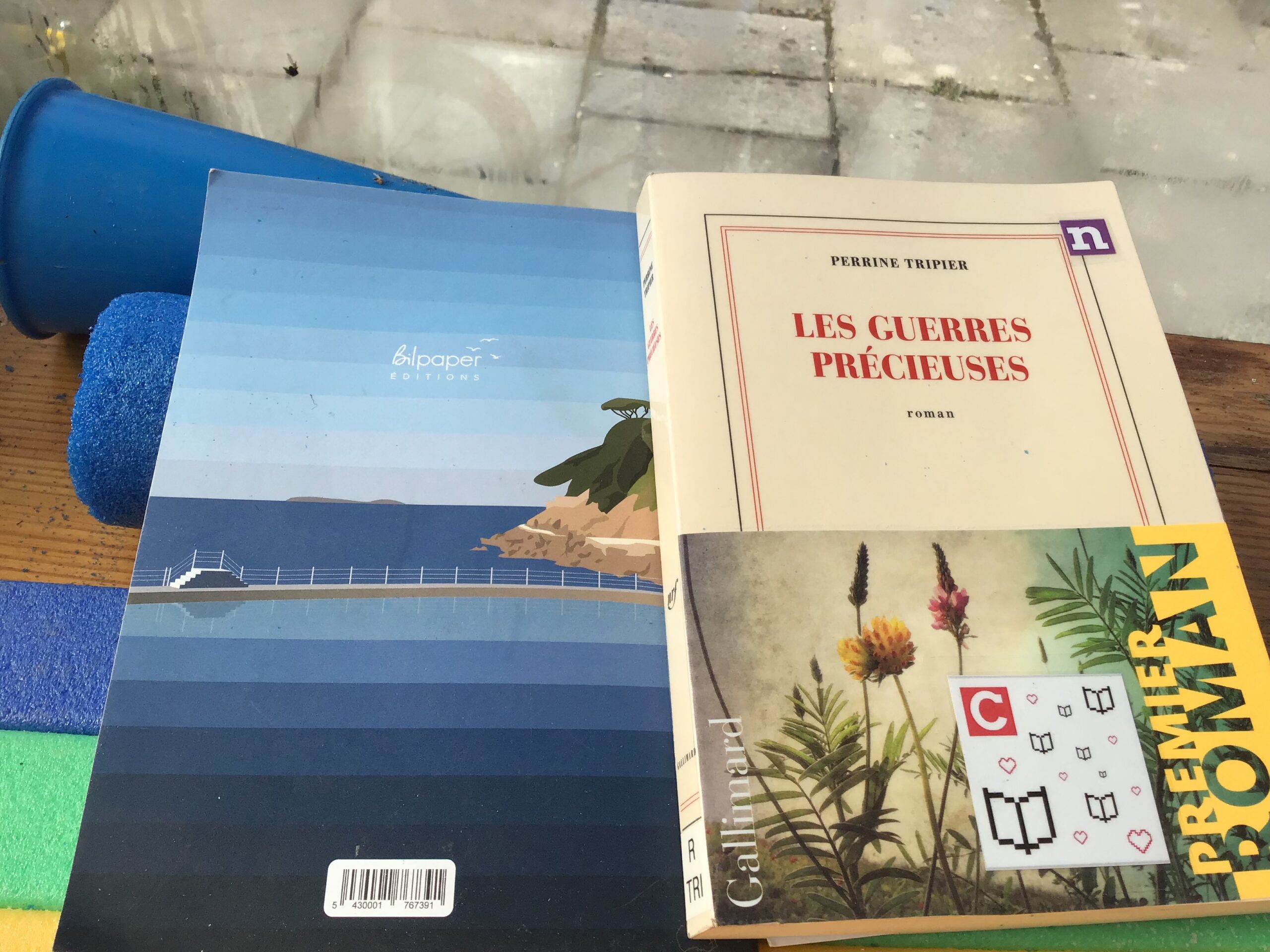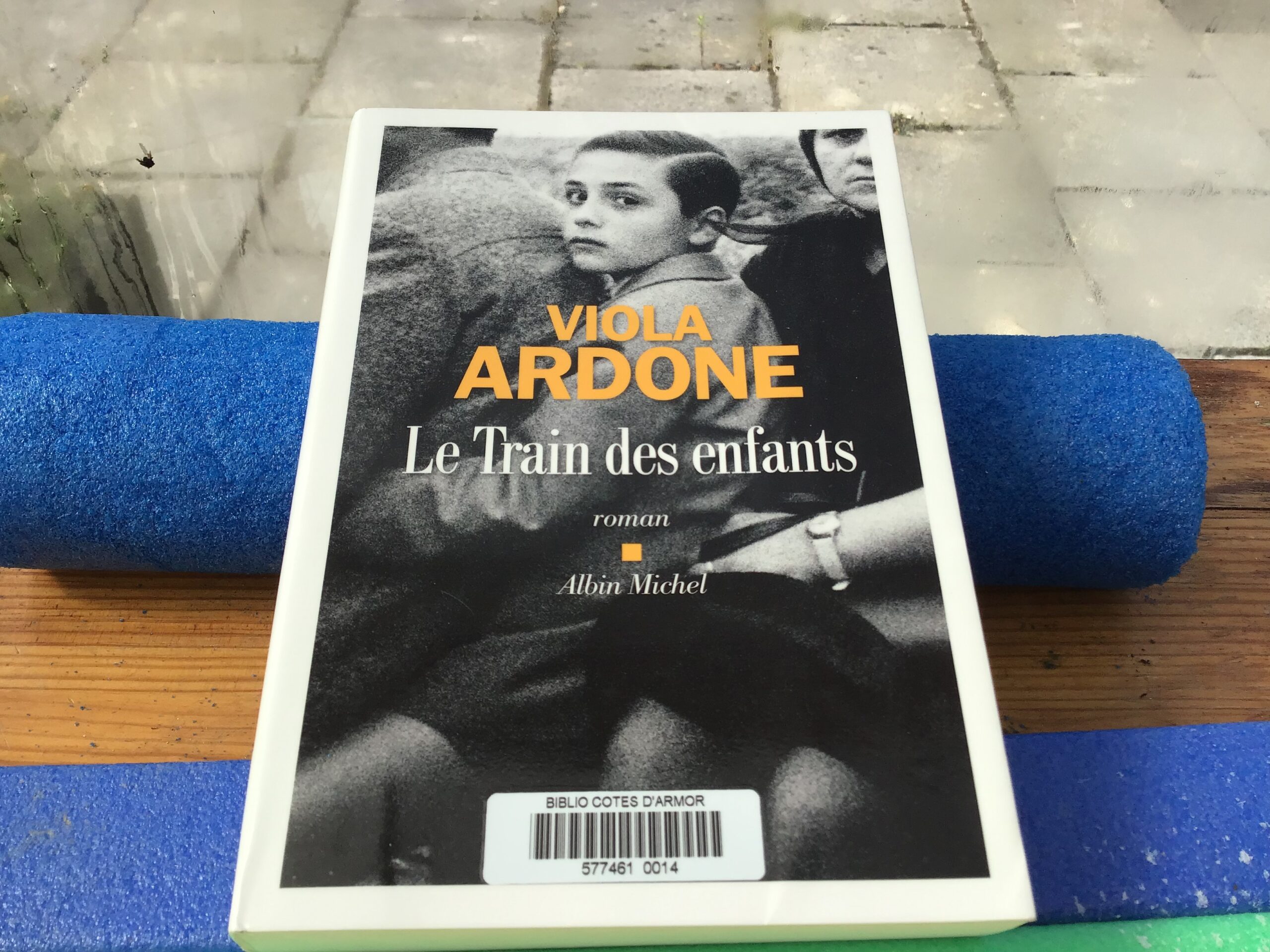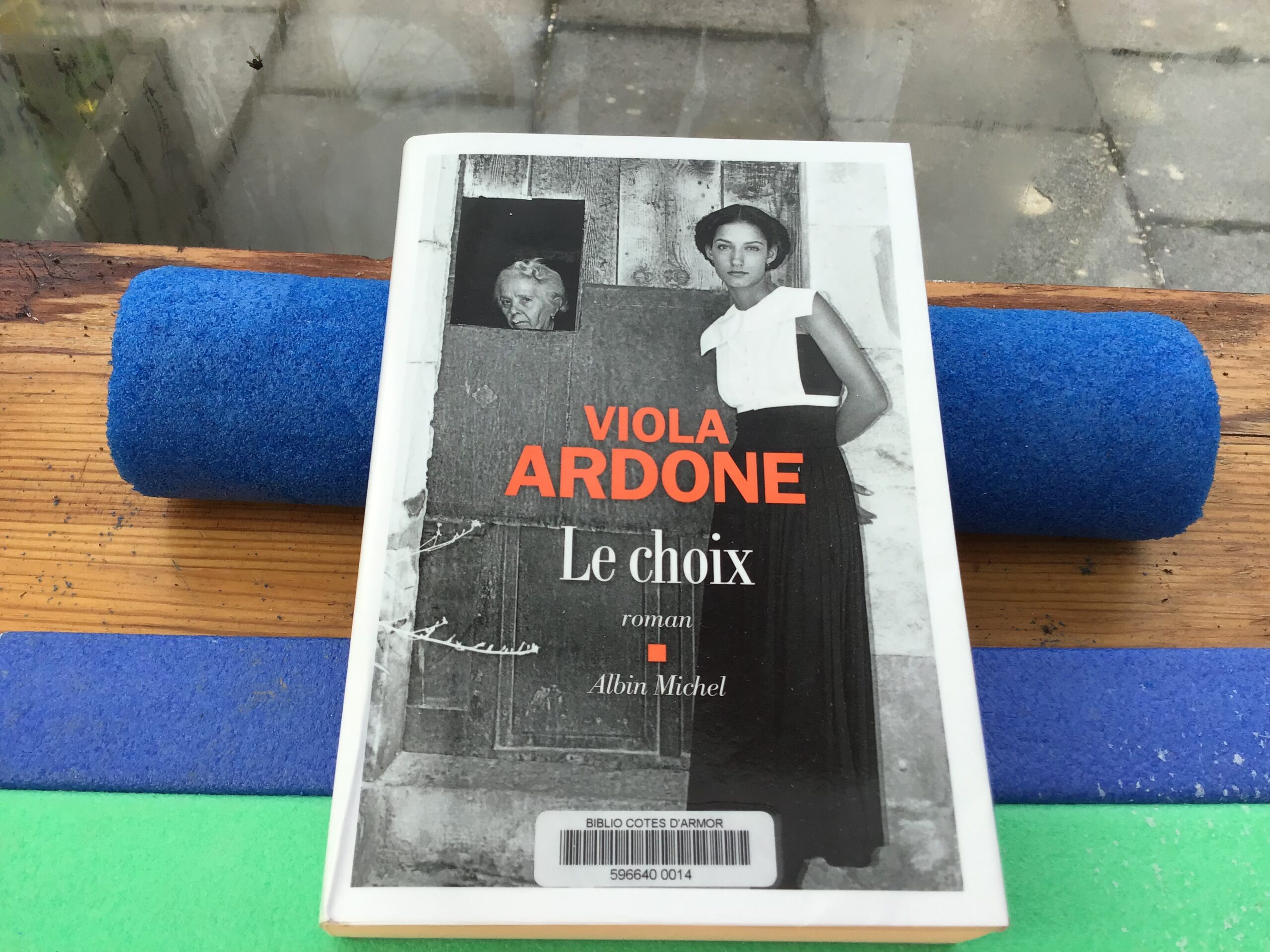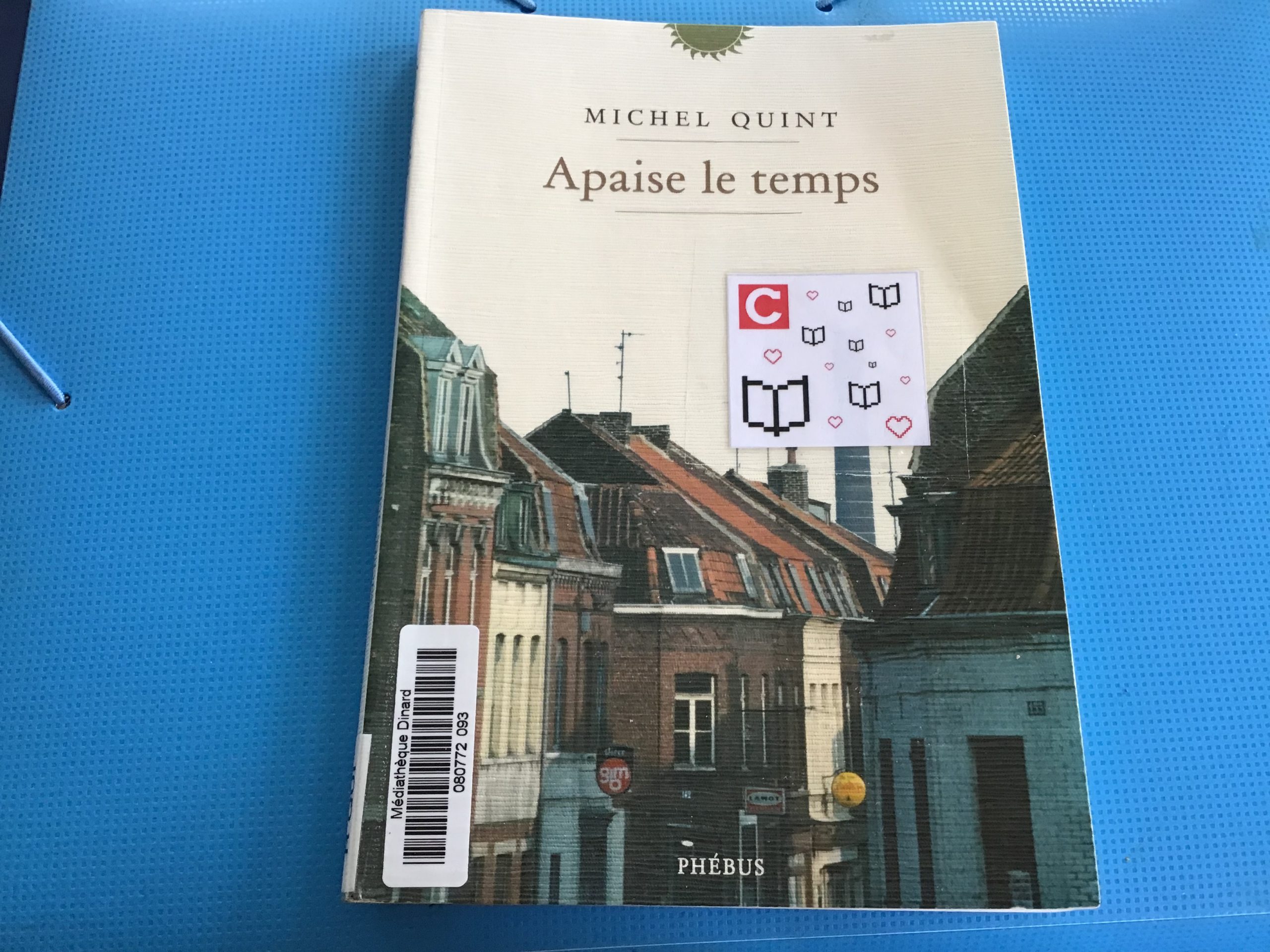Édition Points . Traduit de l’allemand par Nicole Bary
Ma quatrième participation au mois « les feuilles allemandes » 2023, organisé par Eva
 En lisant les avis sur Babelio, j’ai vu que Aifelle avait beaucoup apprécié ce roman, et je suis d’accord avec ce qu’elle en dit.
En lisant les avis sur Babelio, j’ai vu que Aifelle avait beaucoup apprécié ce roman, et je suis d’accord avec ce qu’elle en dit.
La filiation et le poids des crimes d’un père sont les thèmes de ce roman. Konstantin et Gunthard Boggosch, sont tous les deux les fils de Gerhard Müller et de Érika Boggosch. Si les deux enfants portent le nom de leur mère c’est que celle-ci découvre horrifiée, que pendant la guerre 39/45, non seulement son mari était un Nazi convaincu mais, de plus, a commis des crimes si monstrueux qu’il a été jugé et pendu en Pologne à la fin de guerre. Le destin des deux frères va totalement diverger, et cela permet à l’auteur d’analyser les différentes façons de se construire avec le poids du passé quand on est allemand. L’ainé, veut absolument croire au passé glorieux d’un père militaire et il refuse de le voir en criminel, quelques soient les preuves à charge. C’est d’autant plus facile pour lui, que ses preuves sont fournies par les Russes qui sont détestés par tous les Allemands. Il y a aussi un oncle à l’ouest qui a entrepris de réhabiliter son frère. Cet aspect est très intéressant car on comprend, alors, combien les Allemands de l’ouest ont été plus enclins à oublier le nazisme que ceux de l’est.
le personnage principal du livre, Konstantin, sera comme sa mère hanté, par le passé de son père. Et surtout ce passé se dressera sur sa route dès qu’il voudra réaliser quelque chose de sa vie. Parce que son père était un criminel de guerre, il ne pourra pas aller au Lycée. Commence alors pour lui, un parcours incroyable, fait de coïncidences trop exceptionnelles, pour moi. Il va fuir en France, car son premier projet est de s’engager dans la légion étrangère. Il rencontre à Marseille un groupe d’anciens résistants pour lesquels il va travailler comme traducteur car grâce à sa mère il parle français, russe, italien, anglais. Un jour, il reconnaîtra son propre père dans une photo prise dans le camp de travail forcé où son employeur et ami a failli mourir.
Trop honteux de cette filiation, il repart en Allemagne et, le jour où, le mur empêchera à jamais les gens de se réfugier à l’ouest, lui, il va à l’est pour retrouver sa mère.
Il sera refusé à l’école de cinéma, toujours à cause de son père. C’est certainement l’aspect le plus intéressant du livre : cette ombre qui empêche à jamais cet homme de faire des choix librement. La description du régime de l’est et des éternelles suspicions entre collègues dans le milieu enseignant est aussi tragique que, hélas, véridique.
En lisant ce livre, j’ai pensé à « Enfant de salaud » de Sorj Chalandon , il est évident que les Français ont laissé plus de liberté aux enfants d’anciens collaborateurs. En Allemagne de l’Est qui est passé du Nazisme au communisme, les traditions d’espionnage individuel et de dénonciations n’ont pas permis aux enfants de Nazi de pouvoir oublier le passé de leur père. Mais on peut aussi se scandaliser de la façon dont à l’ouest on a si vite tourné la page qu’il suffisait de devenir anticommuniste pour faire oublier son passé nazi et antisémite.
J’ai lu avec grand intérêt ce roman, mais j’ai eu du mal à croire aux aventures de Konstantin. Il y a trop de hasards dans ce récit, en revanche la partie où il raconte ses difficultés pour mener une vie « normale » d’enseignant en RDA m’a semblé très proche de la réalité.
Il y a un aspect que je comprends pas, il revient en RDA pour revoir sa mère mais il ne la verra que peu souvent. Il s’offusque que son frère la fasse vivre dans la cave de sa maison, enfin dans un sous-sol, mais il ne la prend pas chez lui.
Ce ne sont là que des détails par rapport à tout ce que j’ai appris sur l’ex-RDA.
Extraits.
Première phrase d’un roman allemand . Un petit coup de nature…
Les jeunes bouleaux semblait chuchoter leurs feuilles étaient violemment agitées, bien que l’on ne sentît pas le moindre vent. Sous le pesant soleil estival de cette fin d’après-midi le blanc cassé des troncs frêles à l’apparence fragile brillait de mille feux.
Les souvenirs .
Avec nos souvenir nous essayons de corriger les échecs de notre vie c’est pour cette seule raison que nous nous souvenons. C’est grâce aux souvenirs que nous nous apaisons vers la fin de notre vie. Ce sont les souvenirs terribles qui finalement nous permettent de faire la paix avec nous-même. Regardez les volumes de mémoires qui paraissent chaque année. Ce sont tous des personnages merveilleux. Des caractères magnifiques, sincères courageux. Intrépides, désintéressés, la justice en personne. Des types dont on aurait aimé être les contemporains. Le problème est qu’ils étaient mes contemporains, et ils n’étaient pas sympathiques. Et ne croyez pas que je veux vous persuader maintenant que mes souvenirs n’en sont plus exacts, plus vrais, plus dignes de confiance. Non, chère mademoiselle, moi aussi je vous raconterai ce qui correspond à l’image que je me fait de moi-même, que je veux faire miroiter aux yeux des autres. Je tairais bien évidemment ce qui me gêne dans ma propre personne. Et pour cela je ne devrais pas faire des efforts particuliers. Ce qui est dérangeant, ce qui ne me plaît pas, je ne devrais même pas le passer sous silence, ce n’est pas la peine. Je l’ai oublié depuis longtemps et même radicalement.
Le poids d’un père .
Je ne pouvais pas m’installer en France, pas non plus en Angleterre, ou en Italie, ou en Pologne, ou en Union Soviétique, je tomberais partout sur des hommes de la « Résistance », sur des partisans, sur ceux qui avaient combattu Hitler. Je ferais leur connaissance, ils deviendraient mes amis, et un jour ils devraient apprendre que vi gt ans auparavant ils avaient été confrontés à mon père, le « Vulcan » craint de tous. Dans chaque pays je le trouverai sur ma route partout je serais le fils du » SS Vulcan ».