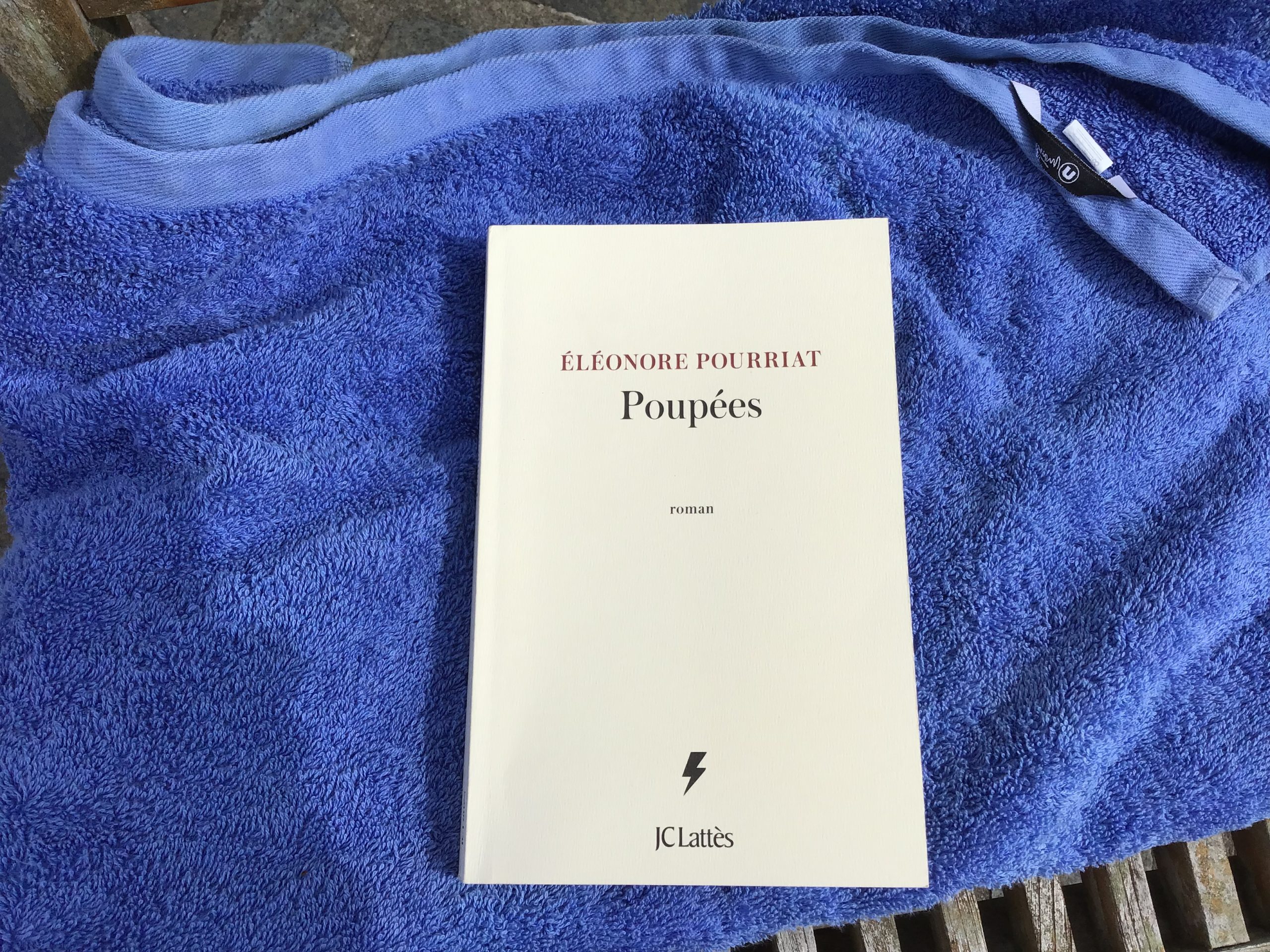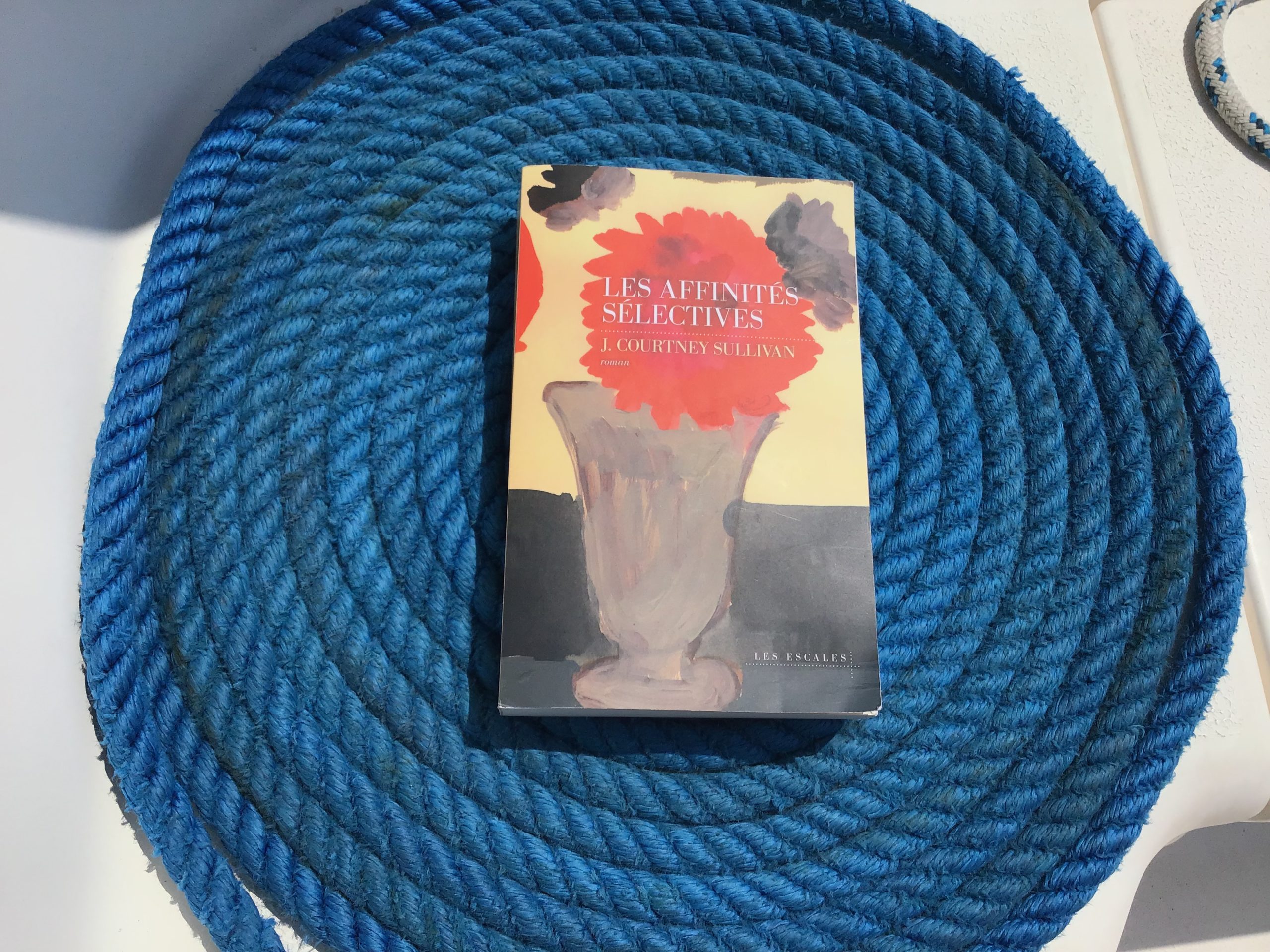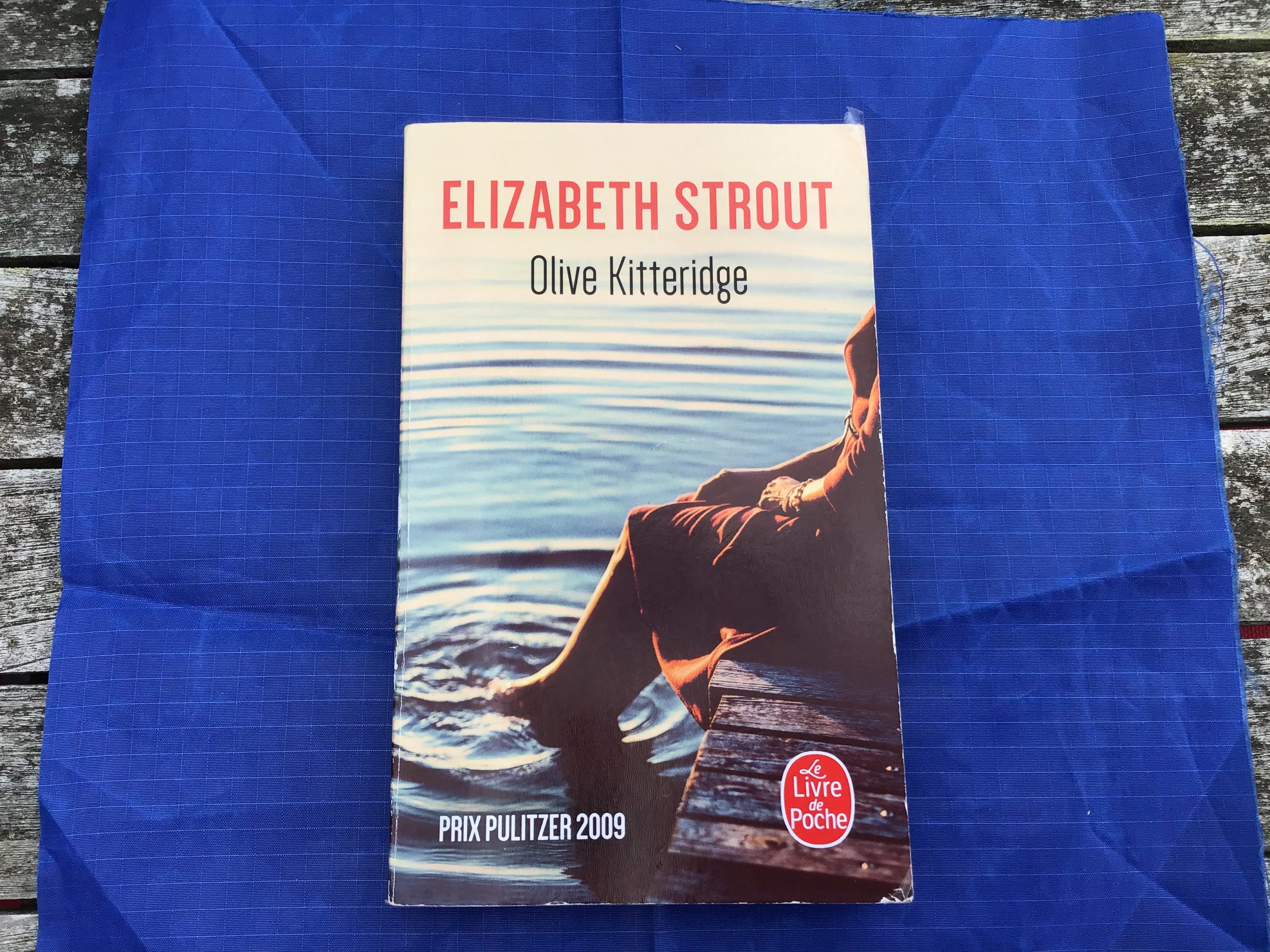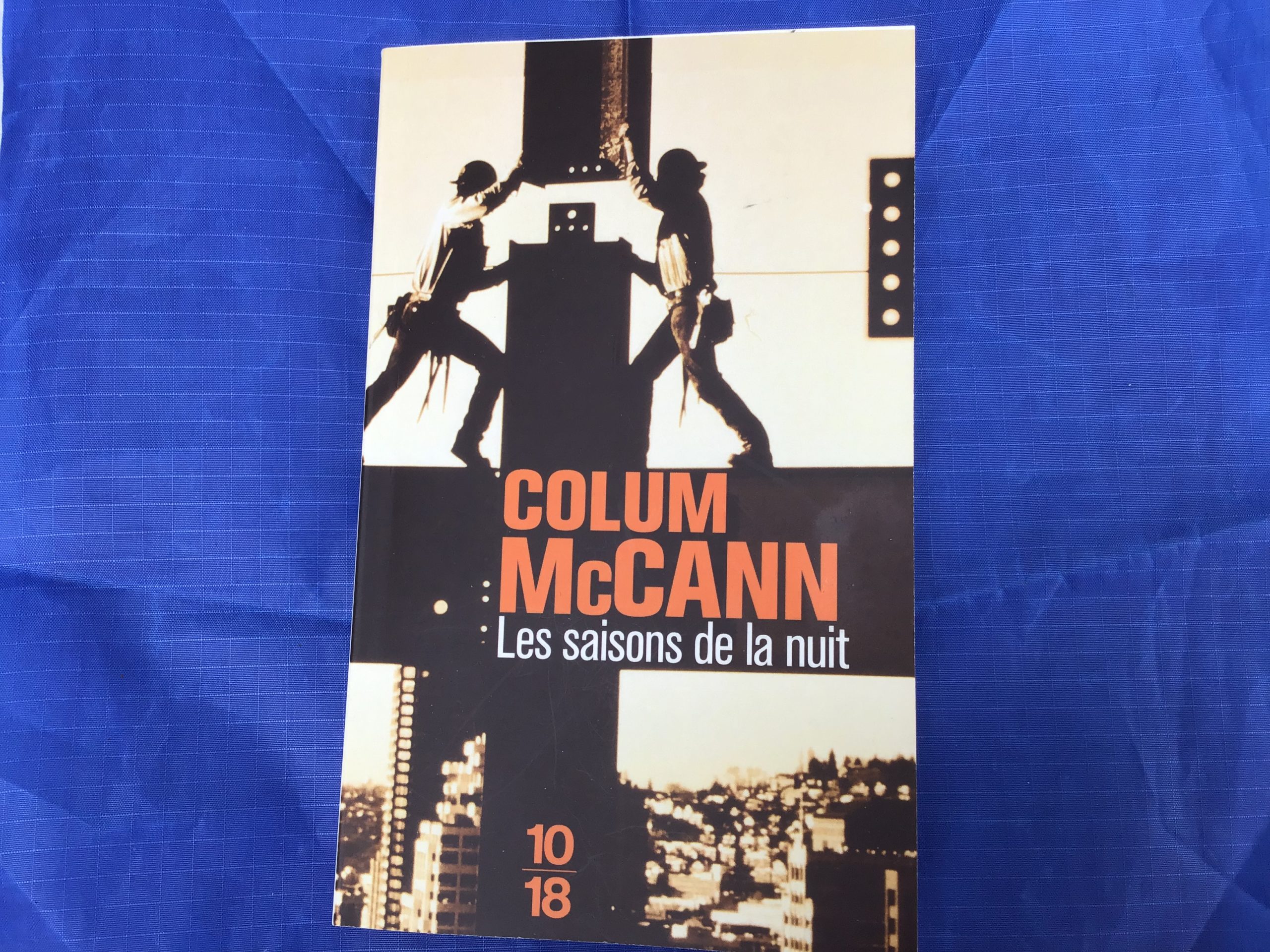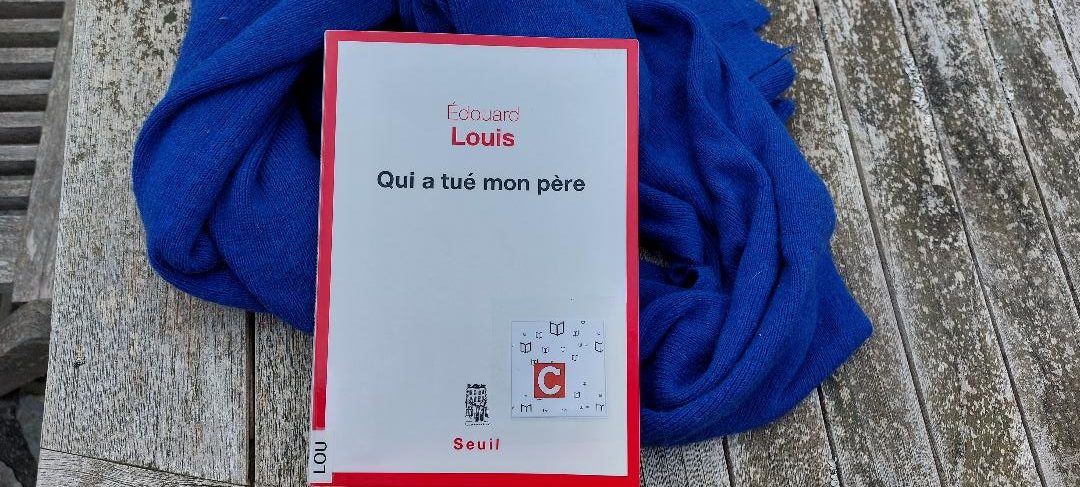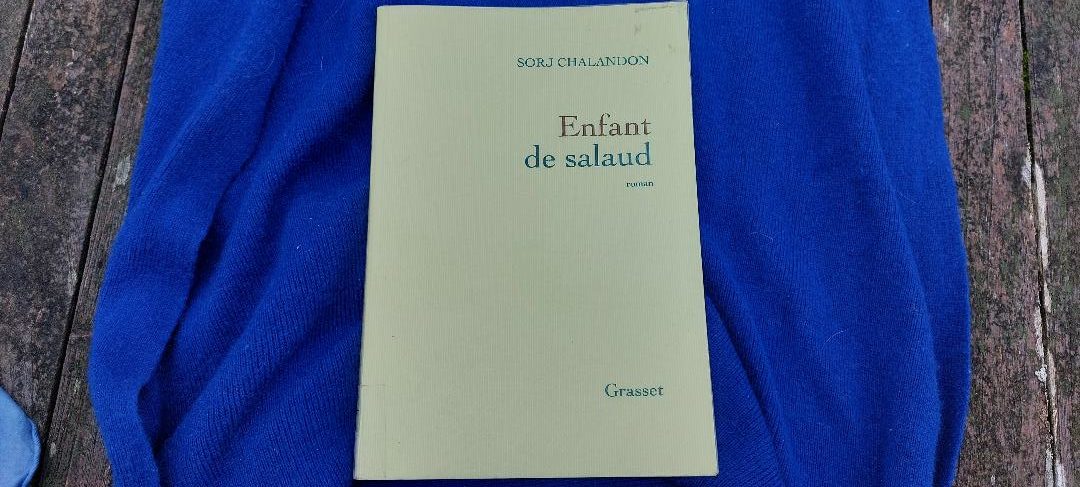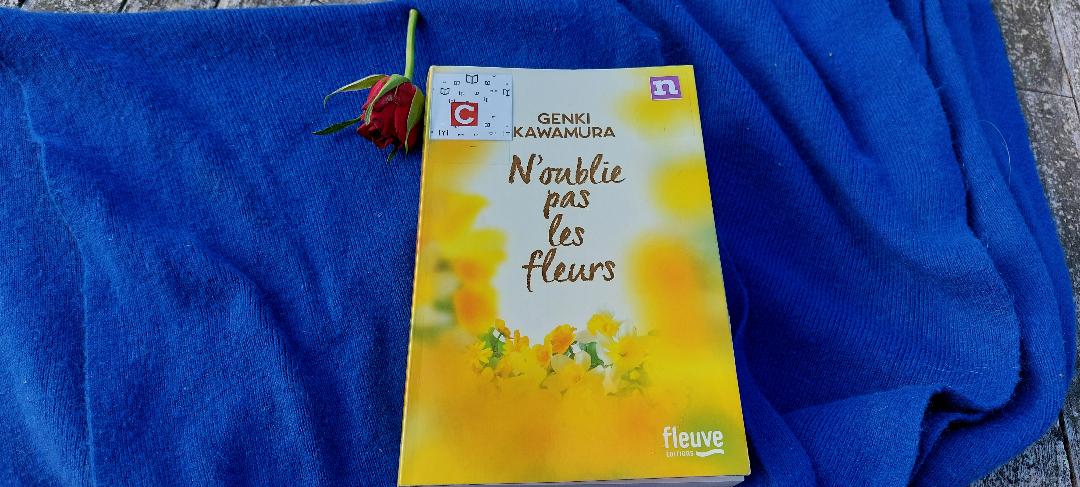Encore une fois c’est La souris Jaune qui m’a tentée pour ce roman très prenant. La tension est palpable dès le début et va en augmentant jusqu’à un certain jour d’été. Nous suivons l’adolescence de Joy et Stella deux très jeunes filles qui se ressemblent physiquement et qui nouent un lien amical très fort. L’une comme l’autre ont des vies déséquilibrées : Joy est élevée par un père seul, sa femme est partie alors que sa fille avait huit ans. Stella est élevée par une mère qui fréquente le monde artistique dans une très belle maison où les fêtes alcoolisées résonnent trop souvent. Et puis un jour, après le séjour d’été chez la grand mère aux États-Unis, Stella se sépare de Joy et au retour en France, elle coupe définitivement avec son amie sans aucune explication.
Encore une fois c’est La souris Jaune qui m’a tentée pour ce roman très prenant. La tension est palpable dès le début et va en augmentant jusqu’à un certain jour d’été. Nous suivons l’adolescence de Joy et Stella deux très jeunes filles qui se ressemblent physiquement et qui nouent un lien amical très fort. L’une comme l’autre ont des vies déséquilibrées : Joy est élevée par un père seul, sa femme est partie alors que sa fille avait huit ans. Stella est élevée par une mère qui fréquente le monde artistique dans une très belle maison où les fêtes alcoolisées résonnent trop souvent. Et puis un jour, après le séjour d’été chez la grand mère aux États-Unis, Stella se sépare de Joy et au retour en France, elle coupe définitivement avec son amie sans aucune explication.
La deuxième partie du roman se passe trente ans plus tard et on finit par comprendre ce qui a poussé Stella à couper définitivement avec son amie.
En dehors de cette révélation, ce que je trouve très intéressant c’est la façon dont les deux adolescentes se trompent toutes les deux sur leur famille respective. Et surtout, le style de l’auteur sert très bien cette histoire tragique, la voix des deux jeunes filles qui racontent bien le plaisir qu’elles ont à se retrouver et à passer du temps ensemble : faire le mur, aller danser, s’échanger leurs vêtements et surtout écouter David Bowie en boucle. Elles ne perçoivent pas ce que les adultes veulent leur cacher et inventent une vie imaginaire comme les adolescentes savent si bien le faire.
Celle qui a subi le drame c’est Stella mais elle arrivera à se reconstruire une vie heureuse. En revanche, Joy à qui on a tout caché et qui ne peut même pas imaginer le début d’une vérité n’a pas réussi à être heureuse dans sa vie amoureuse.
Un roman sur un sujet souvent traité mais d’une façon originale grâce au suspens très bien mené par cette écrivaine, mais je n’ai vraiment profité du roman qu’à le relecture lorsque j’ai été débarrassée du suspens (Je sais que je ne fais pas la l’unanimité quand je dis cela), et je l’ai trouvé un peu vide tout l’intérêt est dans le drame dévoilé au trois quart du récit.
Citations
L’amitié adolescente .
L’adolescence est une fiction ; l’amitié, un pacte temporaire. On cherche et reconnaît en nos rencontres ce qui nous fait défaut, on leur jure fidélité en échange, chacun devient l’armure de l’autre pour se jeter à l’assaut du monde, puis s’en déleste, une fois l’obstacle surmonté ou la défaite admise.
La réalité derrière la fête.
Joy a idéalisé ce qui se passait villa Adrienne. Ce n’était pas le monde généreux qu’elle décrivait. Ces types prenaient la maison pour une auberge, ils traitaient Domino et sa fille comme leur soubrette. Jamais Stella n’en a vu un apporter un bouquet de fleurs ni se mettre en cuisine. À part ça, ils étaient formidables.Domino était passée d’une vie modeste avec un réfugié laotien obsédé par l’intégration a une communauté foutraque et intellectuellement vivifiante, mais son rôle n’avait pas changé, elle faisait les courses, les repas, le ménage, et elle gueulait. Ou alors elle pleurait parce qu’une fois de plus elle était tombée amoureuse d’un tocards qui avait pris la poudre d’escampette.
Comment empêcher une adolescente de parler.
Dottie, elle, n’a pas gobé son mensonge. Elle est venue la trouver dans le garage et lui a demandé très gentiment ce qu’il lui arrivait, parce qu’elle croyait que les deux amies s’étaient disputées. Stella s’est sentie en confiance :– il y a eu un problème avec votre fils…Dottie lui a jeté un coup d’œil furtif, méfiant aussitôt contré par son bon sourire.– Il est incorrigible, hein ? Ce n’est pas bien grave tu sais. Tu t’en remettras, s’il t’a volé un baiser .– Non ce n’est pas…Dottie l’a interrompue sèchement cette fois.– Quand on a le feu au cul, on allume.Oui ce sont les mots de la gentille vieille Dame qui aimait les expressions idiomatiques. Ses grands yeux bleus avait rétréci en tête d’épingle noires. Un regard d’une dureté abyssale.