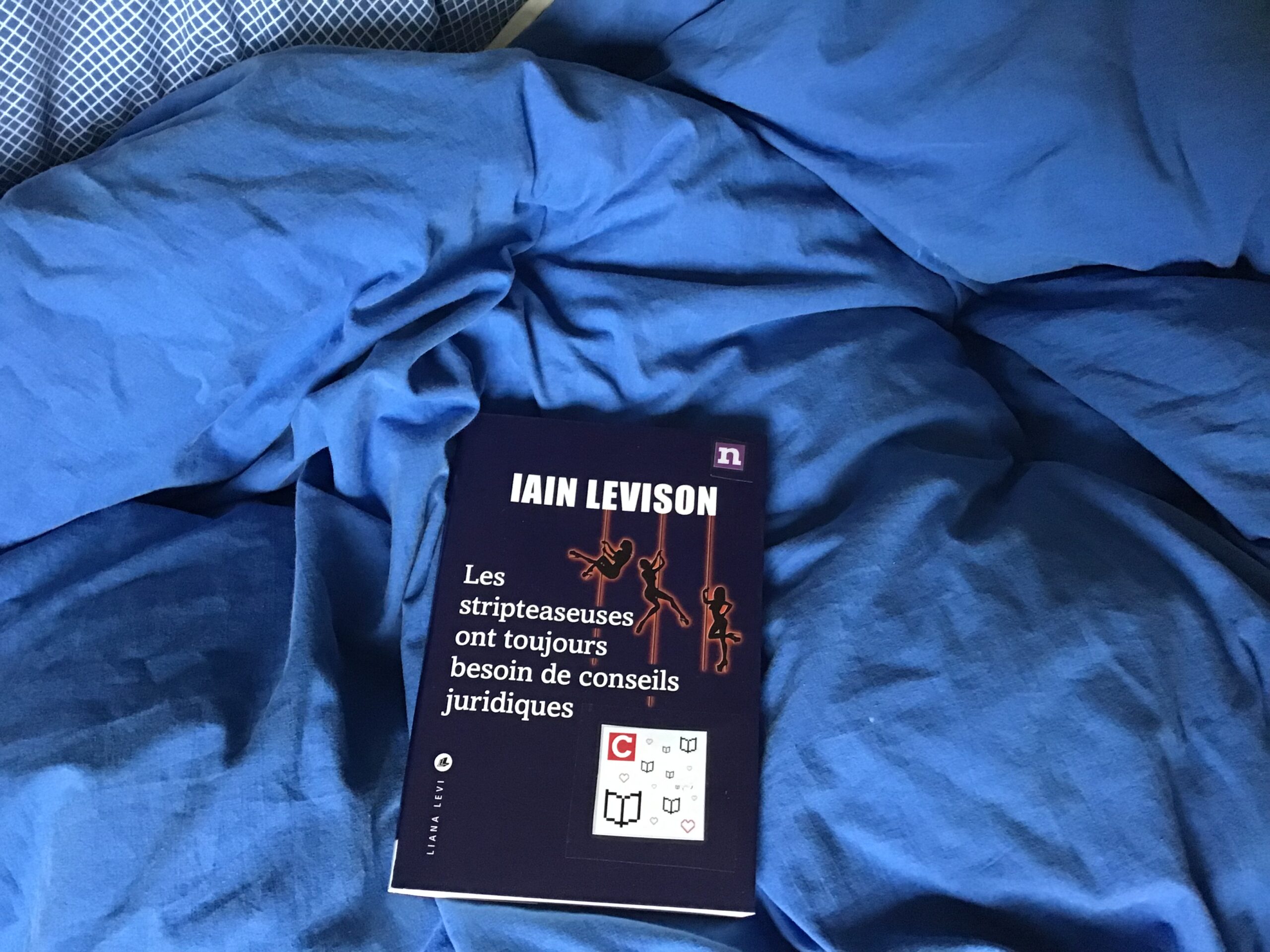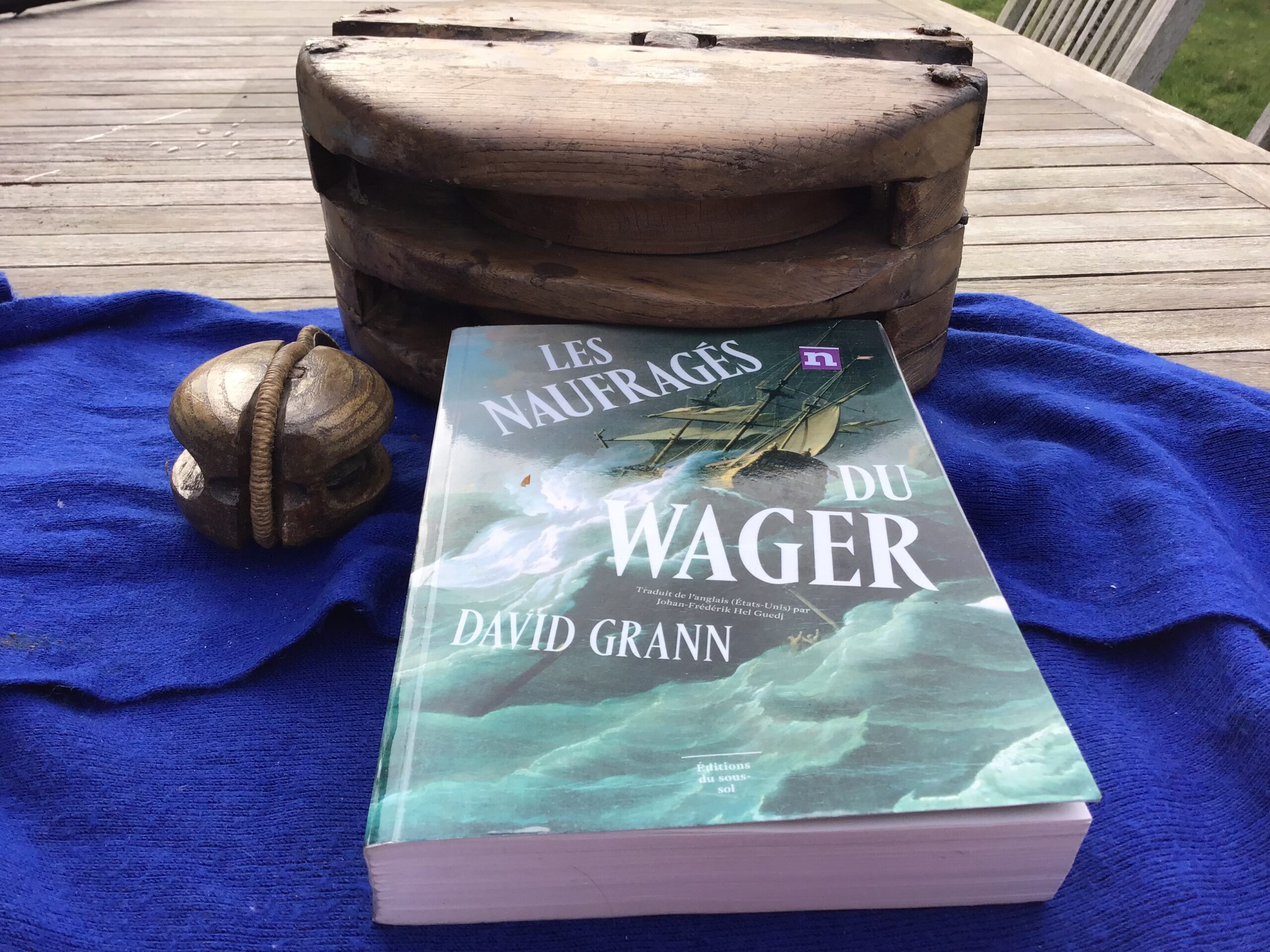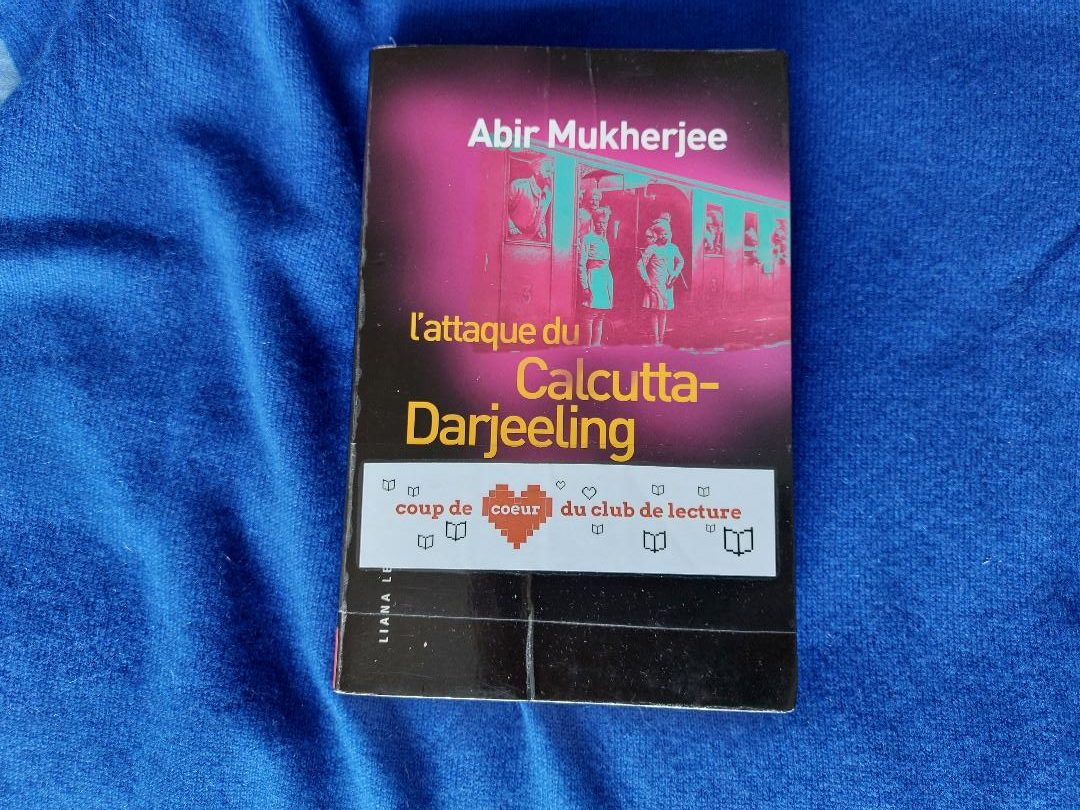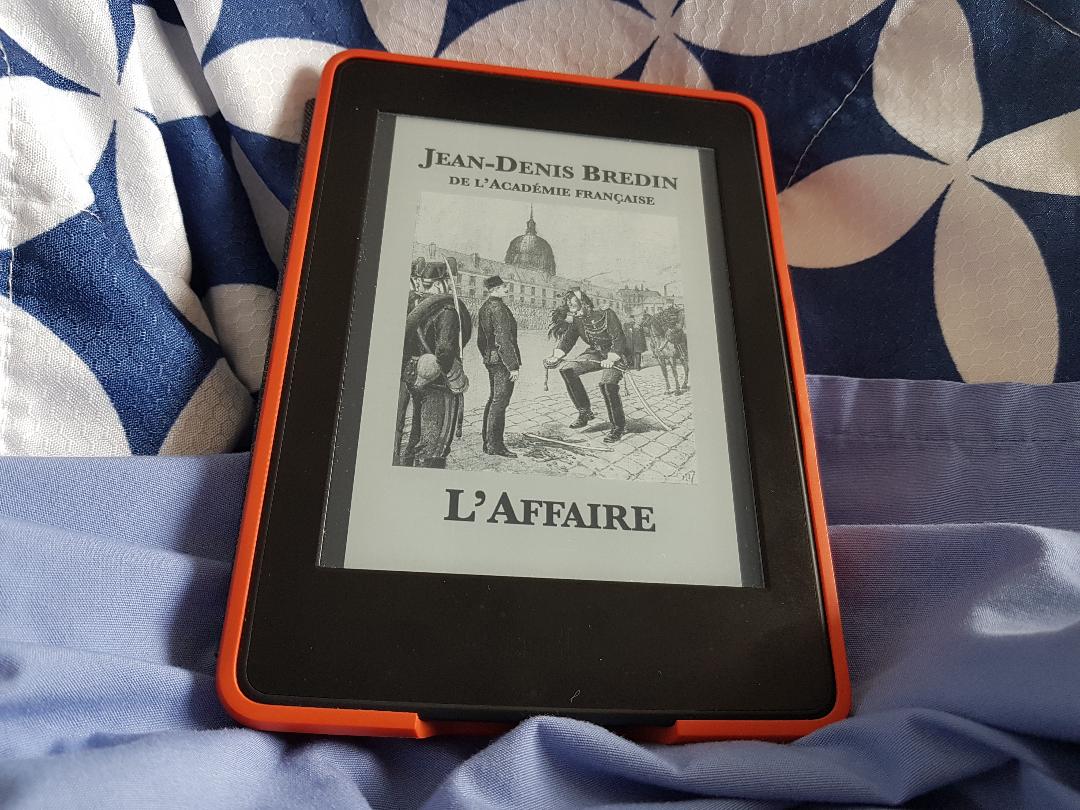Éditions la tribu, 459 pages, janvier 2025
Lu dans le cadre du club de lecture de la médiathèque de Dinard
 J’ai lu chez « je lis je blogue » un billet à propos de ce roman et il se trouve qu’il était au programme du club dans le thème » roman historique ».
J’ai lu chez « je lis je blogue » un billet à propos de ce roman et il se trouve qu’il était au programme du club dans le thème » roman historique ».
Je rappelle brièvement le fait central : rue Transnonain, au 12 exactement, la nuit du 14 avril 1834, les troupes commandées de loin par un certain Bugeaud obéissant à Adolphe Thiers, entrent dans cet immeuble et tuent tout le monde : hommes, vieillards femmes et enfants. C’est un crime d’état et qui a d’abord choqué l’opinion publique et puis qui a été bien oublié. Il préfigure ce que sera la répression de la Commune toujours menée par Adolphe Thiers, ce boucher qui a encore tant de rues et de places à son nom dans les villes françaises.
Ce qui a sans doute rendu célèbre ce crime d’état c’est le dessin de Daumier plus que le texte de Ledru-Rollin qui, déjà, dénonçait ce crime sans raison de 12 parisiens.

À partir de ce crime horrible, l’auteur crée une fiction historique, très intéressante qui permet de se plonger dans le Paris de la misère sous Louis Philippe. Les deux personnages principaux, la prostituée, Annette Vacher, et l’ancien policier Joseph Lutz ne sont pas des personnages de pure fiction mais très librement interprétés par l’auteur. La trame principale de ce récit est de démonter la propagande officielle de l’époque qui consistait à faire porter le chapeau de cette tuerie aux habitants de cet immeuble qui auraient caché un homme qui a tué un officier de la garde. En réalité, le règne de Louis Philippe est secoué par de multiples révoltes dont celle des canuts à Lyon, et le pouvoir, avec le tristement célèbre Thiers à sa tête, veut remettre de l’ordre . Pour cela, il faut museler la presse et mettre en prison tous les gens qui appartiennent à des mouvements progressistes. Bugeaud pense qu’il faut faire peur aux bourgeois, rien de telle qu’une tuerie bien organisée.
Le monde de la misère est parfaitement décrit en particulier celui de la prostitution. L’auteur fait revivre deux femmes remarquables de l’époque : Suzanne Voilquin et Claire Démar qui ont lutté toute leur vie pour la cause des femmes, trop tôt, sans être le moindre du monde entendues à leur époque.
J’ai une réserve sur ce roman trop foisonnant. L’auteur a voulu tout dire de l’époque . Le fil narratif est, de façon permanente, fait d’aller et retour sans que cela se justifie. Pour moi, la chronologie aide à la compréhension et le contraire m’a lassée. Et puis le romanesque emporte l’auteur dans des invraisemblances qui n’apportent pas grand chose et surtout le personnage de la prostituée amoureuse d’un jeune ouvrier occupe une très grande partie du roman sans pour autant être très incarnée : c’est une très belle coquille vide . Bref, quelques longueurs dans un roman qui vaut vraiment le peine d’être lu pour découvrir la misère du tout début de l’industrialisation de la France.
Extraits
Début.
« … on ne tue pas le monde comme ça. «Au numéro 12 de la rue Transnonain, à l’emplacement de l’actuel 62, rue Beaubourg à Paris, deux amants sont allongés dans un lit. L’un dort l’autre veille. La jeune femme s’appelle Annette Vacher. Elle doit avoir dépassé la vingtaine. Personne ne peut donner son âge exact, mais tous se souviennent de ses yeux verts légèrement bridés, de son épaisse chevelure d’un rouge rabattu et de ses tâches de rousseur. Quelque chose d’excessif dans la féminité, de débordant. Madame Pajot, la concierge de l’immeuble, est plus directe pour elle, « c’est une fille ».
Citations de la presse d’opposition .
La caricature, 17 avril 1834Pendant toute la journée, on voyait à chaque instant sortir des cercueils des maisons démantelées de la rue Transnonain ; on avait oublié d’écrire dessus : laisser passer l’ordre public.(plus loin)L’administration des pompes funèbres a placé, dit-on, au-dessus de son établissement l’écriteau suivant : Au Pouvoir, les pompes funèbres reconnaissantes.
Portrait d’Adolphe Thiers.
Au moment des Trois Glorieuses, ils parie sur Louis Philippe. Dans les colonne du « National », il le pousse sur le trône. Élu député, il s’arrange pour envoyer le mari de sa maîtresse en poste dans le Nord et, ne pouvant mettre la main sur la mère, épouse la fille de seize ans. Le voilà riche, le voilà électeur, le voilà éligible. Grâce à la fortune du beau-père, il s’installe place Saint-Georges, dans un hôtel particulier en style néogothique, qui symbolisera aux yeux des Parisiens, ce que peuvent faire la ruse et le pouvoir réunis en un seul personnage.
Le carnaval et les excès .
Son nom est Milord l’Arsouille. Le fils bâtard d’un riche Anglais qui vient d’hériter de cent mille livres sterling. Elles lui brûlent les mains. Et pas que les siennes. Son jeu préféré consiste à plonger une poignée de pièces d’or dans l’huile de la friture et, muni d’un mouchoir, de les lancer sur la foule. Il faut les voir s’arracher la peau en paiement de leur lucre. Quand il a bien ri, il se bat. Peu importe la raison. Avec les bourgeois. les fiers-à-bras. Comme s’ils voulaient se punir d’avoir eu tant de chance.
Genre de scènes trop fréquentes à mon goût.
Dans son dos les chaufourniers retroussent sa robe. La poussière lui entre dans les narines, les oreilles, les yeux. Par tous les orifices du corps. Il doit y en avoir sur le sexe en érection parce que ça la brûle de l’intérieur. Dans la cour les femmes parlent de plus en plus fort. Les enfants jappent comme des petits chiens. Les chaufourniers avaient et toussent, leur souffle si court qu’Annette croit plusieurs fois qu’ils vont mourir en elle.
6 ans d’une vie.
Elles arrivent ainsi de devant la barrière d’Italie. Celle par laquelle six années plus tôt, Annette entrait dans Paris. Six ans c’est peu … à moins qu’on n’ait été obligé de coucher avec des centaines d’hommes, qu’on n’ait éborgné une femme, passé un an en prison, connu plusieurs révolutions, échappé à un massacre, dormi sur des grabats, éprouve la faim, le froid rencontré l’amour et tenu dans ses mains son crâne ouvert.
La peur et l’action .
Dimanche après-midi quelques heures avant l’assaut. La rue Beaubourg est remplie à la gueule. Des familles entières qui musardent depuis la tour Saint-Jacques jusque dans le Marais. Ça chante, ça prend du bon temps. C’est pas comme ça qu’on va faire la révolution. Retiens bien mon avis, Lutz : la peur c’est le seul combustible valable. Sans elle, autant rester chez soi.