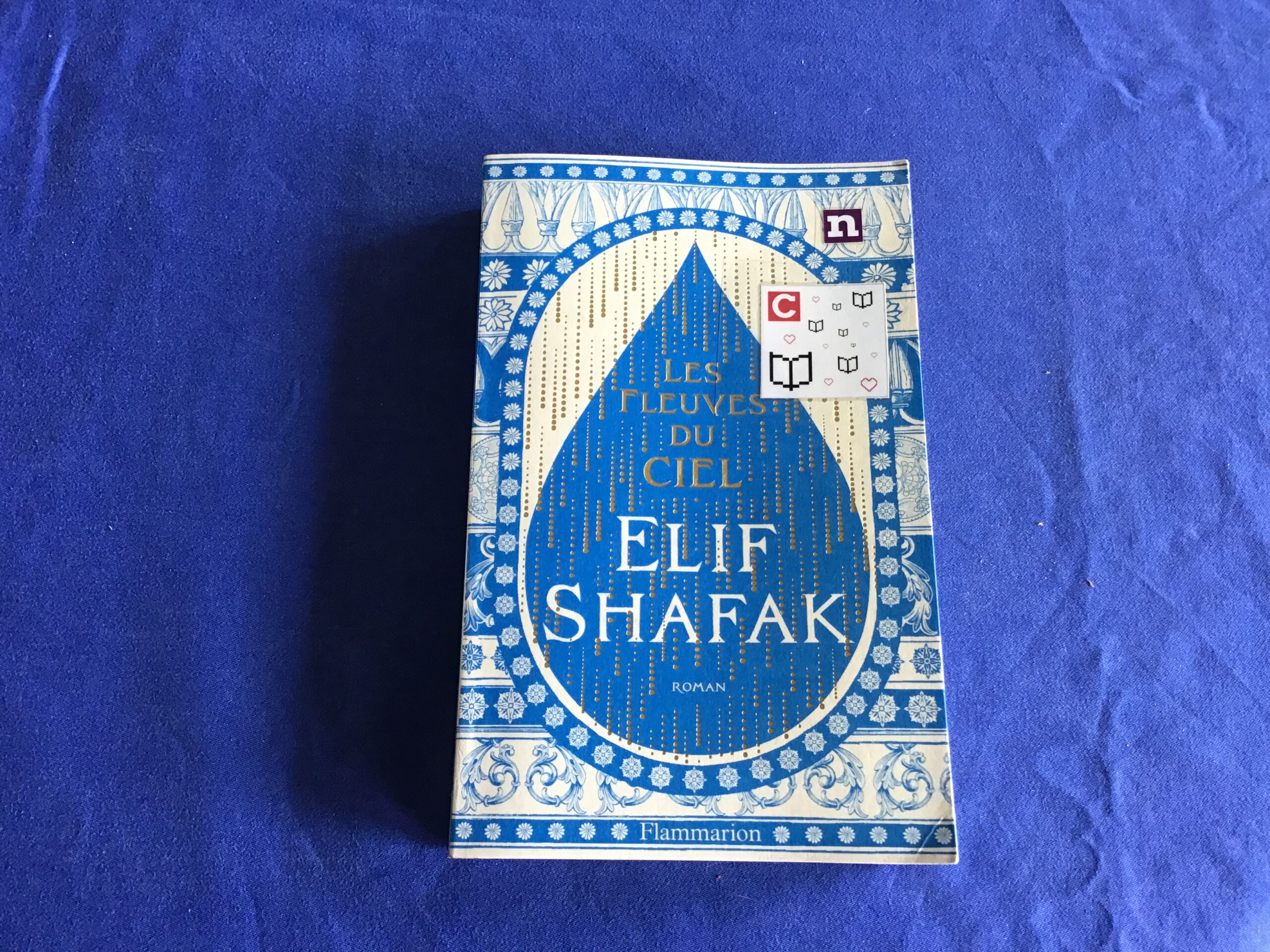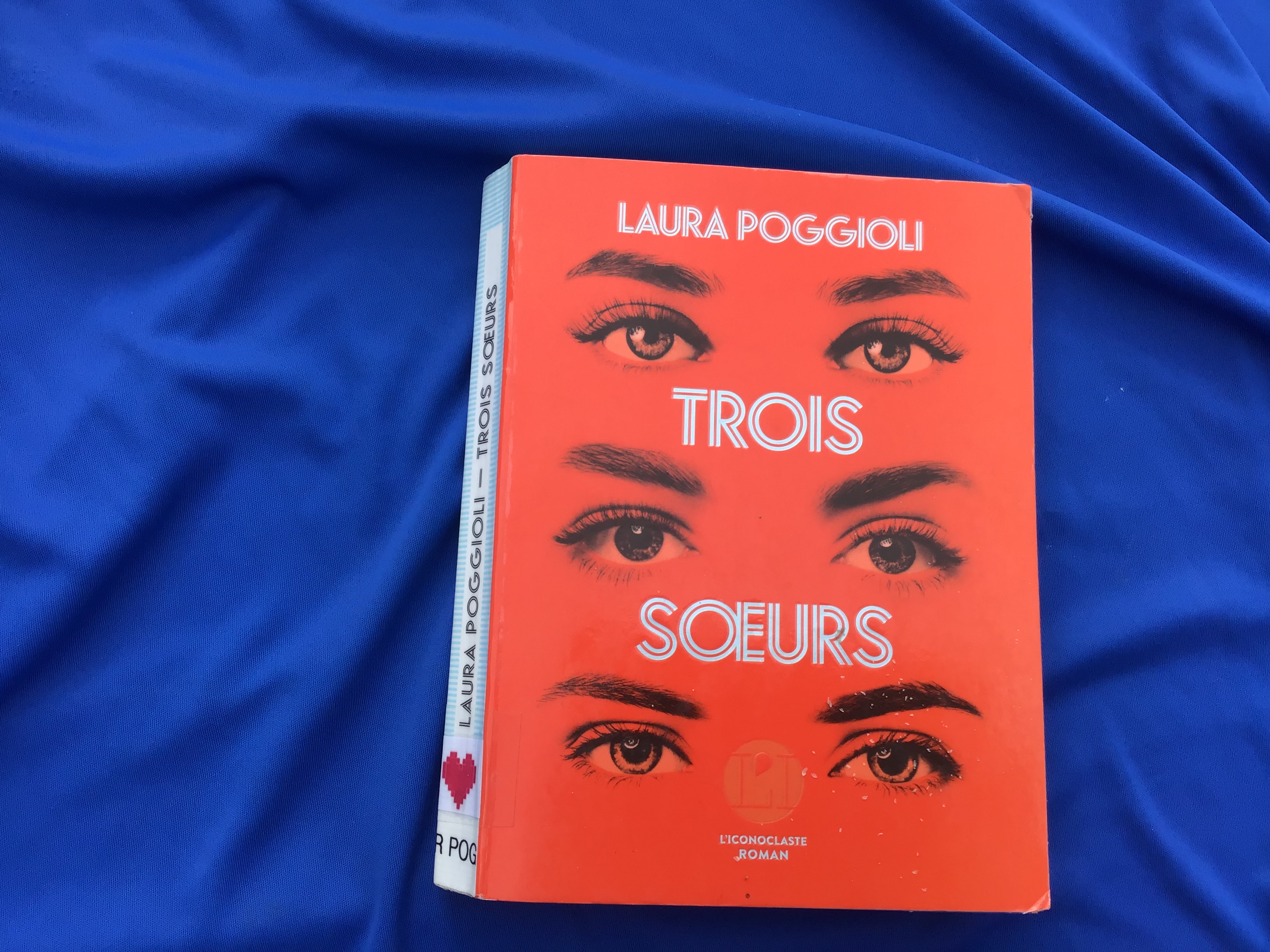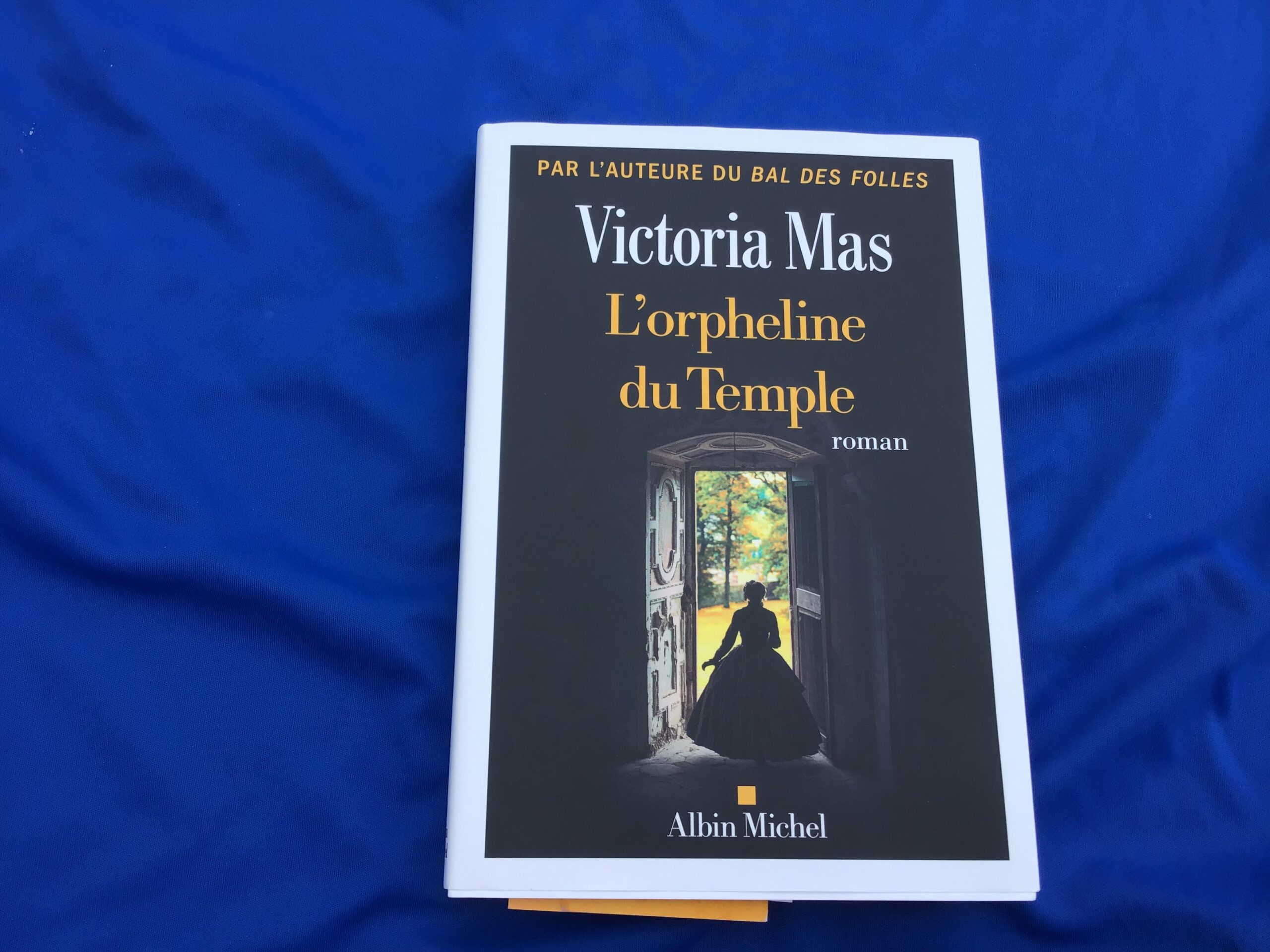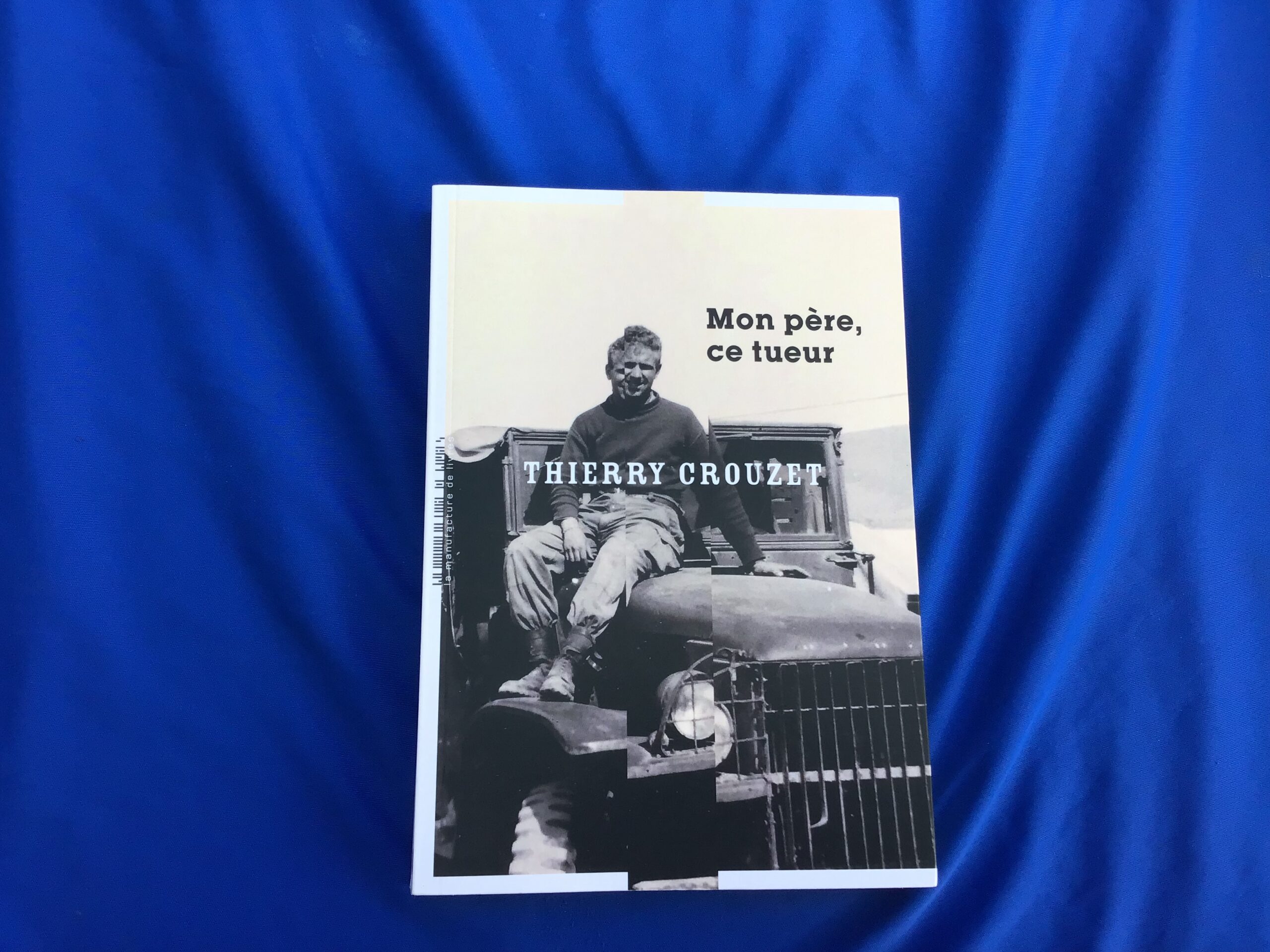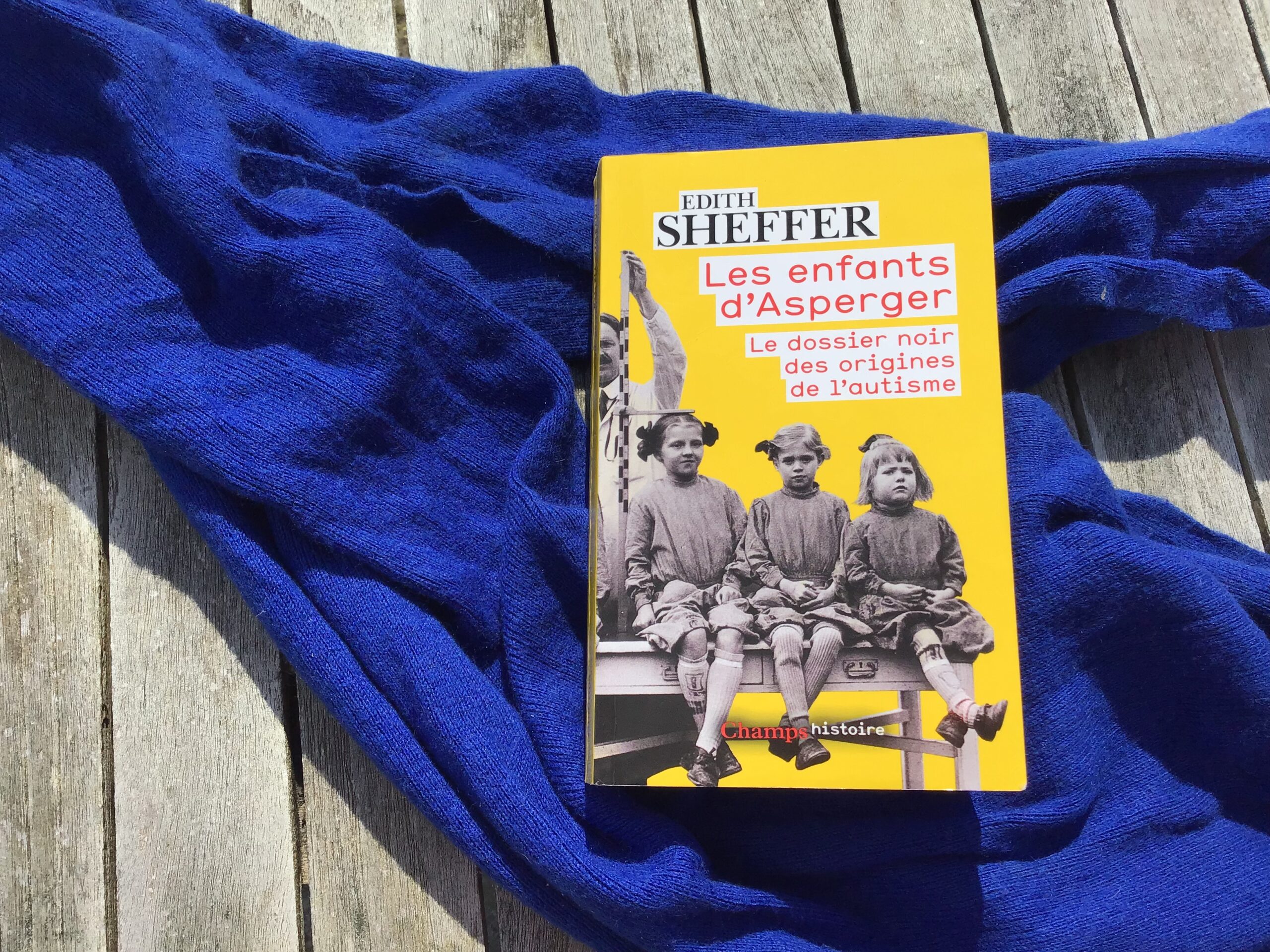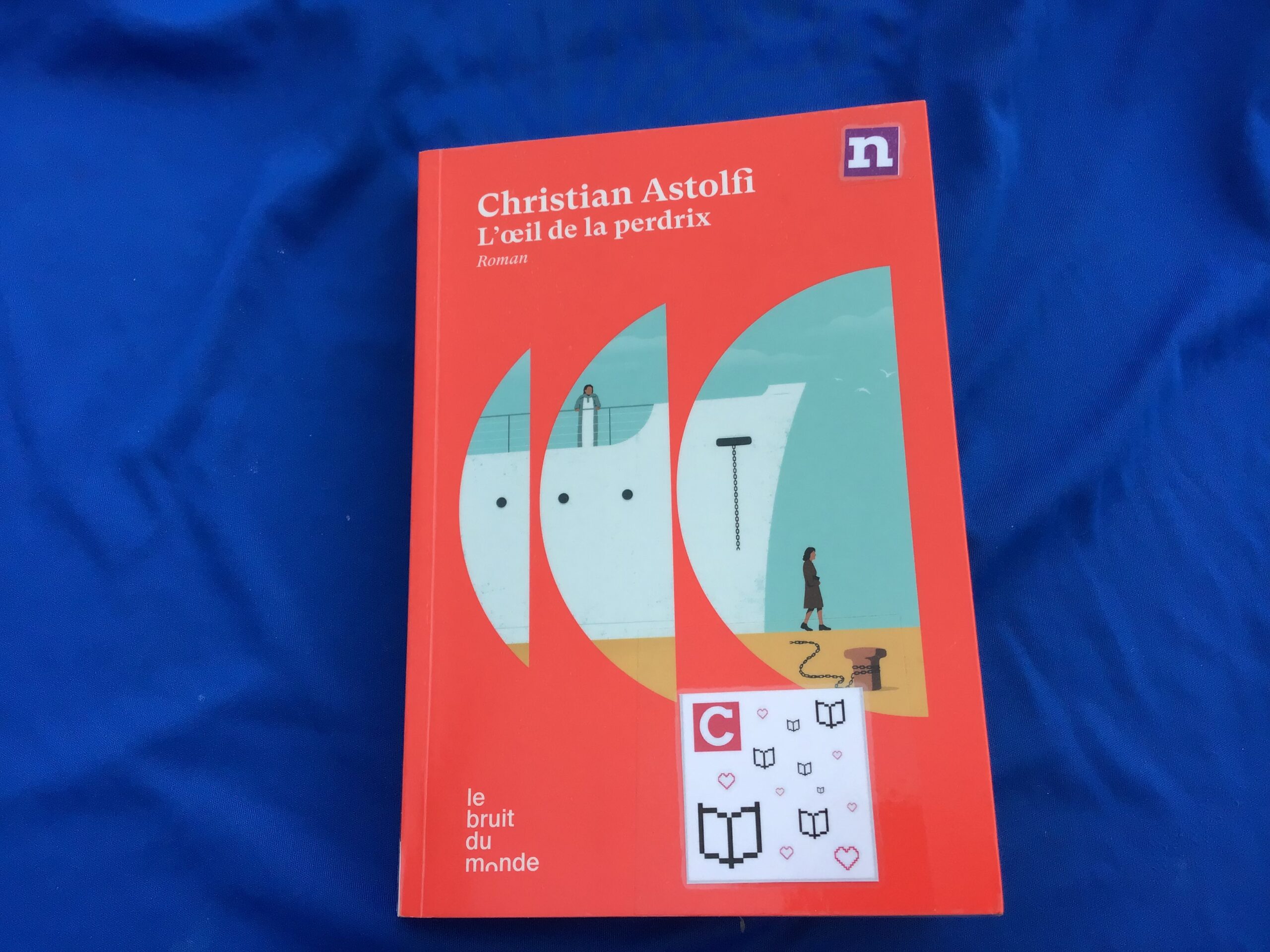Éditions Grasset, 374 pages, août 2025.
« Le livre de kells » est aussi l’histoire d’une jeunesse engagée et d’une époque violente. J’y ai changé des patronymes, quelque faits, parfois bousculé une temporalité trop personnelle pour en faire un roman. La vérité vraie, protégée par une fiction appropriée. »
Cet auteur est un habitué sur Luocine : Retour à Killybegs , Le quatrième mur, La légende de nos pères , Profession du Père, Le jour d’avant , Enfant de salaud .
 Je ne sais pas si ce roman parlera à tout le public mais pour moi, il représente un retour vers ma jeunesse et mes engagements d’alors. Mais contrairement à lui, je n’habitais pas à Paris et à Rennes, les actions violentes n’ont pas existé, mais comme toute la jeunesse engagée tous nos regards allaient vers Paris, où tout semblait se passer.
Je ne sais pas si ce roman parlera à tout le public mais pour moi, il représente un retour vers ma jeunesse et mes engagements d’alors. Mais contrairement à lui, je n’habitais pas à Paris et à Rennes, les actions violentes n’ont pas existé, mais comme toute la jeunesse engagée tous nos regards allaient vers Paris, où tout semblait se passer.
La première partie du roman, raconte le sort terrible du jeune Kells qui a fui la violence de son père et se retrouve seul à Paris. L’auteur raconte avec beaucoup de délicatesse la vie dans la rue. Par moment le désespoir saisit le jeune qui a choisi de s’appelle Kells car il a reçu un jour une carte postale avec cette œuvre qui est un chef d’œuvre de la littérature chrétienne irlandaise en l’an 800. Sa vie lui permet de croiser des êtres très abimés mais aussi très humains. Et surtout montrer l’aspect impitoyable de la vie dans la rue. La difficulté de trouver un toit, au point où un jour il déclare que son rêve le plus fou, serait d’avoir un jour son nom sur une boîte aux lettres. Et tous les petits boulots payés au noir qui permettent rarement de se nourrir correctement, et les abus des gens qui les emploient et qui savent ces gens sans défense. Et puis parfois une femme humaine qui le nourrit et le loge une nuit alors qu’il gèle à Paris.
Un jour, il croise des militants de « La cause du peuple » et parmi ces militants trouvera une nouvelle famille et commencera à lutter avec eux pour qu’enfin le monde change. On retrouve là les luttes des années 70 et certains noms ont résonné jusqu’à Rennes : Pierre Overney assassiné par un membre de la milice de l’usine Renault .
Enfin la dernière partie ce sont les fêlures qui peu à peu amènent Kells à douter de ses engagements : l’affaire de Bruay en Artois où « La Cause du peuple » » a pris fait et cause pour prouver la culpabilité du notaire, quand son innocence éclate la cause maoïste semble ridicule, et puis l ‘assassinat des athlètes israéliens par les palestiniens le trouble beaucoup.
Le livre se termine sur se débuts à Libération avec Serges July.
C’est un roman très bien raconté et très vivant, mais je suis prête à lire des avis négatifs, et après un tour sur Babelio, je vois que si tout le monde a été (comme moi) touché par la première partie où il raconte si bien la vie des SDF, les lecteurs qui n’ont pas connu ces années là, n’ont pas été passionnés par son engagement politique ni par les différentes personnalités de « La cause du peuple ». Je peux le comprendre, d’ailleurs je remarque que les passages que j’ai notés sont tous dans la première partie et pourtant j’ai lu tout ce livre avec un grand intérêt.
Extraits.
Début.
-Tiens, prends ça mon fils, tu en auras besoin.Elle l’avait cherché du regard, partout dans la salle des pas perdus, tournant la tête comme un oiseau inquiet. Ma mère, son front soucieux, ses yeux délavés par le temps.Elle se méfiait. Elles vérifiaient que l’Autre ne l’avait pas suivie.L’ Autre, c’est comme ça que j’appelais mon père.
Pourquoi ce nom et le titre.
Pour eux tous, je m’appelais Kells, comme la ville d’Irlande où Jacques et ses parents avaient campé un été. Partout où il allait en vacances, mon ami postait pour moi, un souvenir coloré. Des places, des monuments célèbres le désert marocain où les gratte-ciel d’Amérique. Mais cette fois, il avait choisi une carte postale reproduisant une gravure médiévale avec cette explication au dos : » Le livre de Kells chef d’œuvre du catholicisme irlandais, ce manuscrit a été rédigé en l’an 800 par des moines de culture celtique sur 185 peaux de veaux mort-nés. » Il avait été impressionné par l’histoire de ce trésor. Moi j’ai été sidéré par sa beauté.
Effet du LSD.
Passant près d’un immeuble mouvant. J’ai été pétrifié. Sur une poubelle grise les mots « Papier svp » m’ont donné une crise d’asthme. Nous étions dans un pays totalitaire. C’était inouïe. Même les poubelles publiques me demandaient mon identité. Elles étaient devenues les auxiliaires zélées des flics et des gendarmes. Je suis passé à un mètre du panneau, mais j’ai refusé d’ obtempérer. Un acte de résistance. J’ai dépassé le danger, attendu un coup de sifflet, compté mes pas une fois encore, mais rien. L’ennemi avait renoncé.
Un ado qui se croit malin auprès du curé de sa paroisse.
Lorsqu’il m’a demandé où j’en étais dans la vie, les études, les certitudes, j’ai essayé de le déstabiliser.J’ai pris ma tête à claques.– Quand je croise une croix, j’ai envie de cracher dessus.C’était faux, c’était bête, j’avais 15 ans.Je m’attendais à ce que mon ancien confesseur s’indigne. Il a fait mini de réfléchir.– Quand tu croises une croix, tu as envie de cracher dessus ?Répétée par ses lèvres, ma phrase semblait ridicule.J’ai aussi la tête, sans un mot.Il a posé la main sur mon épaule, un sourire immense sur le visage.– Tu vois toujours la croix ? Alors, c’est un bon début, mon fils.Et il est reparti en trottinant, content du bon tour qu’il venait de me jouer.
La misère totale.
J’ai marché le jour la nuit sous le vent du nord et dans le froid. Je me suis réfugié au cœur du pire. Un parking gelé, une décharge à ordure, une vespasienne. Mes pieds étaient brûlés. Ma peau lacérée. Mon ventre, dévoré par le mépris de moi-même. Je n’étais plus un homme, j’étais une défaite.Jamais je n’avais imaginé que je serais aussi seul au monde.
Un beau geste et si bien raconté.
J’étais devenu un pauvre.Un soir, boulevard de Ménilmontant, une dame âgée m’a fait entrer chez elle. Elle m’a surpris devant sa porte, aveuglé par la minuterie de l’escalier. Elle m’a vu, sorti du sommeil désemparé, les mains entre les cuisses et mon sac-à-dos pour oreiller. Elle n’a rien dit. Après être entrée dans son petit appartement, elle a laissé la porte ouverte. Comme ça. Un rayon de lumière dans mon obscurité. Alors je l’ai suivie. Avec mon visage de nuit, ma cape ridicule et la faim au ventre. Je suis resté debout dans l’entrée, mon sac à bout de bras. Et elle a fait comme si je n’étais pas là. Elle a enlevé son manteau d’hiver et fait chauffer des restes. Du veau, une sorte de ratatouille des haricots en plus. Et puis d’un geste de la main, elle m’a proposé un siège. Elle a ajouté mon assiette à la sienne. C’était une mère. Elle ne me craignait pas.Nous avons dîné face à face sans question sans un mot. Elle et moi, dans notre cuisine commune. J’ai su qu’elle me ferait une place dans un fauteuil ou un canapé pour la nuit. A son regard tranquille, j’ai compris qu’elle avait pris soin d’autres enfants que moi. Ces gestes disaient d’habitude, et la fraternité. J’étais le bienvenu.