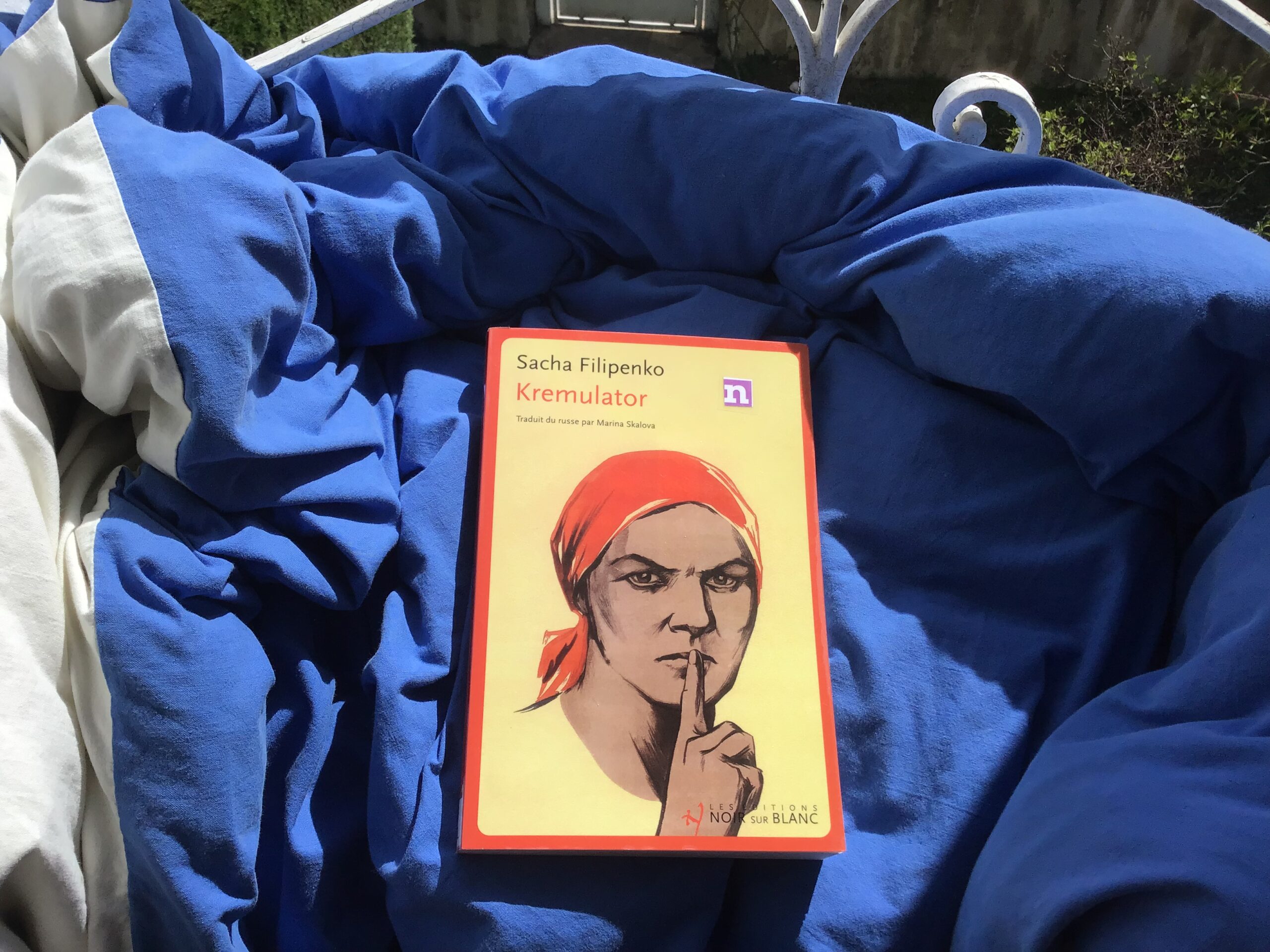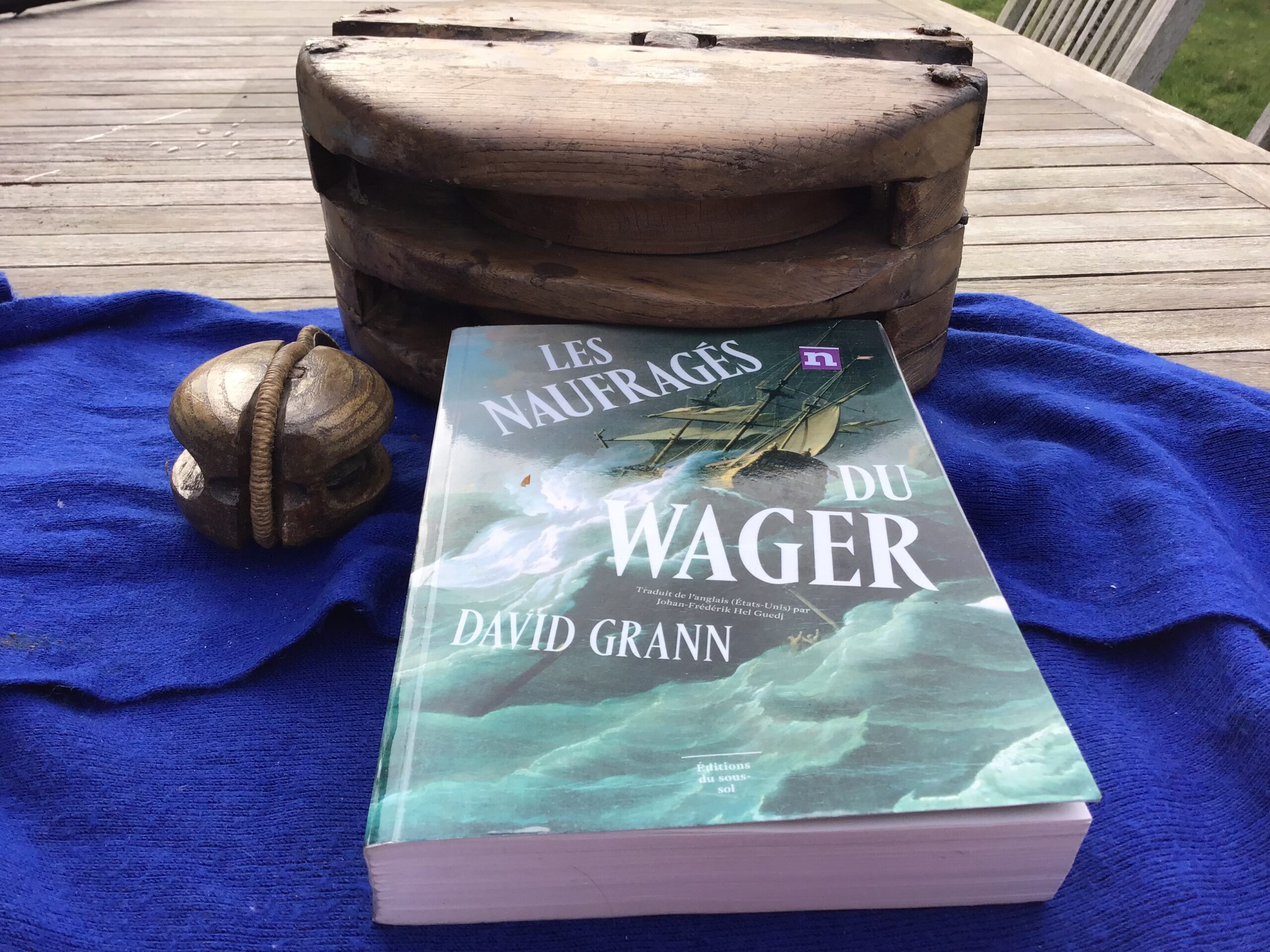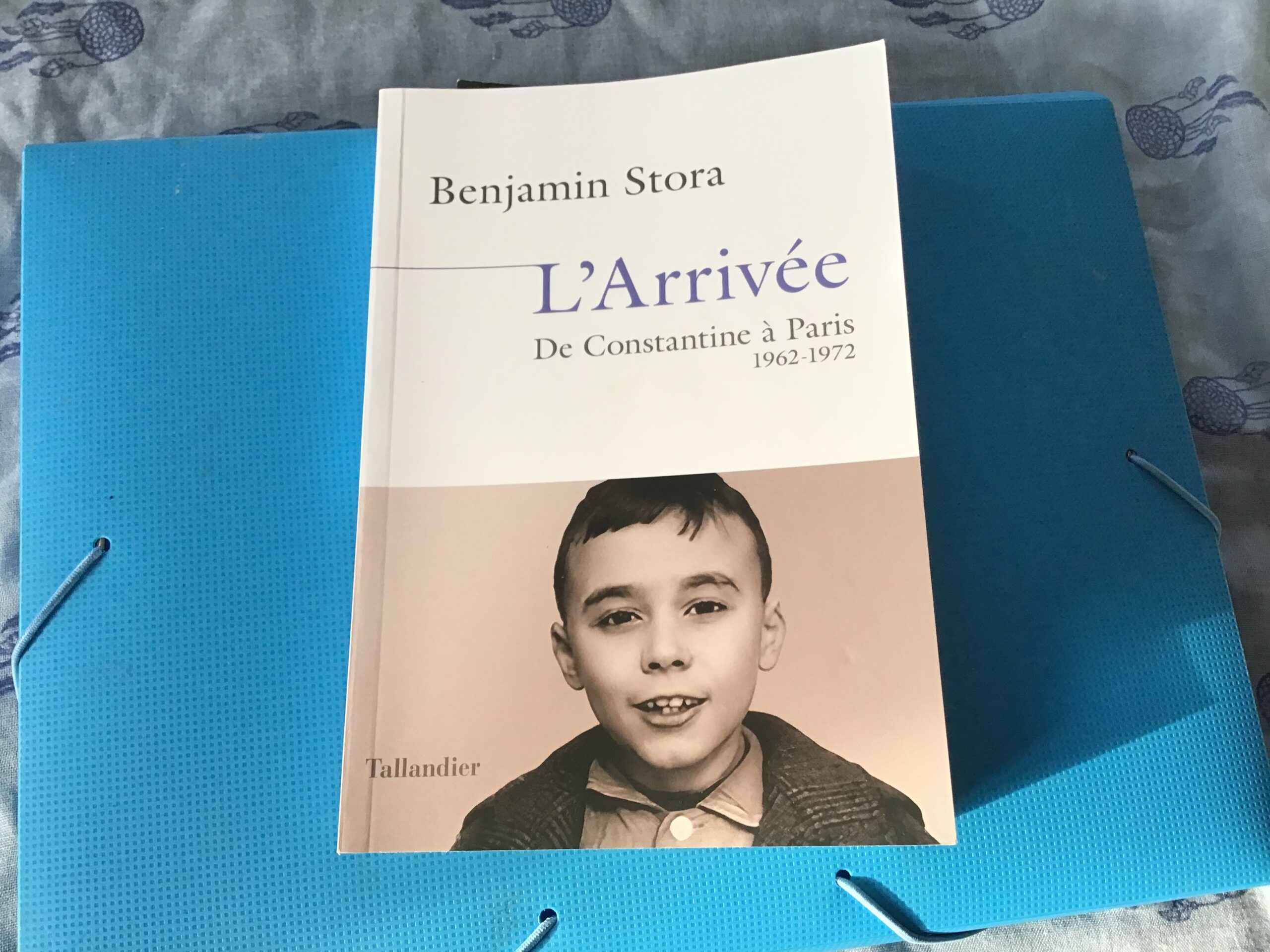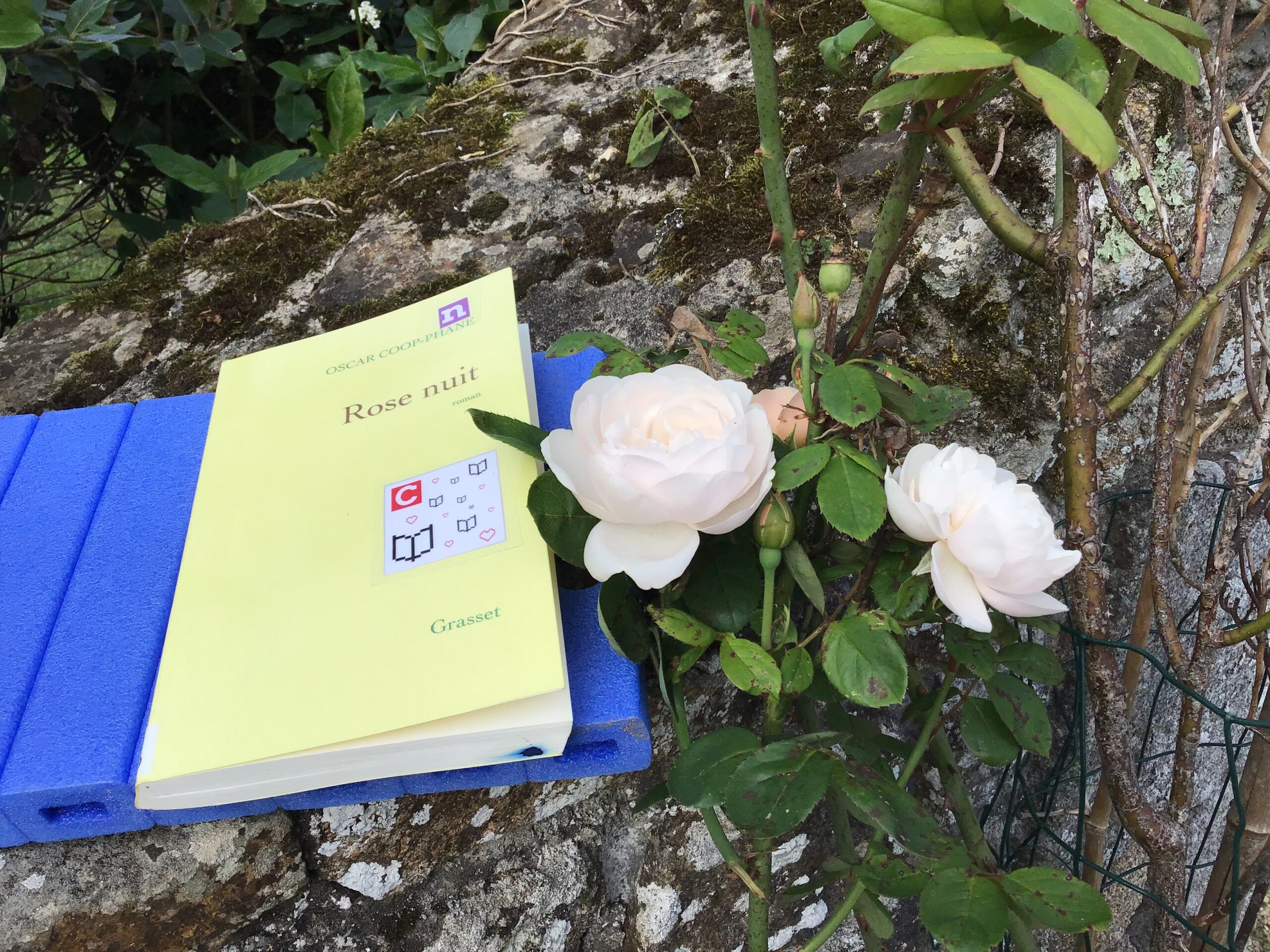Édition Albin Michel,406 pages, septembre 2022
Traduit de l’anglais par Marina Boraso
 Quel livre ! Quelle famille ! Embarquez-vous, avec ce roman, dans une lente déambulation dans le passé, de 1870 à nos jours, pour retrouver non pas « le temps » mais la mémoire d’Edmund de Waal descendant de la famille Ephrussi et céramiste connu. Il a hérité de son oncle une collection de « netsukes ». Ce sont de très petites sculptures venant du Japon qui servaient à bloquer une pochette qu’autrefois le Japonais portait à sa ceinture quand il était habillé de façon traditionnelle. Ce sont de tout petits objets mais souvent merveilleusement sculptés et expressifs. C’est en suivant l’histoire de cette collection qu’Edmund de Waal va raconter l’histoire de sa famille.
Quel livre ! Quelle famille ! Embarquez-vous, avec ce roman, dans une lente déambulation dans le passé, de 1870 à nos jours, pour retrouver non pas « le temps » mais la mémoire d’Edmund de Waal descendant de la famille Ephrussi et céramiste connu. Il a hérité de son oncle une collection de « netsukes ». Ce sont de très petites sculptures venant du Japon qui servaient à bloquer une pochette qu’autrefois le Japonais portait à sa ceinture quand il était habillé de façon traditionnelle. Ce sont de tout petits objets mais souvent merveilleusement sculptés et expressifs. C’est en suivant l’histoire de cette collection qu’Edmund de Waal va raconter l’histoire de sa famille.
Celui qui l’a constituée, Charles Ephrussi, est un très très riche dandy de la fin du XIX ° siècle, collectionneur d’art, il est certainement l’homme qui a inspiré Proust pour construire le personnage de Swann. Dans cette première période, on se croit dans l’oeuvre de Proust qui a effectivement connu Charles Ephrussi. Cette période en France est marquée par un antisémitisme de « bon ton » mais cela n’empêche pas les juifs de faire des affaires et de vivre assez bien. On voit la construction près du parc Monceau de merveilleuses maisons , dont la demeure des Camondo qui est un des musées parisiens que j’aime visiter. (La famille Camondo finira à Auschwitz.)
Ensuite, nous irons à Vienne du temps de la grandeur des Ephrussi, les banquiers les plus riches de l’Europe avec les Rothschild . Leur fortune vient d’Odessa et s’est faite avec le commerce du blé. La collection de Charles a été un des cadeau de mariage pour Emmy et Viktor qui ont construit le palais Ephrussi sur le Ring à Vienne. C’est une période faste de presqu’un siècle. La famille est immensément riche et se sent heureuse à Vienne. Cette période est passionnante, l’empire s’effondre après la guerre 14/18 et la famille est pratiquement ruinée mais il se relèveront. L’antisémitisme autrichien est virulent, alors que l’empereur avait décidé de protéger les juifs. Les juifs des pays de l’est qui ont été victimes de pogroms avant la guerre se sont réfugiés en Autriche et en Allemagne, l’antisémitisme en était d’autant plus fort, (l’accueil en grand nombre de gens fuyant la misère et les persécutions est un problème brûlant d’actualité en Europe aujourd’hui). D’un côté il y avait ces riches banquiers et de l’autre ces miséreux que l’on méprisait. Comme l’Autriche a du mal à se relever de la guerre et a perdu sa grandeur, il est facile de chercher des boucs émissaires. Les enfants dont la grand-mère de l’auteur se souviennent bien d’avoir jouer avec ces petits Netsukes.
Et puis, il y a le nazisme et la famille est entièrement spoliée aussi bien leur banque que leurs biens immobiliers et leurs collections. Les Netsukes seront sauvés par une domestique, Anna, qui va les cacher dans son matelas et les rendra à la famille après la guerre. Elle est bien la seule à avoir voulu protéger les biens de la famille et pourtant l’histoire ne connaîtra que son prénom.
La famille est maintenant éclatée entre le Mexique, les USA, l’Angleterre et le Japon. Nous suivons la collection de Netsuke qui est repartie au Japon avec Ignace. Cette partie sur le Japon permet de comprendre d’où viennent ces petites statuettes. La vie au Japon sous la domination américaine est rapidement évoquée, on voit à quel point le démarrage de l’économie a été difficile au début et puis a fini par s’envoler.
La recherche d’Edmund de Waal est très intéressante, même si c’est parfois un peu lent, sans aucune surprise le moment le plus douloureux c’est le nazisme en Autriche et la façon dont après la guerre, les Autrichiens, contrairement aux Allemands, n’ont pas voulu analyser leurs responsabilités dans l’extermination des juifs. Evidemment les réparations pour la famille Ephrussi est totalement ridicule ! La grand mère de l’écrivain, Elisabeth, a recherché les biens de sa famille et comme c’est une juriste elle a su parfois arracher quelques tableaux à une administration autrichienne très peu coopérative. J’adore cette femme remarquable qui a lutté toute sa vie, pour suivre des études universitaires à Vienne, et qui a réussi à arracher son père aux Nazis. Emmy, sa mère, s’est sans doute suicidée.
C’est un livre assez long et très fouillé, je m’y suis sentie très bien, surtout n’imaginez pas que l’antisémitisme est l’aspect le plus important de ce roman, même si mes extraits ont tendance à le montrer, c’est un sujet auquel je suis très sensible . J’ai été triste de refermer ce roman et de laisser cette famille continuer sa vie, je l’espère de façon heureuse
Extraits
Le début.
Je pars à la rencontre de Charles sous le soleil d’une après-midi d’avril. La rue de Monceau est une longue rue parisienne coupée par le boulevard Malesherbes, qui monte tout droit vers le boulevard Pereire, où se dressent des immeubles de pierres chaudes une succession d’hôtels particuliers aux façades rustiquées qui jouent discrètement avec des motifs néoclassiques, petits palais florentins décorés de têtes sculptées de caryatides et de cartouches. Voici celui je cherche, juste après le siège de Christian Lacroix. Je découvre accablé qu’il est occupé aujourd’hui par une compagnie d’assurances médicales.
Les frères Goncourt.
C’est dans les salons de Paris que Charles se fait remarquer pour la première fois. Edmond de Goncourt, romancier, diariste et collectionneur connu pour sa plume acerbe, le mentionne dans son Journal, dégoûté que des personnages tels que lui puissent y être conviés. Il note que les salons sont désormais « infestés de juifs et de juives » et qualifie les jeunes Ephrussi de « mal élevés » et d' »insupportables ». Il insinue que Charles omniprésent, n’a aucune conscience de la place qui est la sienne ; recherchant le contact à tout prix, il est incapable de masquer ses aspirations et de s’effacer au moment opportun.
L’influence japonaise en 1870 à Paris.
Voilà une évocation saisissante de ce que signifie être un étranger au sein d’une nouvelle culture, remarquable seulement par votre mise ultra-soignée. Le passant jette un second coup d’œil, et votre déguisement ne vous dénonce que parce qu’il est trop complet.Cela trahit également le caractère d’étrangeté de cette rencontre avec le Japon. Bien que les japonais fussent très rares à Paris dans les années 1870 – quelques délégations, des diplomates et un principe de temps à autre -, l’art de leur pays était omniprésent. Tout le monde se précipitait sur les « japonaiseries ».
Drumont.
Cependant les Ephrussi se pensent indéniablement chez eux à Paris, ce qui n’est pas l’opinion de Drumont. Celui-ci déplore en effet de voir « des juifs vomis par tous les ghettos, installés maintenant en maîtres dans les châteaux historiques qui évoquent les plus glorieux souvenirs de la vieille France…des Rothschild partout : à Ferrières et au Vaux-de-Cernay .. Ephrussi à Fontainebleau à la place de François 1er « . L’ironie de Drumont devant ces aventuriers sans sou rapidement enrichis, qui se piquent de chasse à courre et s’inventent des armoiries, se change en colère vindicative lorsqu’il juge le patrimoine national souillé par les Ephrussi et leurs pareils.
1914.
La situation ne manque pas de cruauté. Les cousins français, autrichiens et allemands, les citoyens russes, les tantes britanniques -toute cette consanguinité redoutée, cette mentalité nomade soi- disant dénuée de patriotisme- se trouvent contraints de prendre parti. À quel point une famille peut-elle se diviser ? Oncle Pips est mobilisé superbe dans son uniforme à col d’astrakan, et devra se battre contre ses cousins français et anglais.
Deux voix discordantes dans le concert pro-guerre à Vienne.
Schnitzler, en revanche, exprime son désaccord. Le 5 août, il écrit simplement : « Guerre mondiale. Ruine mondiale. » Karl Kraus, lui, souhaite à l’empereur une « agréable fin du monde ».Vienne est en fête. Par groupes de deux ou trois les jeunesse se rendent au bureau de recrutement, un petit bouquet fixé à leur chapeau. La communauté juive est d’humeur optimiste. Les juifs, affirme Josef Samuel Bloch, « sont non-seulement les plus fidèles champions de l’empire, mais aussi les seuls Autrichiens inconditionnels ».
Vienne après la guerre 14/18.
Vienne qui compte près de deux millions d’habitants, a cessé d’être la capitale d’un empire de cinquante-deux millions de sujets pour faire partie d’un minuscule pays de six millions de citoyens. Il lui est impossible de s’adapter à un tel cataclysme. On débat intensément sur la viabilité de l’Autriche en tant qu’état indépendant, d’un point de vue tant économique que psychologique. L’Autriche paraît incapable de faire face à pareil amoindrissement. Les conditions de la « paix carthaginoise » dures et punitives définies par le traité de Saint-Germain-en-laye en 1919, prévoient un démembrement de l’empire. Il ratifie l’indépendance de la Hongrie, de la Tchécoslovaquie, de la Pologne et de la Yougoslavie, et de l’État des Slovènes, Croates et Serbes. L’Istrie et Trieste ne font plus partie de l’empire, amputé également de plusieurs îles de Dalmatie. L’Autriche-Hongrie devient l’Autriche un pays de 750 km de long. Des réparations sont exigées. L’armée réformée rassemble trente mille engagés. Pour citer une boutade de l’époque, Vienne ressemble à un « Wasserkopf », chef hydrocéphale d’un corps atrophié.
Sa grand-mère Elisabeth Ephrussi.
Je sais qu’Elisabeth n’avait pas vraiment le goût des objets -netsukes ou porcelaine- pas plus qu’elle n’aimait des complications de la toilette. Dans son dernier appartement, elle avait un mur tapissé de livres alors que les bibelots, un chien en terre cuite chinoise et trois pots à couvercle, n’occupaient qu’une petite étagère. Elle m’encourageait dans mon travail de céramiste et m’envoya même un chèque pour m’aider à financer mon premier four, mais cela ne l’empêchait pas de trouver assez drôle que je gagne ma vie en fabriquant des objets. Elle n’aimait rien tant que la poésie, ou l’univers des choses, dense, défini et vivant, est transformé en chant. Elle aurait détesté le culte dont j’entoure ses livres.
Le jour de l’Anschluss.
Dans toute la ville, on défonce les portes et les enfants se cachent derrière leurs parents et se réfugient sous les lits ou dans les placards, essayant d’échapper au bruit pendant qu’on arrête et qu’on moleste leurs pères et leurs frères avant de les pousser dans des camions, pendant que l’on abuse de leur mère ou de leur sœur. Dans toute la ville des gens font main basse sur ce qui devrait leur appartenir sur ce qui leur vient de droit.Il n’est pas question de dormir, on ne songe même pas à aller se coucher. Quand ces hommes s’en vont, quand ces hommes et ces garçons finissent par partir, ils promettent qu’ils reviendront et il est clair qu’ils disent vrai. Ils emportent le collier de perles qu’Emmy porte autour de son cou et ses bagues. L’un d’eux s’arrête pour lancer un gros crachat à leurs pieds. Il dévale l’escalier à grand bruit, hurlant jusque dans la cour. Un homme prend son élan pour taper dans les débris à coups de pied, puis ils sortent sur le Ring par la grande porte, l’un d’eux tenant sous le bras une grosse pendule.
L’émotion du petit fils (l’auteur) .
Le palais Ephrussi, la banque Ephrussi ont cessé d’exister à Vienne. La ville a été « nettoyée » de cette famille.C’est pendant ce séjour que je me rends aux archives juives de Vienne – celles qu’Eichmann avait saisies- afin de vérifier certains détails sur un mariage. Cherchant Viktor dans un des registres, je découvre un tampon rouge officiel par-dessus son prénom : « Israël ». Un décret a imposé aux juifs un changement de nom. Quelqu’un a passé en revue tous les prénoms de la liste des juifs de Vienne pour y apposer ce tampon : « Israël » pour tous les hommes, « Sara » pour toutes les femmes.Je me trompais la famille n’a pas été effacée, elle a été recouverte. Et c’est cela finalement qui me fait pleurer.
L’après.
Très peu de juifs choisiront de retourner à Vienne. Sur les 185000 juifs d’Autriche au moment de l’Anschluss, seulement 4500 y reviendront, tandis que 65459 ont trouvé la mort.Après la guerre personne n’a eu répondre de cela. En 1948 la république démocratique d’Autriche instaurée à l’issue du conflit a accordé l’amnistie à 90 % des anciens adhérents du parti nazi, et en a fait autant dès 1957 pour les SS et les membres de la Gestapo