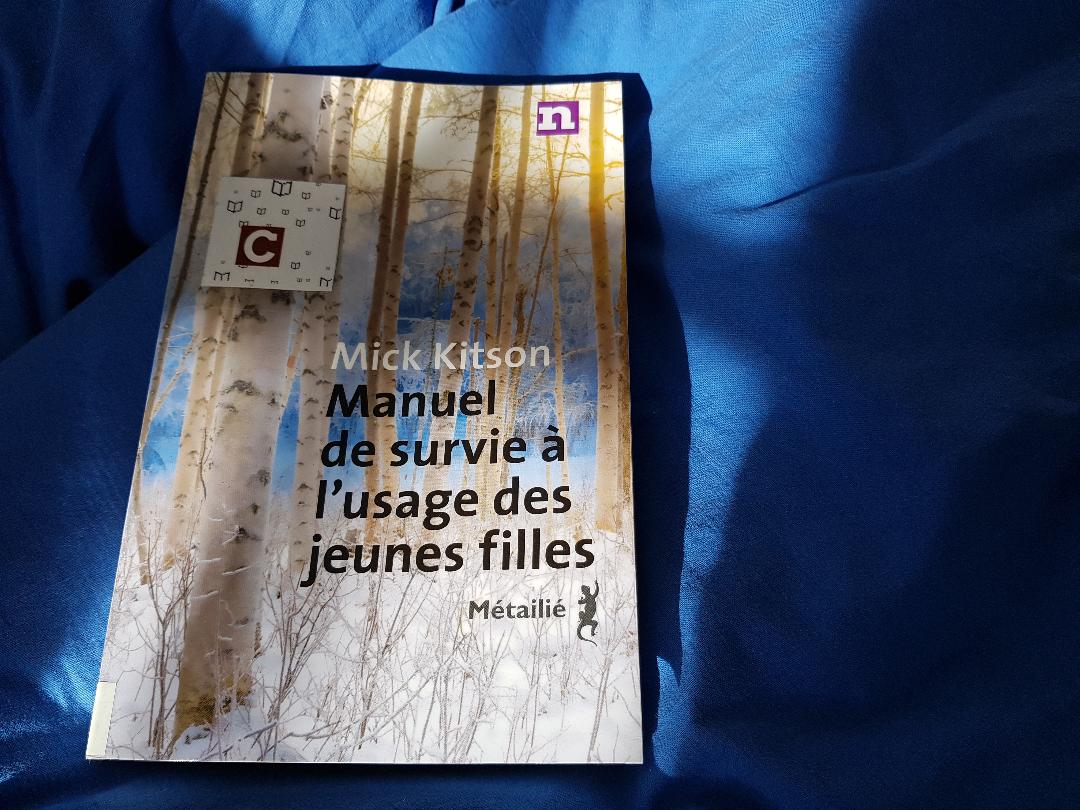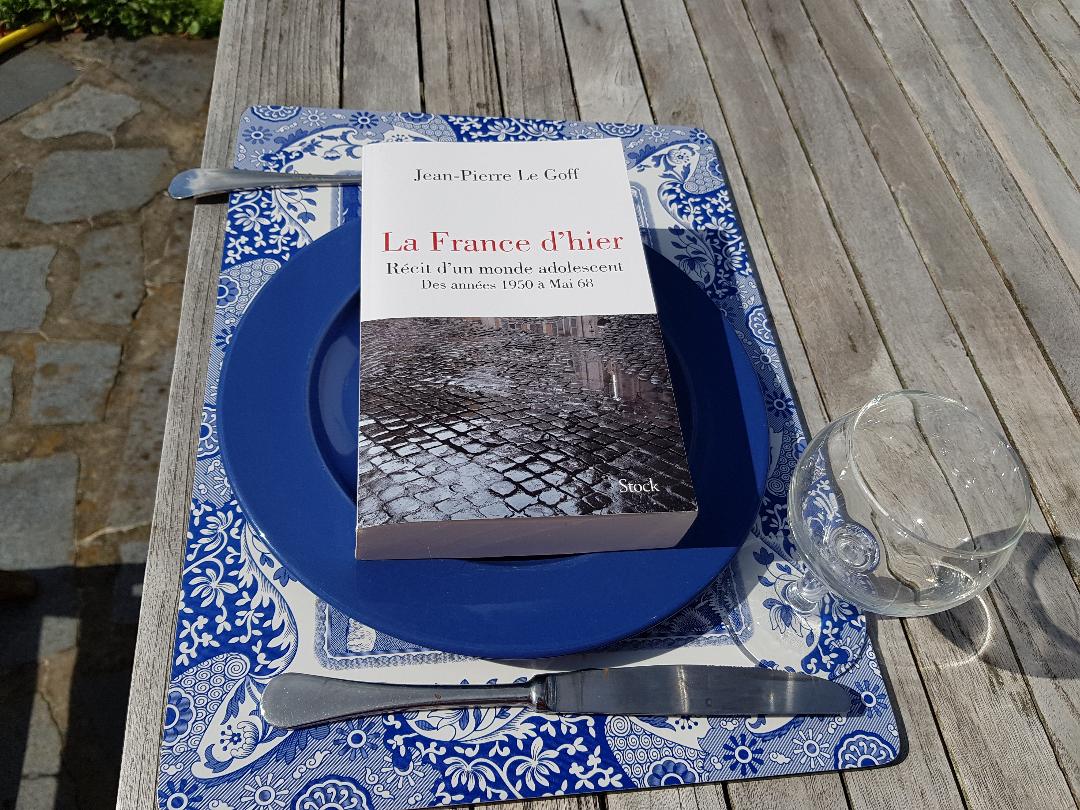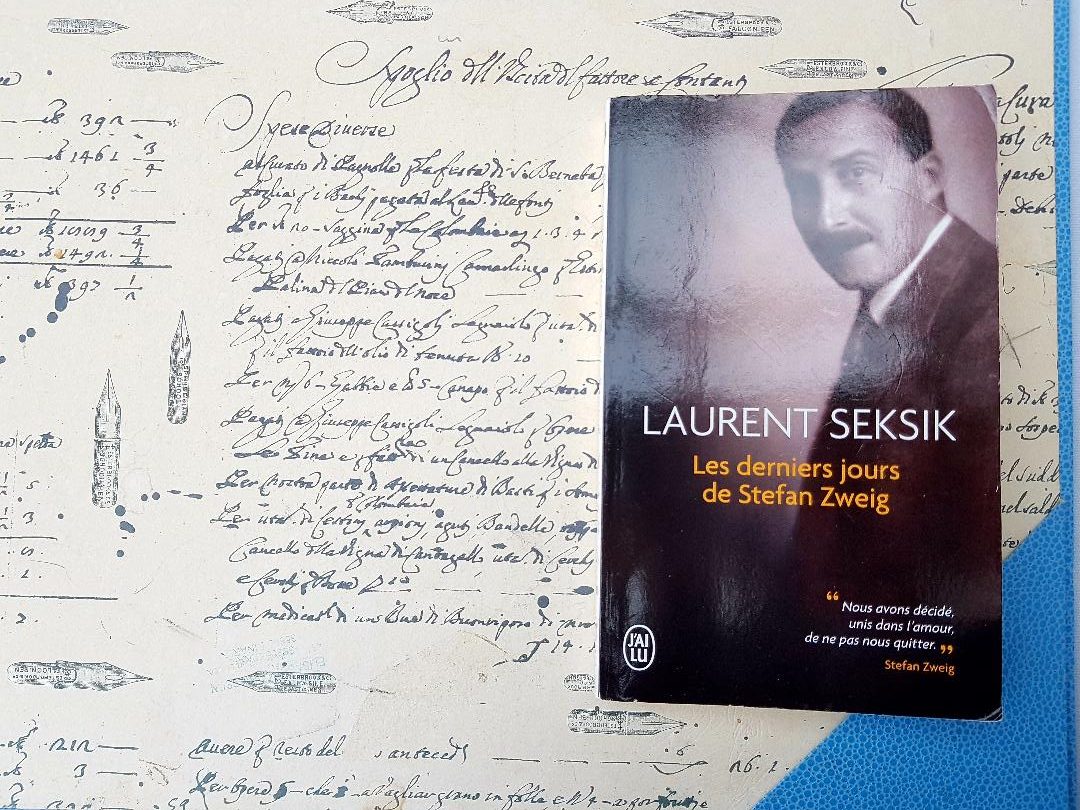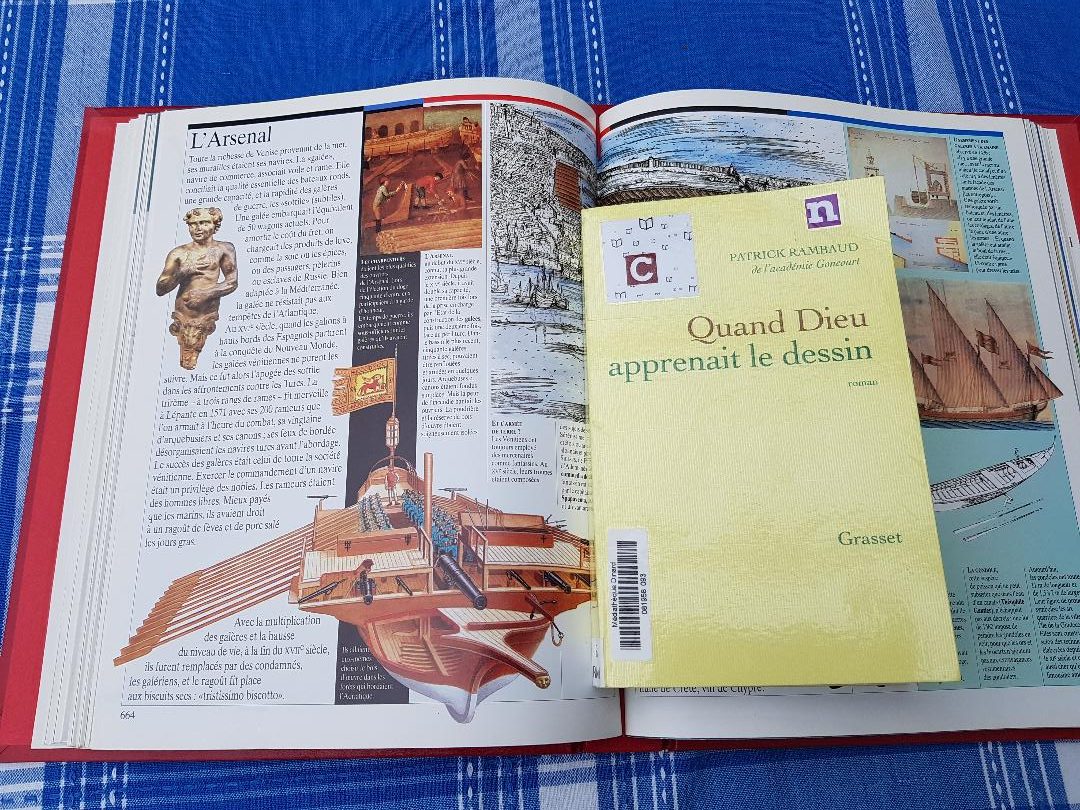Traduit de l’anglais écosse par Céline Schwaller
Lu dans le cadre du club de lecture de la médiathèque de Dinard
 Véritable coup cœur pour moi que je n’explique pas complètement. Je vais énumérer ce qui m’a plu :
Véritable coup cœur pour moi que je n’explique pas complètement. Je vais énumérer ce qui m’a plu :
- J’ai retrouvé l’ambiance des films britanniques que j’apprécie tout particulièrement au festival de Dinard.
- J’ai adoré les sentiments qui lient les deux héroïnes, deux sœurs différentes mais qui s’épaulent pour sortir de la mouise.
- Je suis certaine que, lorsqu’on va mal, la beauté de la nature est une source d’équilibre.
- Les personnages secondaires ont une véritable importance et enrichissent le récit.
- La mère va vers une rédemption à laquelle on peut croire.
- La fin n’est pas un Happy-End total mais rend le récit crédible.
- Le caractère de la petite est drôle et allège le récit qui sinon serait trop glauque.
Voilà entre autre, ce qui m’a plu, évidemment la survie dans la nature encore sauvage des Highlands est difficile à imaginer, pour cela il faut deux ingrédients qui sont dans le roman. D’abord un besoin absolu de fuir la ville et ses conforts. Sal l’aînée en fuyant l’horreur absolue de sa vie d’enfant a commis un geste qui ne lui permet plus de vivre chez elle. Il faut aussi que les personnes soit formées à la survie en forêt, et Sal depuis un an étudie toutes tes façons de survivre dans la nature. Malgré ces compétences, les deux fillettes auront besoin d’aide et c’est là qu’intervient Ingrid une femme médecin qui a fui l’humanité elle aussi, mais pour d’autres raisons. Sa vie est passionnante et c’est une belle rencontre. C’est difficile à croire, peut-être, mais j’ai accepté ce récit qui est autant un hymne à la nature qu’un espoir dans la vie même quand celle-ci a refusé de vous faire le moindre cadeau.
Les Highlands :
Citations
La maltraitance
J’avais envisagé de le raconter pour Robert et qu’il comptait bientôt aller dans la chambre de Peppa aussi qu’il battait m’man et qu’il était saoul et défoncé tout le temps. Mais je savais que la première chose qui se passerait serait qu’il se ferait arrêter et qu’on nous emmènerait et qu’on serait séparé parce que c’est ce qui se passait toujours. En plus personne ne croirait que m’man n’était pas au courant et on l’accuserait peut-être de maltraitance ou de négligence et elle irait en prison. J’avais lu des histoires là dessus sur des sites d’informations, où la mère était condamnée et allait en prison et où le beau-père y allait pour plus longtemps parce que c’était lui qui avait fait tous les trucs horribles comme tuer un bébé ou affamer une petite fille, mais il disait que la mère avait laissé faire et elle se faisait coffrer aussi. Ils accusent toujours la mère d’un gamin qui se fait maltraiter au frapper, mais c’est toujours l’homme qui le fait.
L’étude de la survie
Tout en attendant à côté du feu éteint d’entendre quelque chose j’ai essayé de mettre un plan au point. Les chasseurs essaient de prévoir la réaction de leur proie pour savoir où et quand il les trouveront, ils savent ce qu’elles cherchent comme de l’eau et de la nourriture et ils adaptent leur propre comportement en fonction. Les prédateurs exploitent les besoins des proies pour essayer de les attraper quand elles sont les plus vulnérables comme lorsqu’elles font caca ou se nourrissent.
La nature
C’était la première fois que je voyais des blaireaux ailleurs que sur un écran et même s’ils étalent plus gros qu’on aurait pu le croire ils se déplaçaient en souplesse avec leur dos qui ondulait. Les deux plus petits ont commencé à fouiner dans la neige et les feuilles et l’un d’eux n’arrêtait pas de partir et de revenir en courant vers les autres comme s’il voulait jouer. Le gros a humé l’air puis il est parti sur une des pistes qui venait presque droit sur nous. Les deux autres l’ont suivi et tous les trois se sont approchés de nous en ondulant et la m’man m’a saisi la main et me l’a serrée quand je l’ai regardée elle avait la bouche ouverte sur un immense sourire et ses yeux étaient tout écarquillés et brillant comme si elle n’en revenait pas. Comme les trois blaireaux s’approchaient de plus en plus de notre arbre on est resté parfaitement immobile. Ils ont continué d’avancer et on les entendait gratter dans la neige et on voyait les poils gris et noir de leur pelage bouger et ondoyer à mesure qu’ils marchaient. À environ quatre mètres de nous le gros s’est arrêté puis il a levé la tête et nous a regardé bien en face. Il nous fixait dans les yeux tandis que les deux autres avaient le nez baissé et continuaient de renifler et de gratter la terre derrière lui. Ils ont levé les yeux à ce moment là et nous ont fixé tous les trois. J’avais envie de rire parce qu’ils avaient l’air carrément surpris avec leurs petites oreilles dressées. M’man relâchait son souffle très doucement. On est restées comme ça pendant que les minutes passaient dans le bois silencieux, maman et moi sous un arbre en train de fixer trois blaireaux.