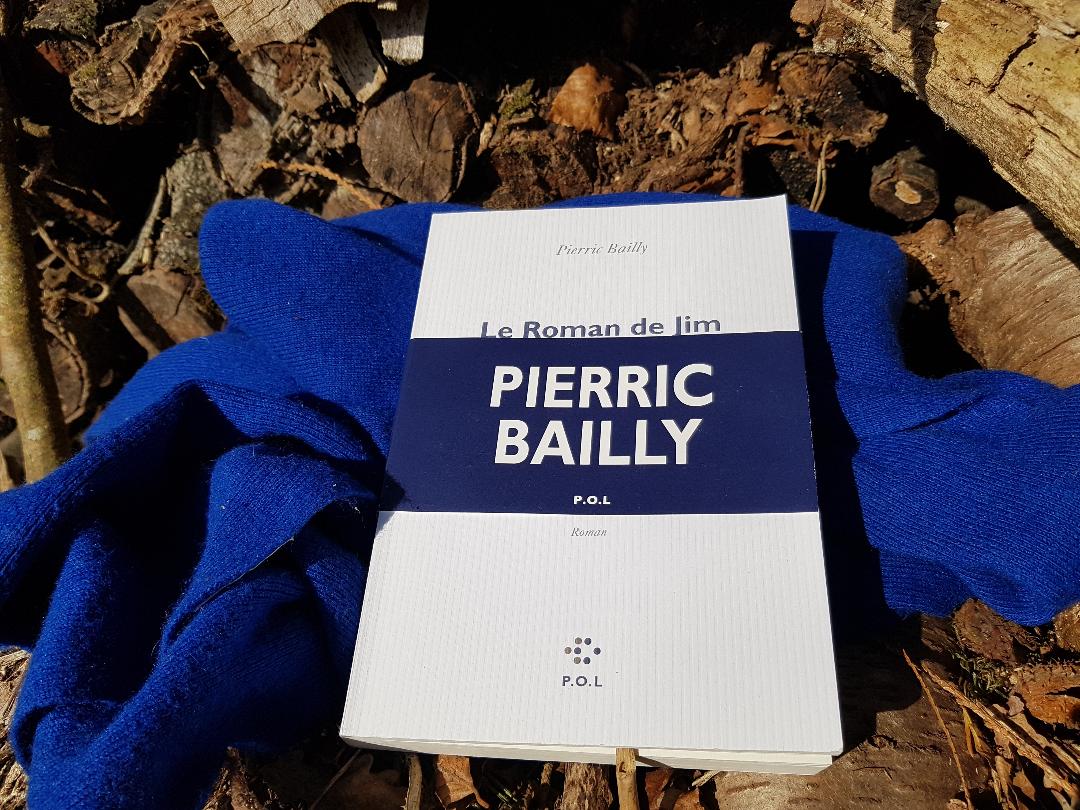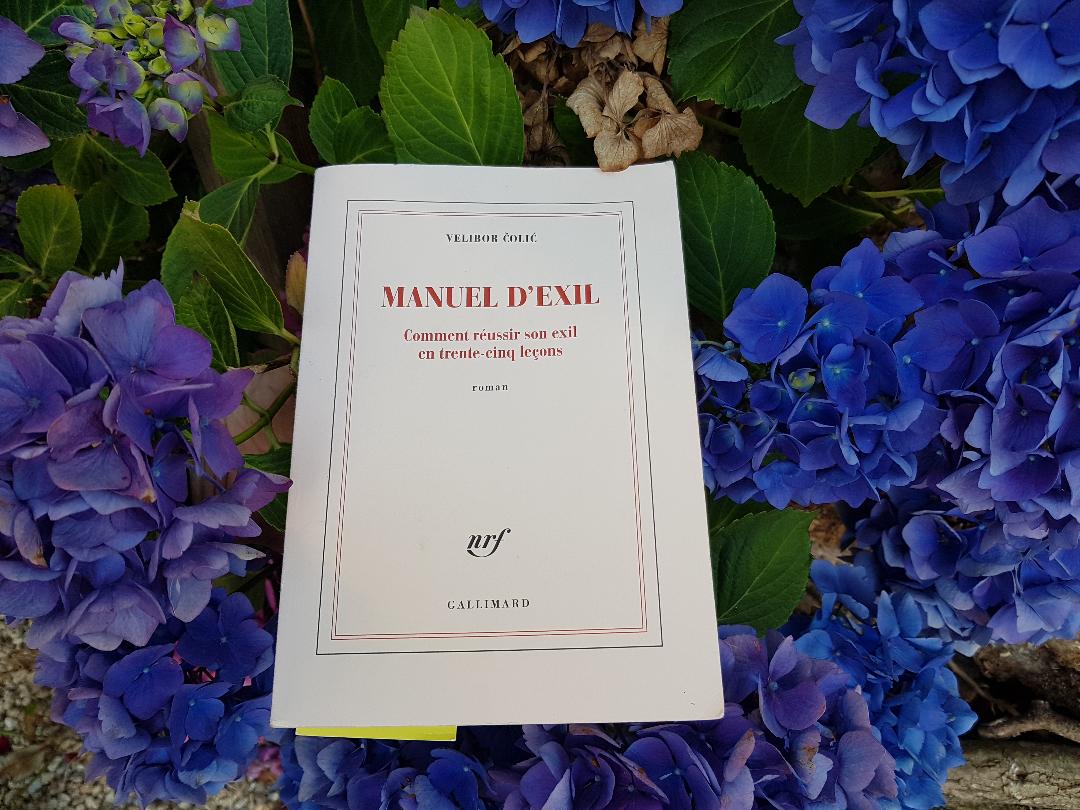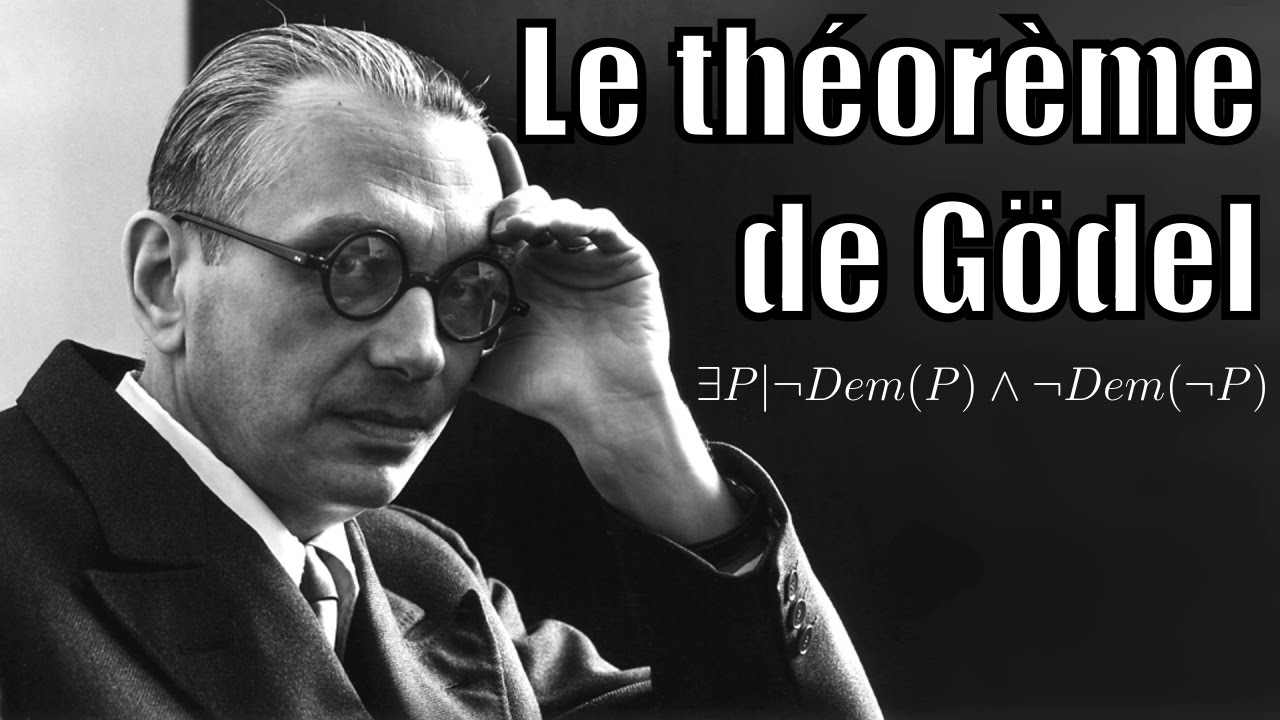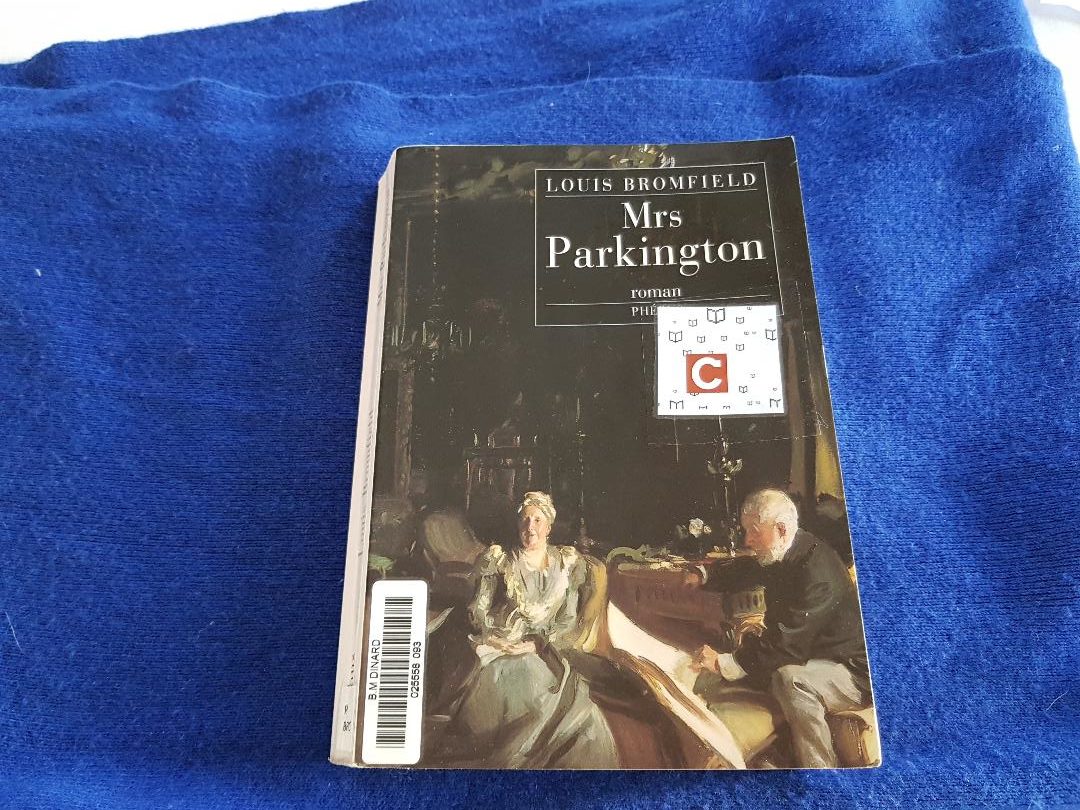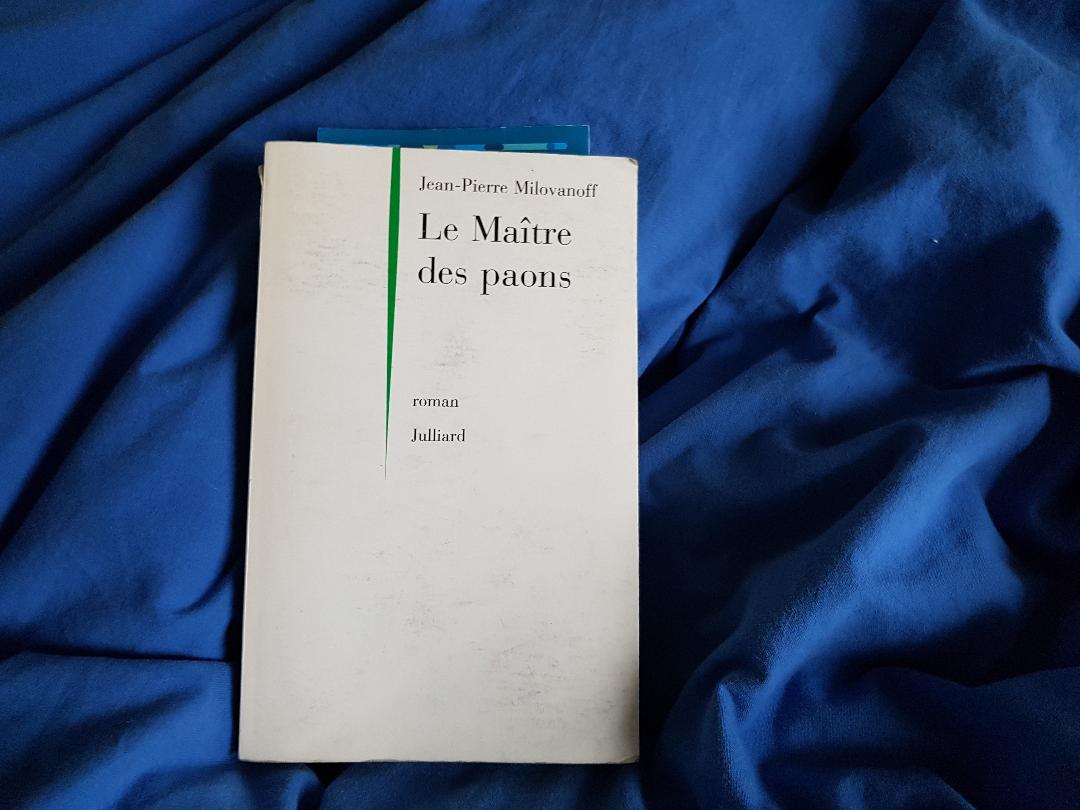Édition Flammarion. Traduit de l’italien par Juliette Bertrand.
 Ce roman a été écrit en 1961 et il reste encore une référence pour comprendre comment fonctionnait la Mafia sicilienne. (En espérant que les choses aient changé !) Il est si connu ce roman que l’auteur qui a fait une carrière politique est devenu le spécialiste de la Mafia (Un peu trop semble-il à son goût !). J’ai cherché l’explication du titre, je n’ai rien vu d’évident. Je me lance dans une hypothèse, la recherche du coupable peut être devant les yeux de tout le monde, la mafia va rendre les évidences invisibles, comme les yeux d’une chouette qui ne voient rien à la lumière du soleil. Le roman se divise en moments différents que le lecteur doit lui-même relier les uns aux autres. La scène initiale ressemble à une scène de film : un bus part sur la place du village, un homme court pour rattraper le bus, le chauffeur ralentit, ouvre la porte, deux coups de feu l’homme s’écroule. Le bus se vide, les carabiniers arrivent, personne n’a rien vu. Ensuite l’enquête va se poursuivre, le commissaire est un homme du nord, pour qui la vérité et la logique semblent des valeurs fondamentales. Grâce à cette enquête, l’auteur nous montre que la vérité est là devant les yeux de tous. L’homme abattu, l’a été car il ne voulait pas payer l’argent de la corruption. Et, lorsque le commissaire remonte vers cet argent, tout le pouvoir local, mais hélas pour son enquête, également le pouvoir à Rome, commencent à trembler. Et si le pouvoir tremble, le commissaire a beau faire un travail remarquable, tout va redevenir « normal » et personne ne sera inquiété pour ce qui va devenir une banale histoire de passion amoureuse. Le pire des truands aura un alibi suffisant pour que l’enquête s’arrête. Evidemment en 1961, ce roman devait avoir un autre poids qu’aujourd’hui. Le fonctionnement de la Mafia nous est aujourd’hui beaucoup mieux connu, le romancier rappelle que le seul régime qui avait réussi à éradiquer la Mafia c’est le fascisme de Mussolini, et ce sont les Américains qui ont permis à ces bandits de revenir en force. Le charme de ce roman est dans son écriture, surtout à la structure du récit. L’auteur ne semble jamais prendre parti, il nous montre en toute objectivité les faits, il y a un détachement qui rend la situation encore moins acceptable.
Ce roman a été écrit en 1961 et il reste encore une référence pour comprendre comment fonctionnait la Mafia sicilienne. (En espérant que les choses aient changé !) Il est si connu ce roman que l’auteur qui a fait une carrière politique est devenu le spécialiste de la Mafia (Un peu trop semble-il à son goût !). J’ai cherché l’explication du titre, je n’ai rien vu d’évident. Je me lance dans une hypothèse, la recherche du coupable peut être devant les yeux de tout le monde, la mafia va rendre les évidences invisibles, comme les yeux d’une chouette qui ne voient rien à la lumière du soleil. Le roman se divise en moments différents que le lecteur doit lui-même relier les uns aux autres. La scène initiale ressemble à une scène de film : un bus part sur la place du village, un homme court pour rattraper le bus, le chauffeur ralentit, ouvre la porte, deux coups de feu l’homme s’écroule. Le bus se vide, les carabiniers arrivent, personne n’a rien vu. Ensuite l’enquête va se poursuivre, le commissaire est un homme du nord, pour qui la vérité et la logique semblent des valeurs fondamentales. Grâce à cette enquête, l’auteur nous montre que la vérité est là devant les yeux de tous. L’homme abattu, l’a été car il ne voulait pas payer l’argent de la corruption. Et, lorsque le commissaire remonte vers cet argent, tout le pouvoir local, mais hélas pour son enquête, également le pouvoir à Rome, commencent à trembler. Et si le pouvoir tremble, le commissaire a beau faire un travail remarquable, tout va redevenir « normal » et personne ne sera inquiété pour ce qui va devenir une banale histoire de passion amoureuse. Le pire des truands aura un alibi suffisant pour que l’enquête s’arrête. Evidemment en 1961, ce roman devait avoir un autre poids qu’aujourd’hui. Le fonctionnement de la Mafia nous est aujourd’hui beaucoup mieux connu, le romancier rappelle que le seul régime qui avait réussi à éradiquer la Mafia c’est le fascisme de Mussolini, et ce sont les Américains qui ont permis à ces bandits de revenir en force. Le charme de ce roman est dans son écriture, surtout à la structure du récit. L’auteur ne semble jamais prendre parti, il nous montre en toute objectivité les faits, il y a un détachement qui rend la situation encore moins acceptable.
La traductrice a été un peu ennuyée, je pense, avec l’imparfait du subjonctif, c’est -à ce que je crois savoir- un temps normalement employé en italien, mais en français, beaucoup moins, surtout à l’oral, et sans doute jamais dans des commissariats.
Citations
Le capitaine Bellodi
S’il continuait à porter l’uniforme, qu’il avait endossé dans les circonstances fortuites, s’il n’avait pas quitté le service pour la profession d’avocat à laquelle il se destinait, c’était parce que le métier qui consistait à servir les lois de la République, et à les faire respecter, devenait de jour en jour plus difficile. Il n’en serait pas revenu, l’indicateur, s’il avait su qu’il avait en face de lui un homme, carabinier et, de plus, officier, qui considérait l’autorité dont il était investi comme le chirurgien considère son bistouri : un instrument donc on ne doit user qu’avec précaution, avec précision, en toute sûreté, qui considérait la loi comme née de l’idée de la justice et tout acte découlant de la loi comme lié à la justice. Un homme pratiquant un métier amer et difficile, en somme.
Discours d’un député
« On m’accuse d’être en rapport avec des gens appartenant à la mafia, et, par conséquent, avec la mafia. Mais moi, je dois vous dire que je ne suis pas encore arrivé à comprendre ce qu’est la mafia, si elle existe, et je peux, en toute conscience de bons citoyens et de bons catholiques, vous jurer que je n’ai jamais connu de ma vie un seul mafieux. » À quoi, du côté de la Via loumia, à l’extrémité de la place où les communistes avaient l’habitude de ce grouper quand leurs adversaires tenaient un meeting, on entendit répondre par une simple question, très claire :
« Et ceux qui sont avec vous, qu’est-ce que c’est ? Des séminaristes ? »
Là-dessus un éclat de rire s’était propagé dans toute la foule tandis que le député faisait comme s’il n’avait pas entendu la question et commençait à exposer un programme pour l’assainissement de l’agriculture.
Une scène que l’on imagine si bien au cinéma
Au milieu de son sommeil, la sonnerie du téléphone était arrivée jusqu’à sa conscience par ondes successives et désagréables. Il avait saisi l’appareil avec l’impression que sa main, tandis qu’il faisait ce geste, se trouvait à une distance incommensurable de son corps. Tandis que de lointaines vibrations, que des voix lointaine parvenaient à son oreille, il avait tourné l’interrupteur, réveillant de la sorte, irrémédiablement, Madame : certainement, elle ne récupérerait pas de la nuit un sommeil qui ne descendait jamais que parcimonieusement sur son corps inquiet. Brusquement, ces lointaines vibrations, se fondirent en une seule voix, également lointaine, mais irritée, mais inflexible, et Son Excellence se trouva hors de son lit, pieds nus et en pyjama, en train de faire des courbettes et des sourires comme si courbettes et sourires pouvaient s’infiltrer dans le microphone.
Madame le regarda d’un air de profond dégoût. Elle lui tourna le dos, un dos splendide et nu, mais non sans lui avoir chuchoter : « Pas besoin de frétiller, il ne te voit pas. » Et, réellement, il manquait à son Excellence qu’un moignon de queue au derrière pour mieux exprimer toute sa soumission.
Débat à la chambre
Le sous-secrétaire reprit la parole. Il dit que, sur les faits qui s’était déroulés à S. et sur lesquels portaient les interpellations, il n’avait rien à dire, l’enquête judiciaire étant en cours, mais que, de toute façon, le Gouvernement considérait ses faits comme s’apparentant à la criminalité courante et repoussait l’interprétation que leur donnaient les députés qui l’interpellaient. Le gouvernement repoussait fièrement et dédaigneusement l’insinuation que la gauche faisait dans les journaux, à savoir que les membres du Parlement ou même du gouvernement auraient le moindre rapport avec la prétendue mafia. Laquelle, d’après le gouvernement, n’existe que dans l’imagination des socialistes et des communistes.
 Je dois cette lecture à Aifelle et je suis ravie d’avoir découvert cette auteure. On a tiré une pièce de théâtre de ce petit livre et je pense que la pièce devait être plus passionnante que le livre. J’ai trouvé le texte trop court et il manque de la profondeur à chacun des personnages c’est plutôt un synopsis qu’un roman ou qu’une nouvelle. Voici donc le sujet : une femme, enfant cachée de la guerre découvre que la meilleure amie de sa mère morte à Birkenau lui a volé son manuscrit . Elle est devenue riche et célèbre. L’enfant de la femme juive, ne veut qu’une chose se venger et elle est complètement habitée par cette vengeance. En moins de 60 pages, l’auteure donne une idée des protagonistes de ce drame qui s’avance inexorablement vers une fin tragique , sauf que … la fin en forme d’épilogue et de carte postal enlève (maladroitement selon moi !) le tragique de l’histoire.
Je dois cette lecture à Aifelle et je suis ravie d’avoir découvert cette auteure. On a tiré une pièce de théâtre de ce petit livre et je pense que la pièce devait être plus passionnante que le livre. J’ai trouvé le texte trop court et il manque de la profondeur à chacun des personnages c’est plutôt un synopsis qu’un roman ou qu’une nouvelle. Voici donc le sujet : une femme, enfant cachée de la guerre découvre que la meilleure amie de sa mère morte à Birkenau lui a volé son manuscrit . Elle est devenue riche et célèbre. L’enfant de la femme juive, ne veut qu’une chose se venger et elle est complètement habitée par cette vengeance. En moins de 60 pages, l’auteure donne une idée des protagonistes de ce drame qui s’avance inexorablement vers une fin tragique , sauf que … la fin en forme d’épilogue et de carte postal enlève (maladroitement selon moi !) le tragique de l’histoire.