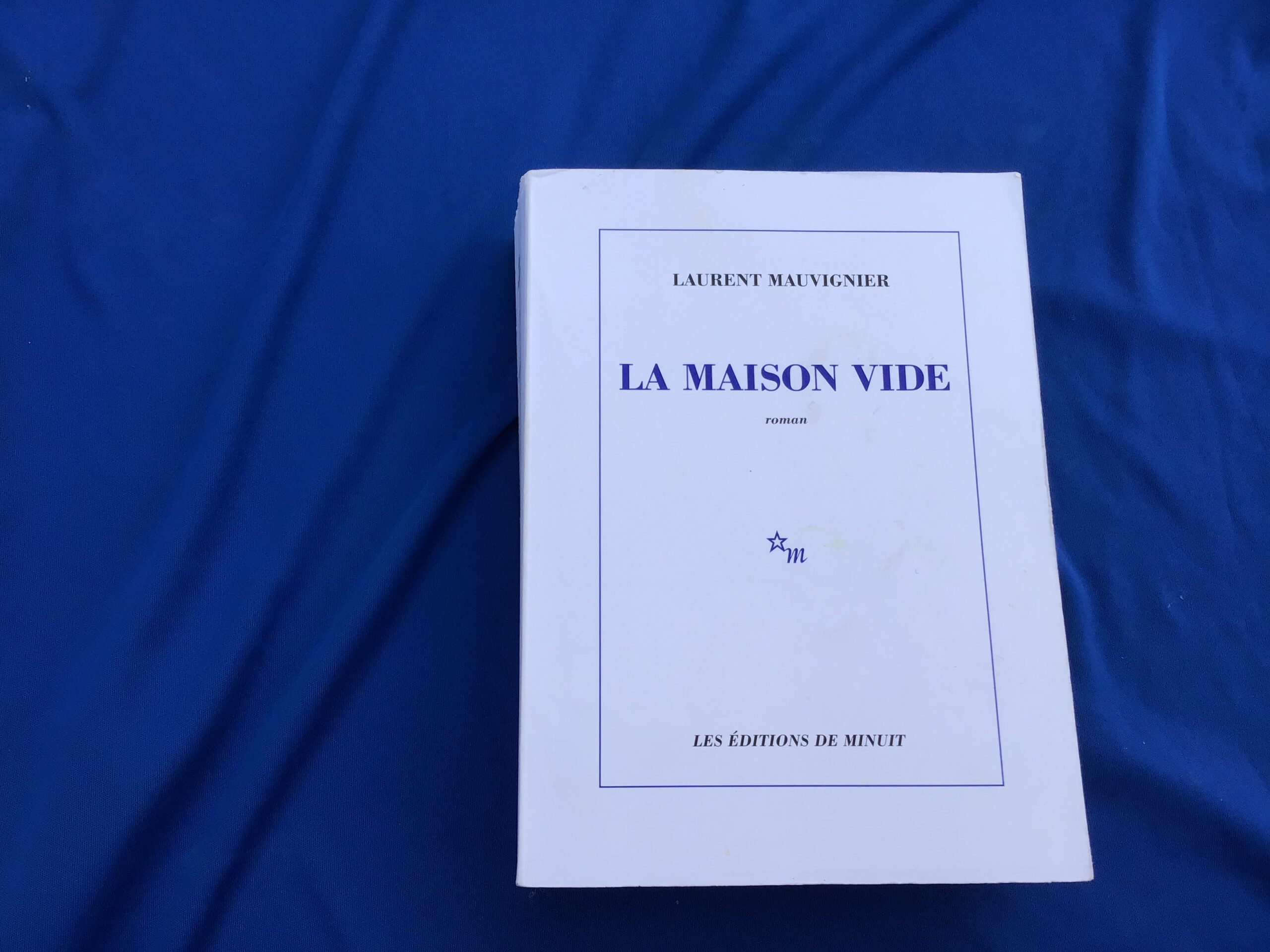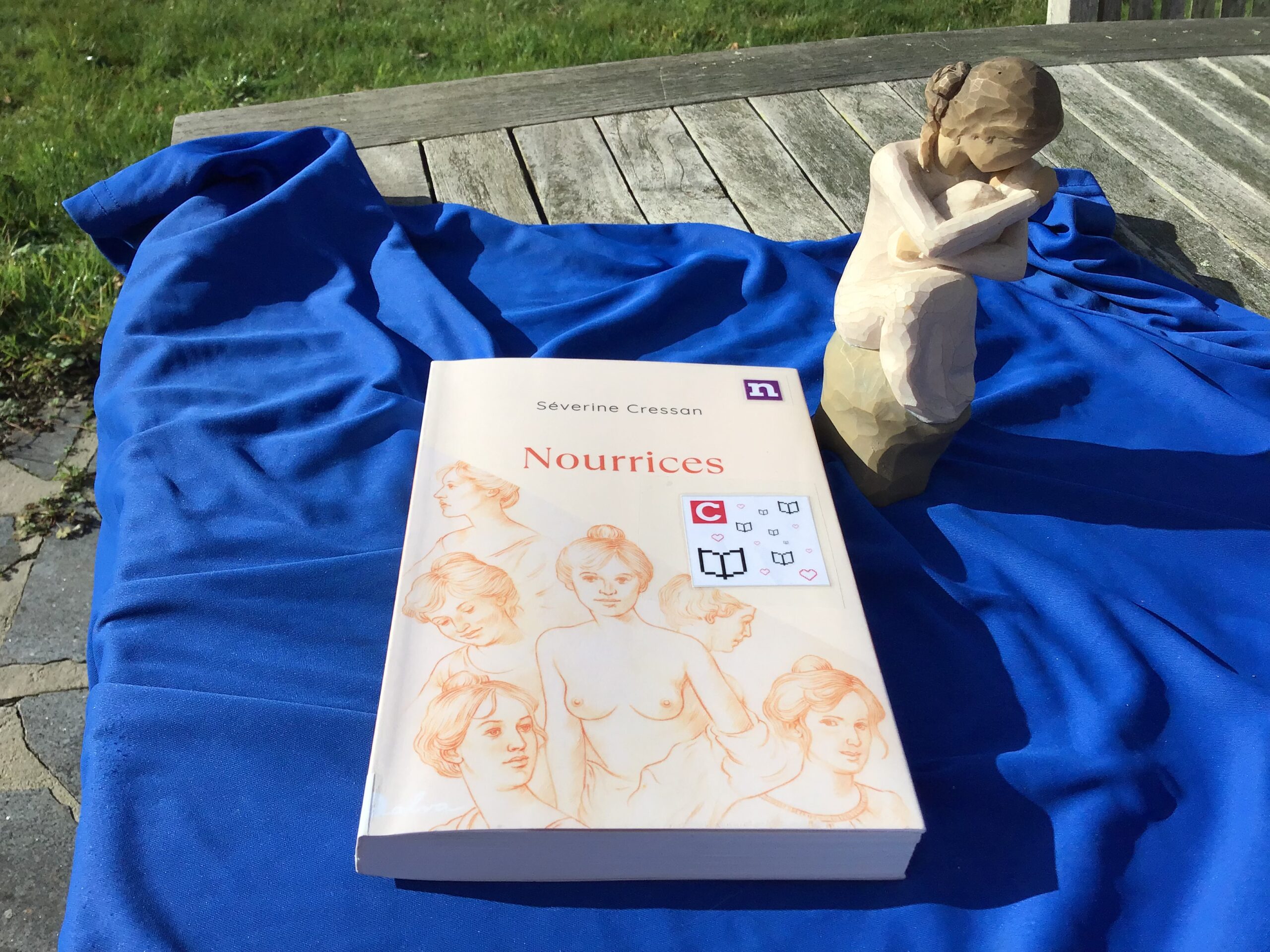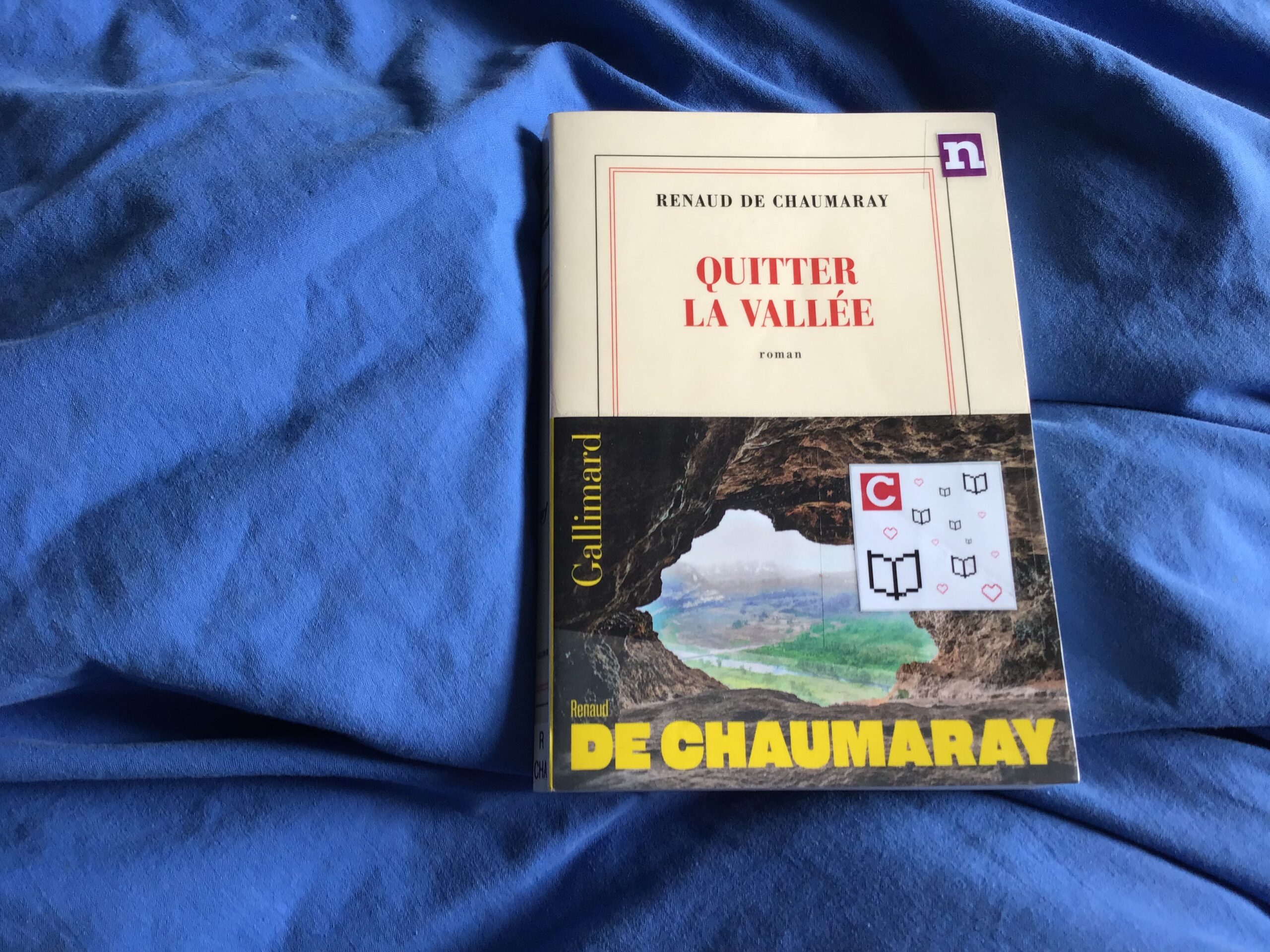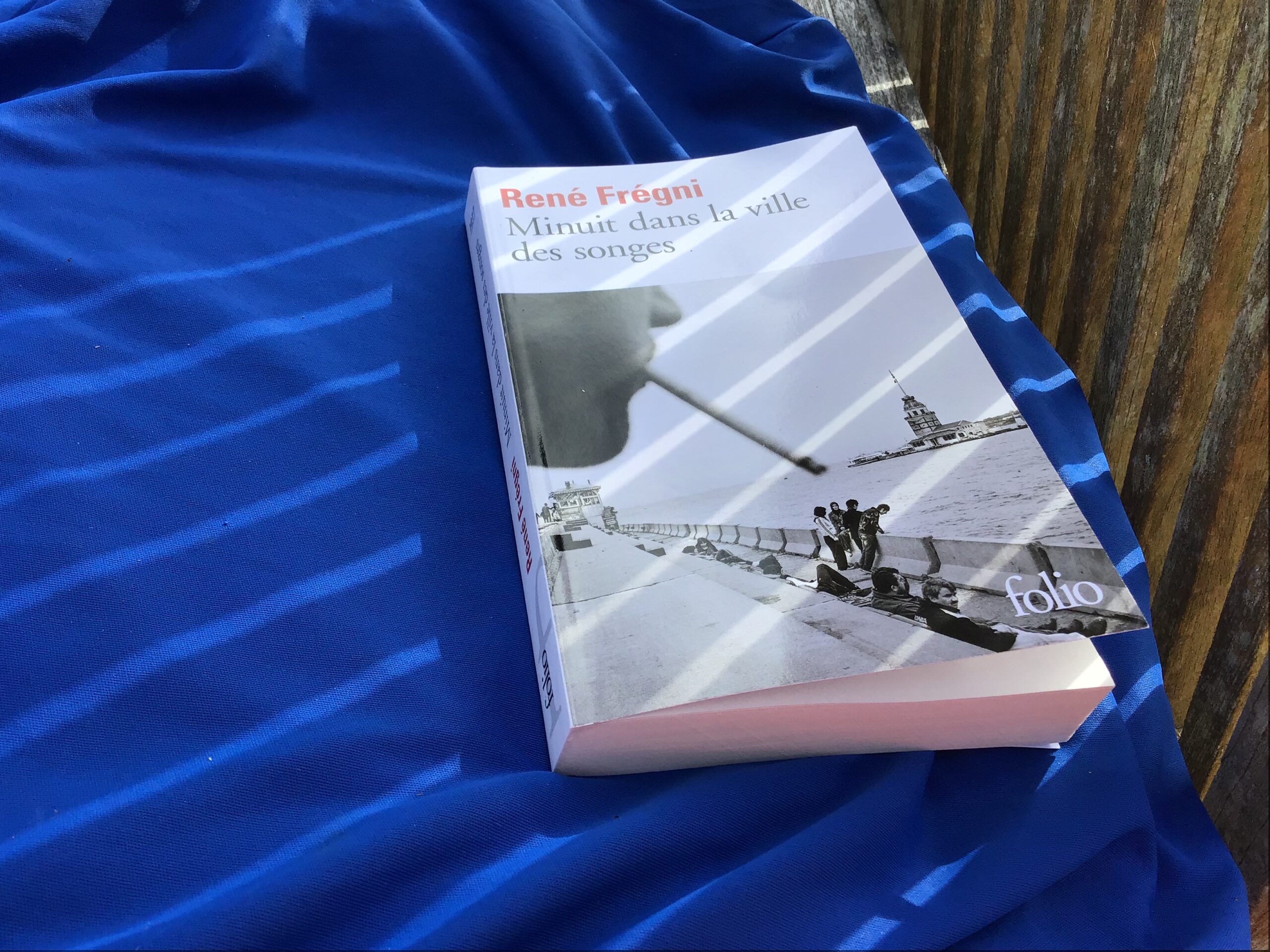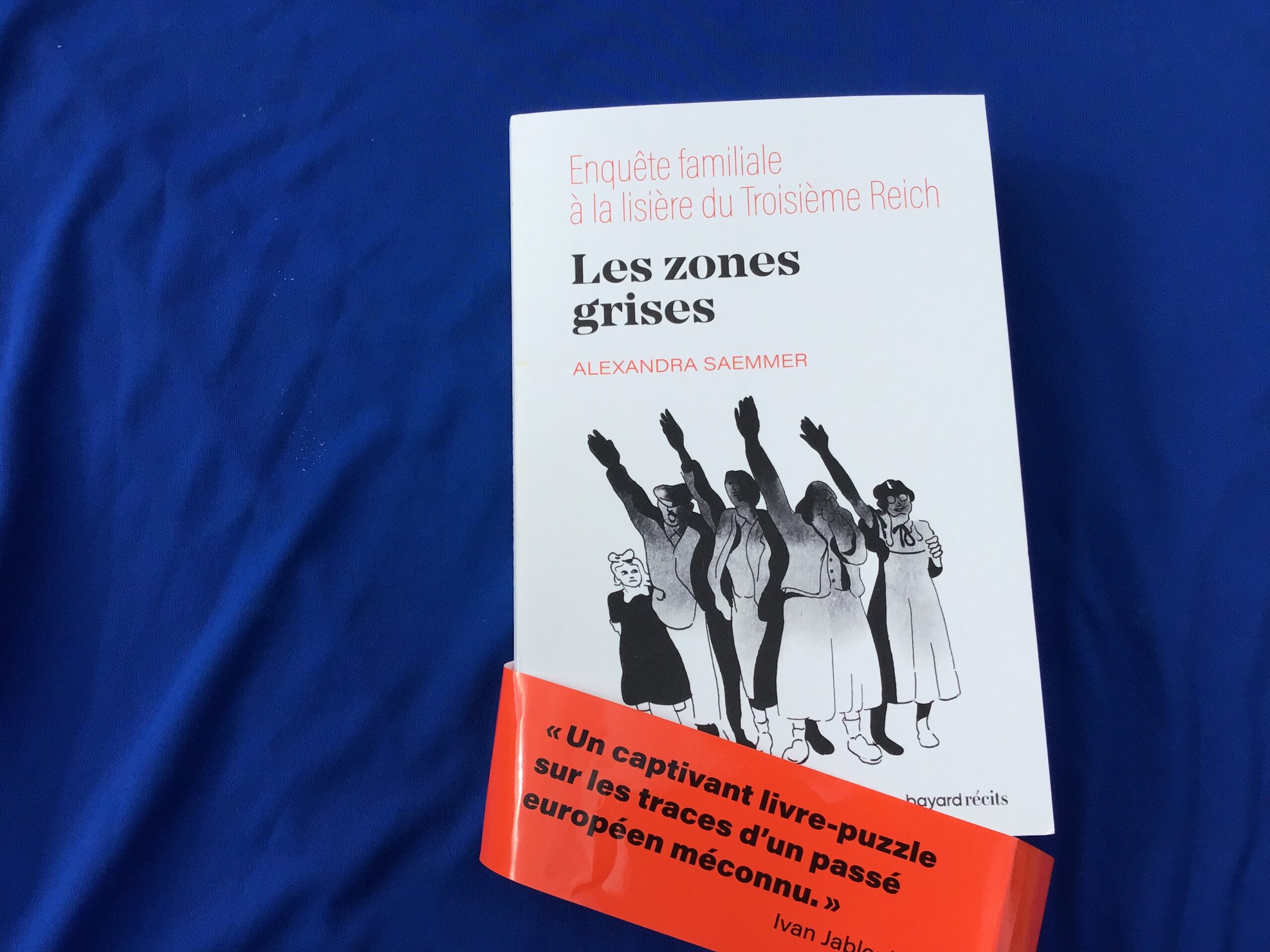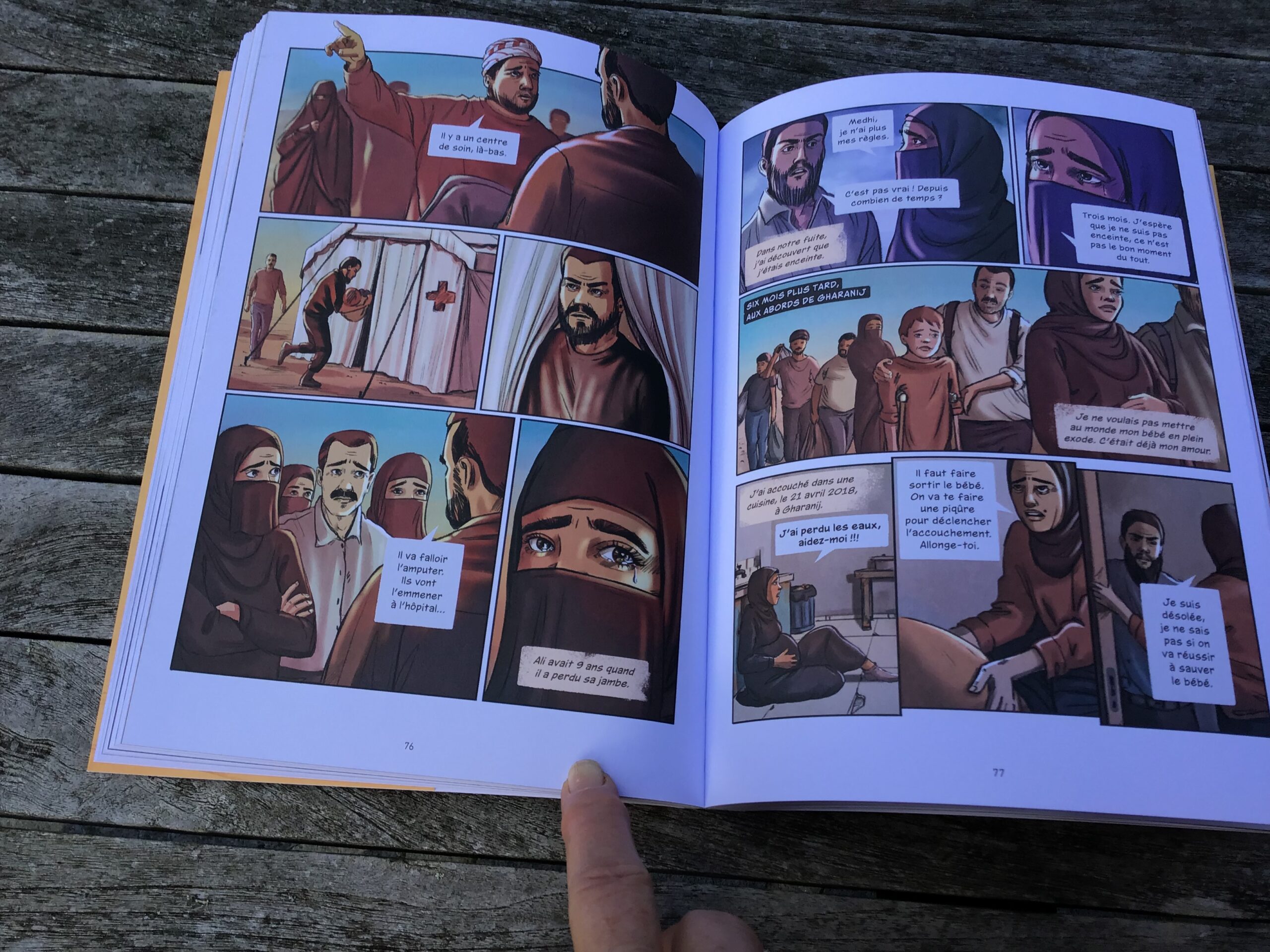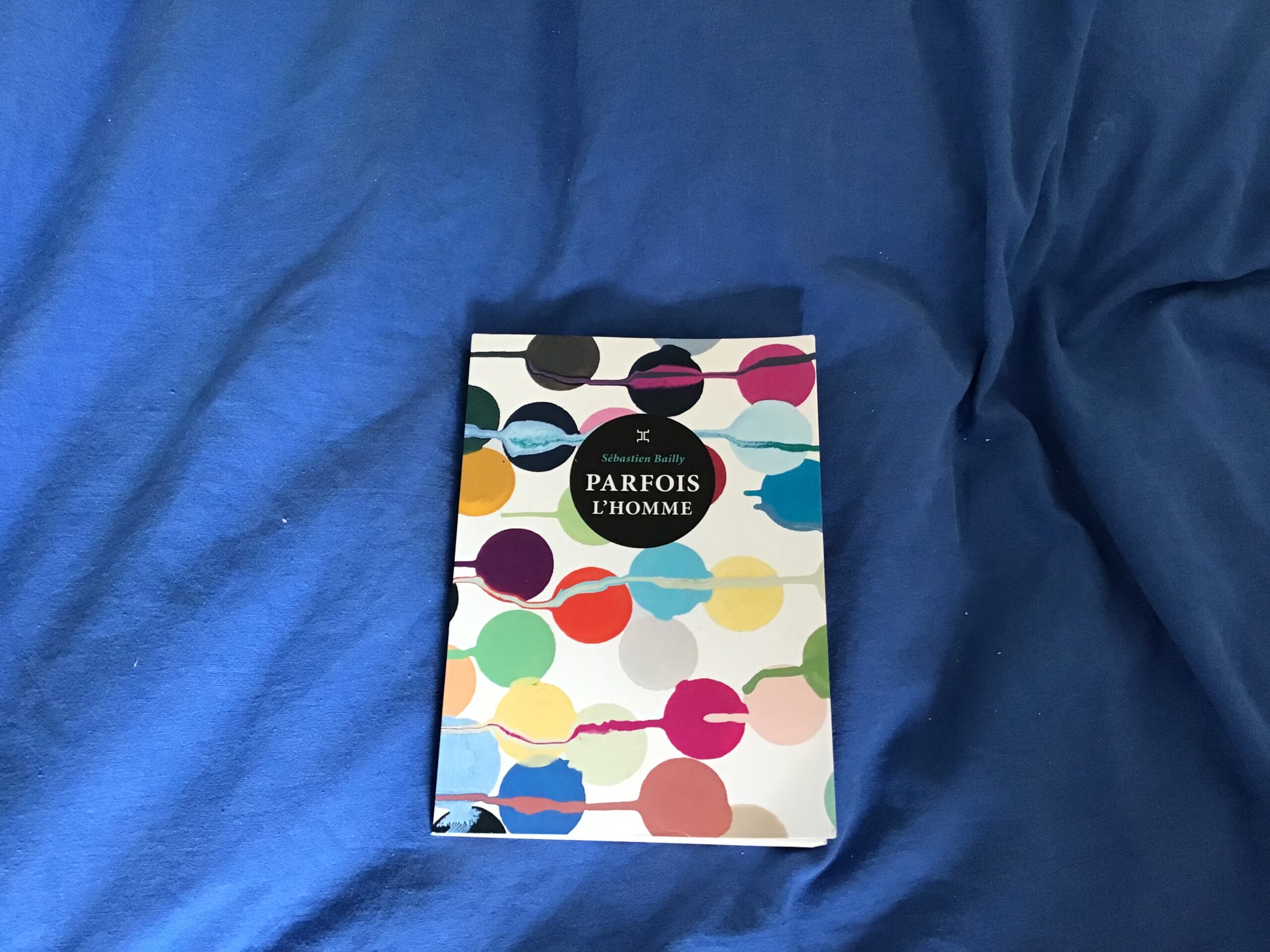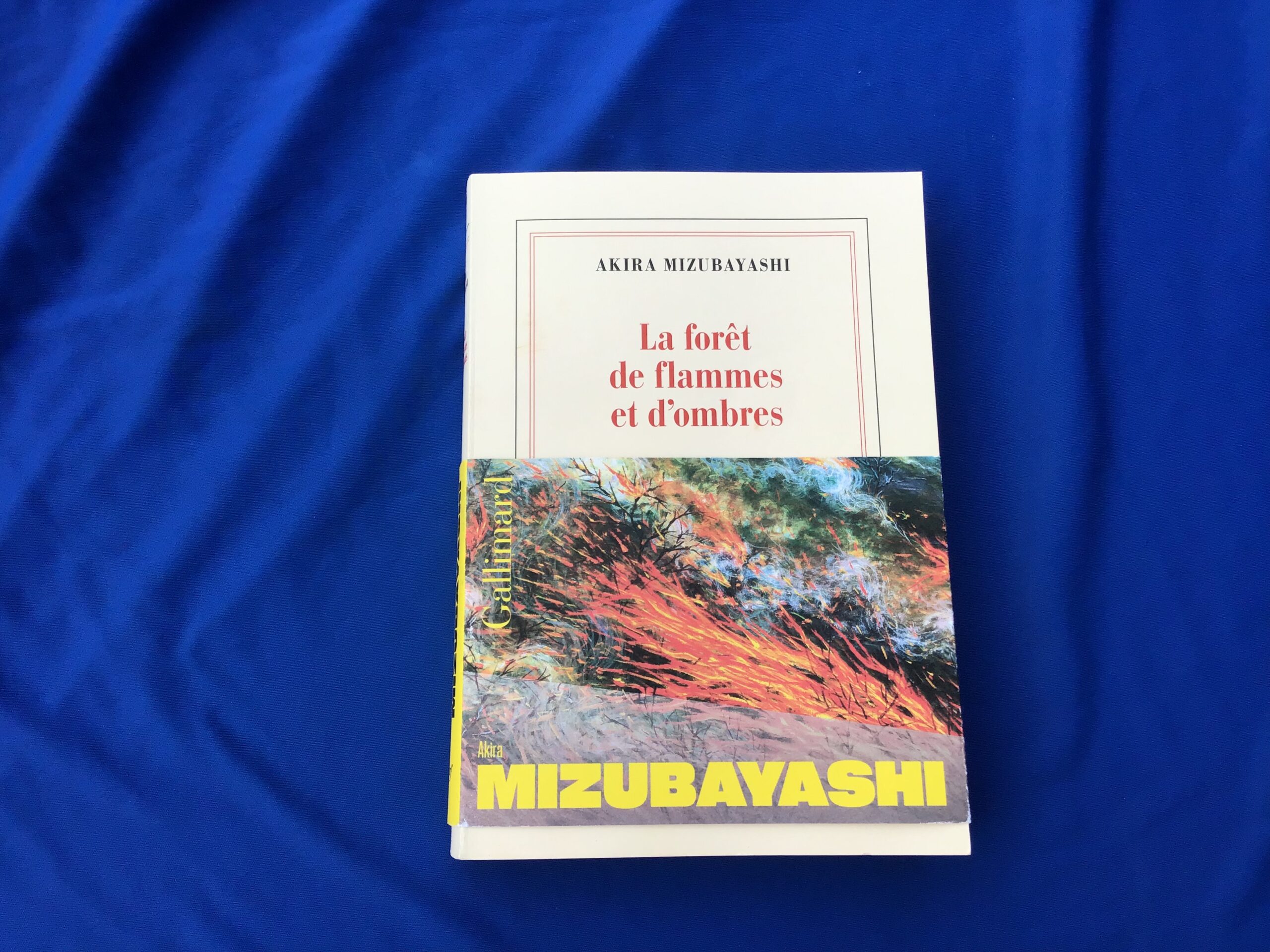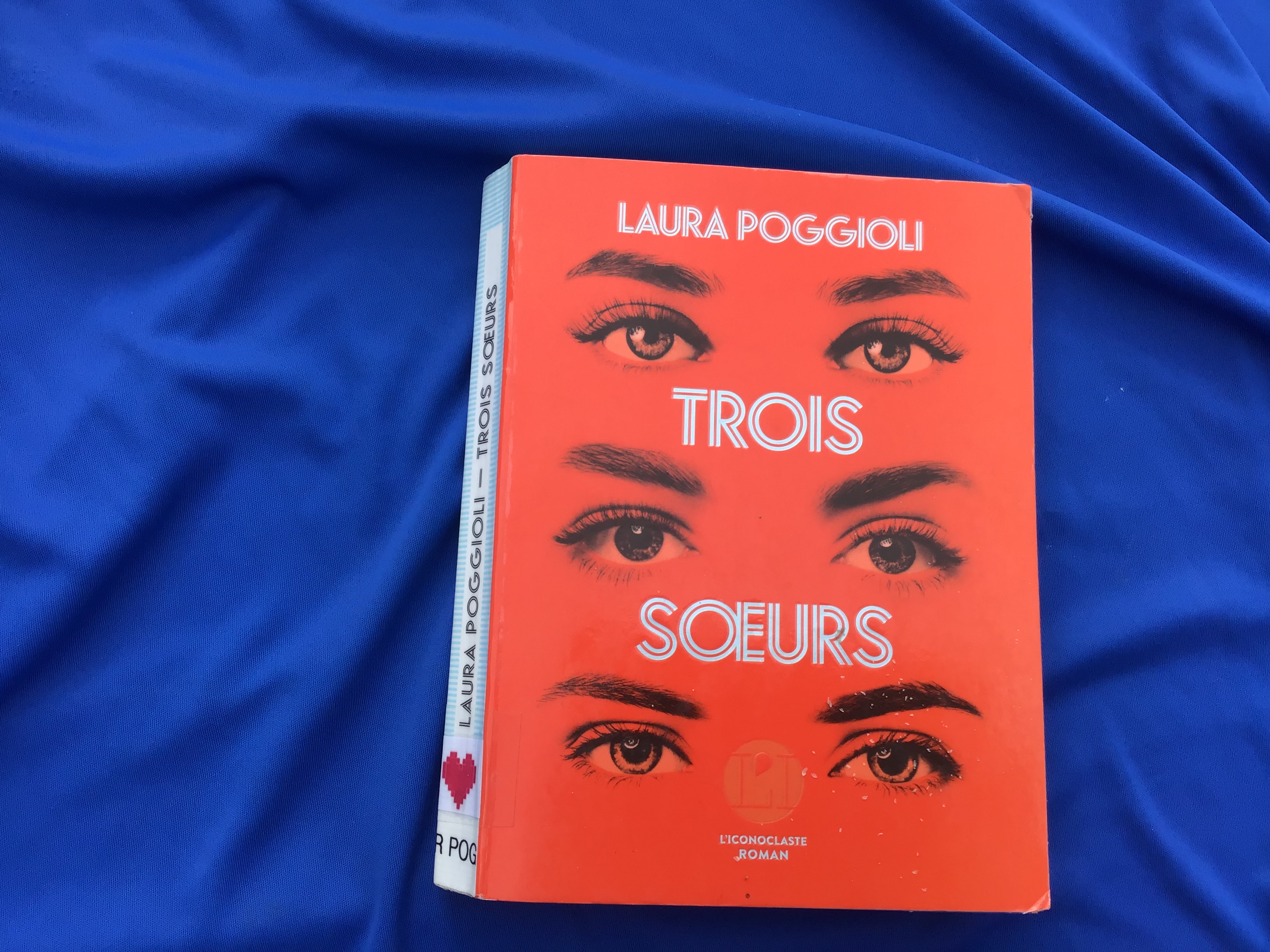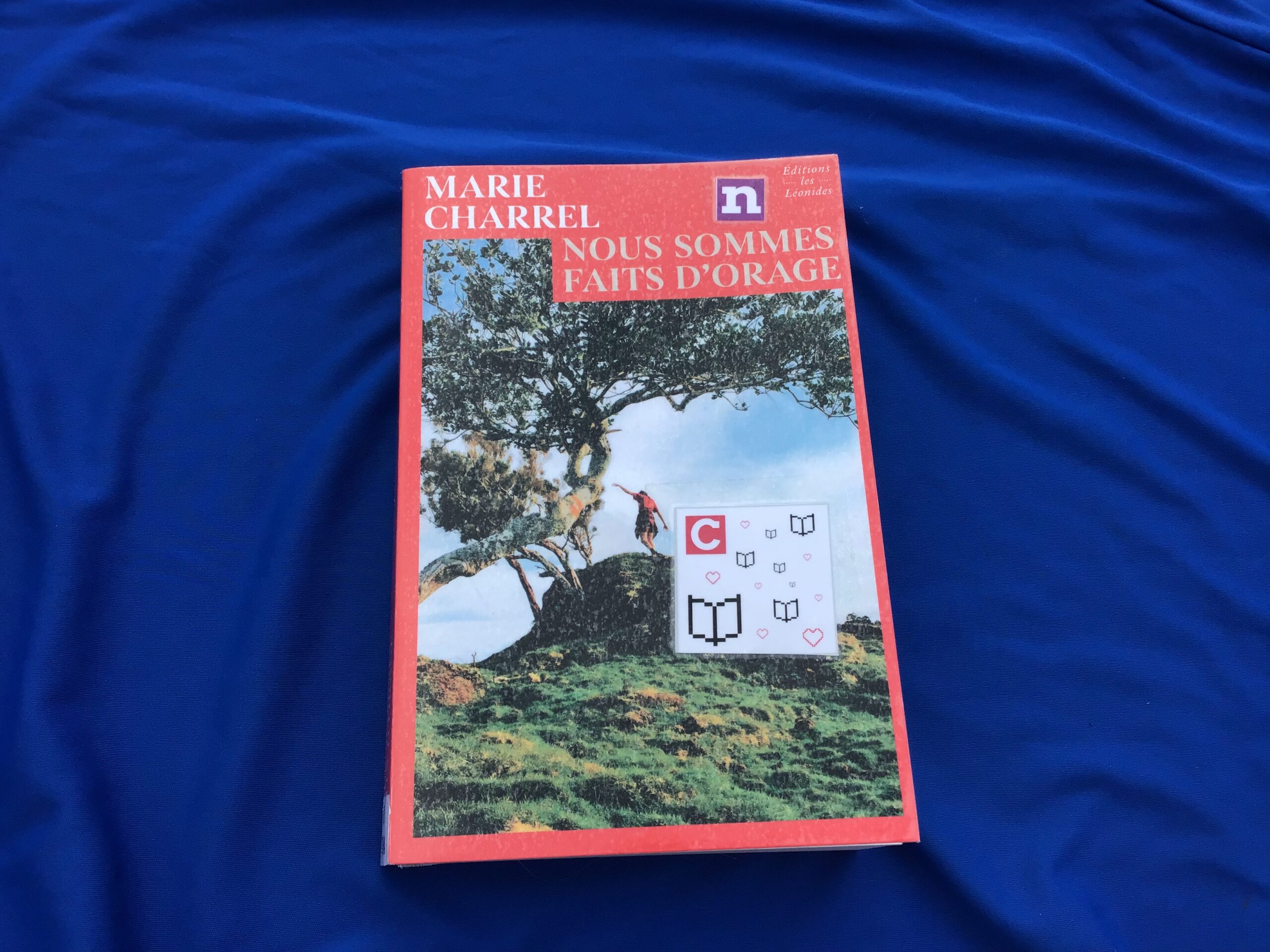
Éditions les Léonides, 393 pages, mai 2025
Lu dans le cadre du club de lecture de la médiathèque de Dinard
 Ce roman a ravivé pour moi le temps où l’Albanie représentait un pays au régime communiste pur et dur. Certains de mes contemporains étaient prêts à défendre Enver Hoxha mais finalement moins que ceux qui défendaient Mao et tellement moins que ceux qui ont défendu le petit père des peuple : Staline. Cela me fait plaisir qu’aucune jeunesse ne se réclame aujourd’hui de Kim Joon-un.
Ce roman a ravivé pour moi le temps où l’Albanie représentait un pays au régime communiste pur et dur. Certains de mes contemporains étaient prêts à défendre Enver Hoxha mais finalement moins que ceux qui défendaient Mao et tellement moins que ceux qui ont défendu le petit père des peuple : Staline. Cela me fait plaisir qu’aucune jeunesse ne se réclame aujourd’hui de Kim Joon-un.
L’écrivaine journaliste a imaginé l’histoire une jeune fille partant à la recherche des racines familiales de sa mère dans un village complètement perdu dans les montagnes albanaises. Comme souvent aujourd’hui, ce récit mêle plusieurs temporalités, avec des changements de personnages principaux.
Au début du récit, dans les années 2020, nous sommes avec Sarah. Elle retrouve la maison de sa mère, en Albanie pays d’où elles sont originaires. Sa mère, lui avait ordonné avant de mourir de retrouver une certaine Elora. Un couple de touristes qui veulent sortir des sentiers battus pour découvrir un pays l’accompagnent dans ce périple. Peu à peu en progressant dans sa recherche, l’auteure remonte dans le temps et dénoue tous les fils du drame qui a obligé Sarah et sa mère à vivre en Islande bien loin des guerres de clans qui ont bouleversé leur vie et celle des habitants de ce village.
En 1972, trois amis venant de ce village, arrivent à Tirana pour faire des études, ils sont tous les trois amoureux de la belle Esther fille d’un intellectuel, ensemble ils découvriront les joies et le pouvoir de la poésie. L’amitié et la rivalité amoureuse entrainera le drame dont on aura toutes les réponses qu’à la fin du roman.
En 1980 deux jeunes Elora et Agon sont très amis parfois Niko et le grand frère d’Agon, Durim les rejoignent. La vie au village se serait passée à peu près normalement si ce n’est qu’un envoyé du parti (l’un des trois amis qui étaient allés faire ses études à Tirana), veut absolument collectiviser et faire obéir tout ce petit monde aux ordres d’Enver Hoxha. La description de l’absurdité communiste qui, par exemple, oblige les gens à avoir une coupe de cheveux au centimètre près pour ne pas risquer de se faire arrêter est, hélas, très proche de la réalité.
En 1990, c’est une autre horreur qui secoue le village : la dette de sang. Car comme si le communisme ne suffisait pas, l’Albanie obéit aux traditions ancestrales : le viol d’Elora entrainera trois meurtres et on craint même que cela se perpétue en 2023. On devine assez vite que l’enquête de Sarah permettra de dénouer toutes les tragédies qui ont traversé ce village et fait fuir sa mère si loin dans un pays si opposé à l’Albanie, pour le climat, la lumière, les mœurs, et surtout la liberté des femmes, l’Islande.
C’est un roman dense qui se lit facilement, mais même si je l’ai apprécié, j’ai l’impression qu’à part l’évocation des excès stupides du régime communiste et des horreurs des lois qui régissent les vengeances des lois que l’on dit gérées par l’honneur, je l’oublierai assez vite, et, de plus, je ne comprends pas trop le goût actuel des romanciers de mélanger les temporalités.
Extraits
Début
2023Le bouquet de fragrances se déverse dans l’habitacle lorsque Sarah baisse la fenêtre du 4×4 : ciste, romarin, thym, lavande, sauge. La terre exhale des parfums qui l’enfièvrent depuis qu’ils ont quitté la capitale. Tant de senteurs, tant de soleil : elle n’a pas l’habitude. L’hiver retirait à peine sa longue traîne blanche du fjord lorsqu’elle a quitté son laboratoire d’Akureyri, dans le nord de l’Islande. Les effluves de la lande étaient encore assoupies sous la neige, attendant leur l’heure pour jaillir.
Le poids des traditions en Albanie.
Les rares villageois qui ne supportent plus la vie spartiate du hameau rejoignent la vallée nichée dans l’ombre. Certains entament des études dans les grandes villes. D’autres dégotent un logement confortable à Tirana. Mais quels que soient leurs efforts et les charmes que la capitale déploie sous leurs yeux, le souvenir du village sans nom ne cesse de les hanter. Ils portent le même secret : la mémoire des vendetta entrée dans leur chair. Leur âme est trempée à loutrenoir, cette matière née de l’ombre et de la lumière mêlées, par laquelle le malheur des prophéties anciennes s’abat.
Le tourisme et l’Albanie.
– Vous pensez vraiment que des touristes vont venir jusqu’ici ? interroge Sarah.– Amélie et Antoine en sont là preuve, répond Niko, désignant le couple d’un geste du menton, sourire aux lèvres. Les amateurs de haut de gamme sont à la recherche d’expériences exceptionnelles, loin des destinations piétinées par les hordes de badauds. Il reste peu de coins vierges comme celui-ci sur le continent. L’isolement du village est précisément ce qui le protégera du tourisme de masse. Personne n’imagine les trésors que ces montagnes dissimulent.
Le régime communiste.
Récolter les plantes à l’aube, les nettoyer, les plonger dans les alambics vrombissants, collecter le nectar ainsi produit et conditionner les huiles essentielles : voilà à quoi se résument désormais les journées des villageois.Le parti du travail est leur employeur.Le parti du travail distribue leur repas.Le parti le renseigne les préceptes d’Envers Hoxha, scandés à longueur de journée dans la distillerie.(…)Les villageois récitent le catéchisme enseigné par le Parti. Mais le soir, dans le secret de leurs masures, enfin désertées par les prisonniers, ils vomissent leur mépris.– Qu’est-ce que c’est que ces conneries !
Je comprends cette réaction.
Depuis la veille, le couple et elle se tutoient. Ils ont le même âge. Très vite, ils ont échangé en français des commentaires échappant à leur guide avec qui ils communiquent en anglais. Sarah apprécie la complicité qui s’installe entre eux et s’en méfie. Tantôt sur la réserve, tantôt désireuse de s’en faire des amis, elle ne peut s’empêcher d’émettre un jugement sur leur choix de vacances, randonner sur les hauteurs d’un pays ruiné par le communisme et la corruption qu’il a engendrée a quelque chose d’obscène.
La tradition.
Le Kanun dit : les hommes respecteront la gjakmarrja. La vengeance du sang. Tout assassinat d’un membre de la famille et toute offense grave devront être réparés par la vie d’un membre de la famille de l’offenseur. Il est interdit de tuer les femmes et les enfants. Il est interdit de tuer un homme dans sa propre maison, et dans la tour de claustration. Les blessures peuvent être indemnisées par le versement d’une amende. Toute blessure non indemnisée compte pour un demi-mort. Deux blessures équivalent à un mort.
Raisons pour lesquelles on était arrêté sous Enver Hoxha.
» J’organisais des parties de cartes pour les gars de l’usine après le travail. On m’a accusé de dissidence. J’ai, passé cinq ans dans les mines de Burrel, puis on m’a envoyé ici. »» J’ai eu le malheur de faire mes études à Moscou. Je suis considéré comme un ennemi du peuple depuis que l’Albanie a coupé les ponts avec L’URSS. »» J’ai accueilli des étudiants chinois dans ma classe : on m’a jugé ennemi du peuple quand l’albani c’est fâchée avec Mao. »» Je trimais sur des travaux de terrassement. J’ai regardé vers l’horizon : on m’a accusé de vouloir fuir à l’étranger, j’ai pris trois ans de prison. »» Je travaillais dans un café, j’ai éteint la radio pendant la transmission d’un discours d’Enver Hoxha pour prendre la commande d’un client. On m’a dénoncé. »» J’ai porté mon sac en bandoulière, on m’dit que j’avais été « perverti par l’esprit étranger » et j’ai été arrêté. »» J’ai dix-huit ans, je suis né en prison parce que mon père et ma mère étaient des dissidents ».» J’étais marin, j’ai laissé des passagers revenir d’Italie avec des gressins dans leur sac. »» Je me suis plaint de la chaleur dans la brigade agricole où je travaillais. »» J’ai bâillé au corneille pendant une réunion du Parti. »« J’ai râlé dans la queue d’un magasin général. »» Nous avions la télévision dans notre appartement de Tirana. Le soir, nous regardions les séries italiennes que nous parvenions à capter. Tout le monde fait ça derrière les volets clos ! L’un de nos voisins a dénoncé ceux du quartier dont l’antenne était tournée vers Rome. On m’a arrêté pour activité hostile. »