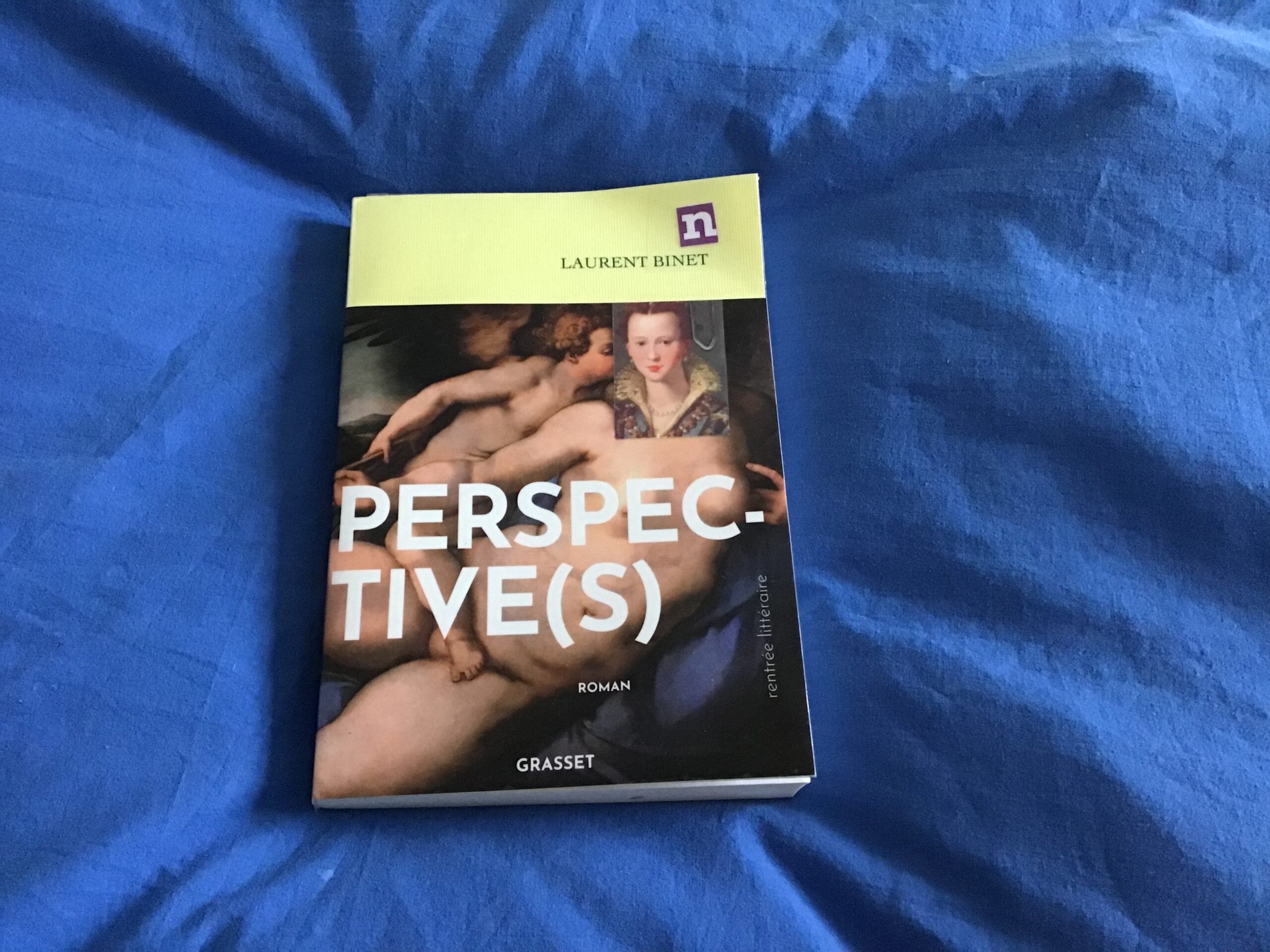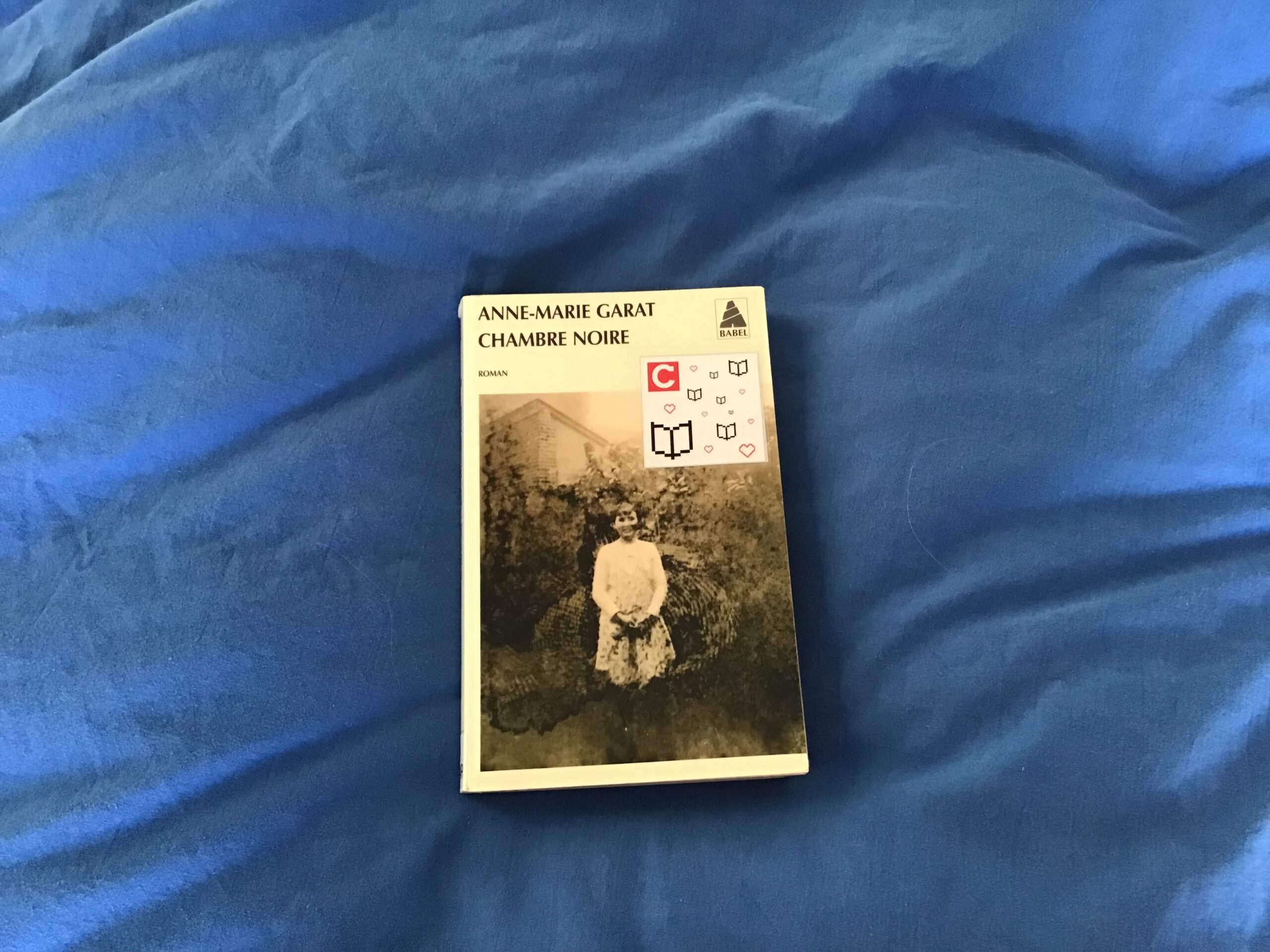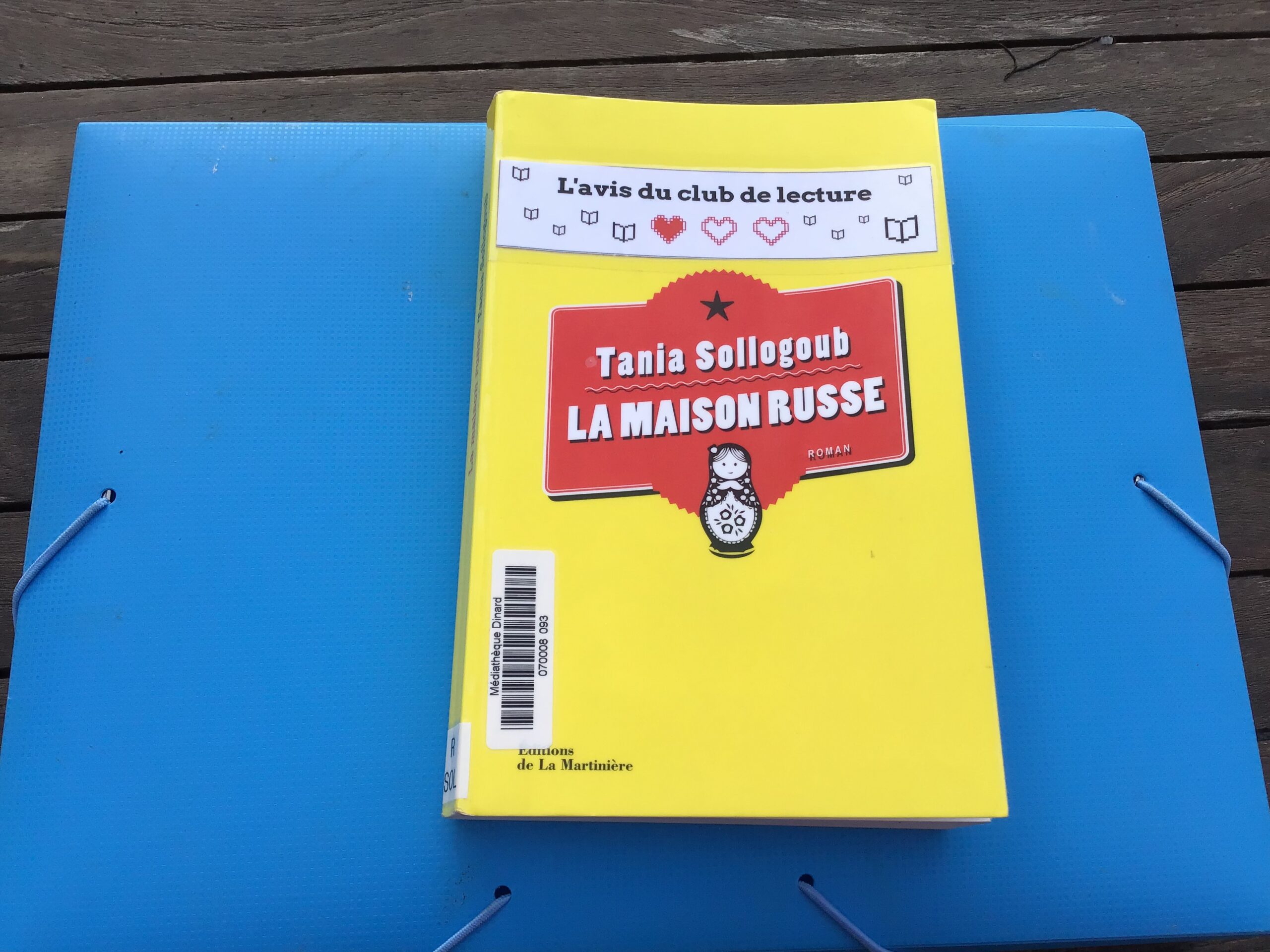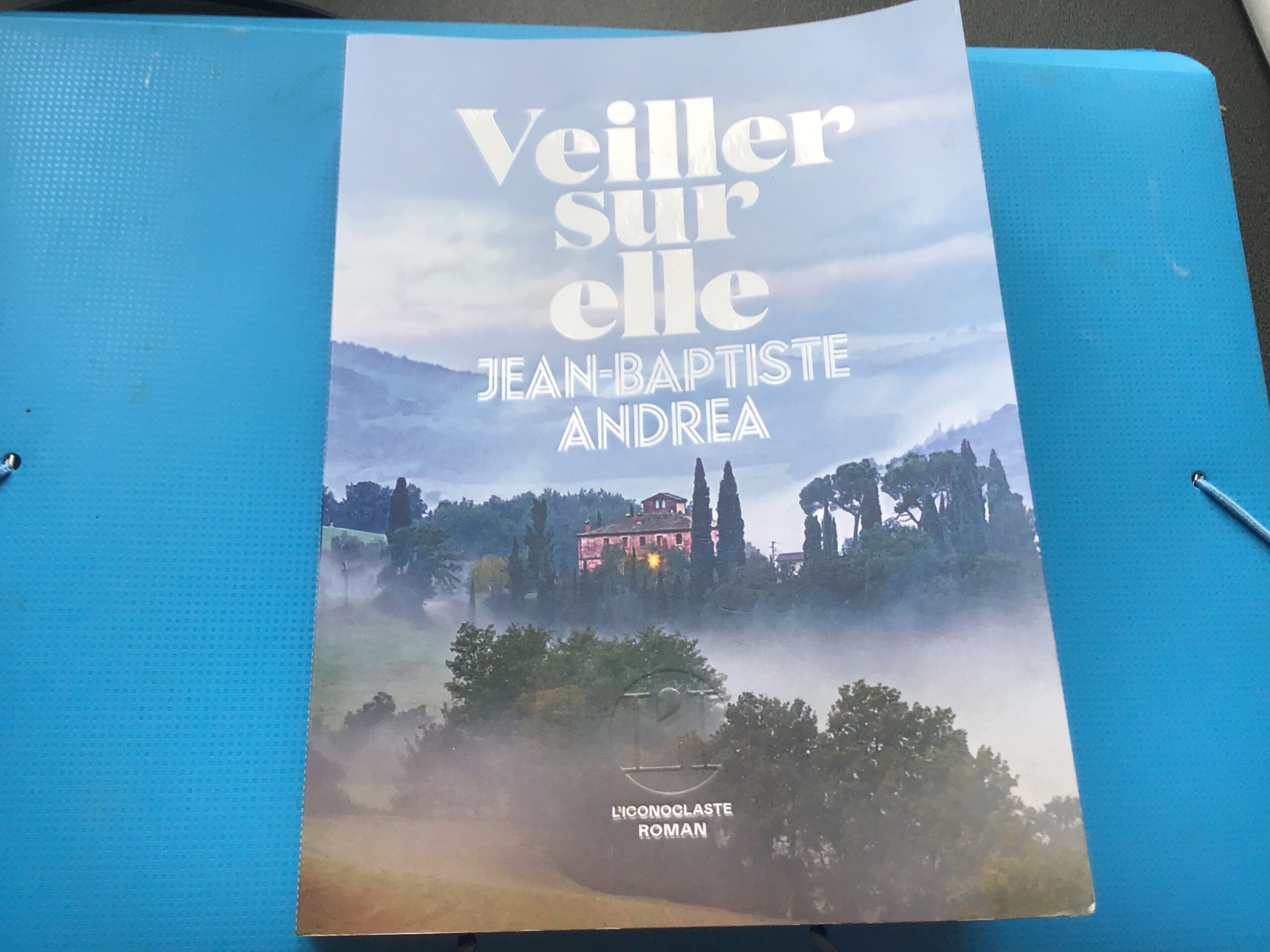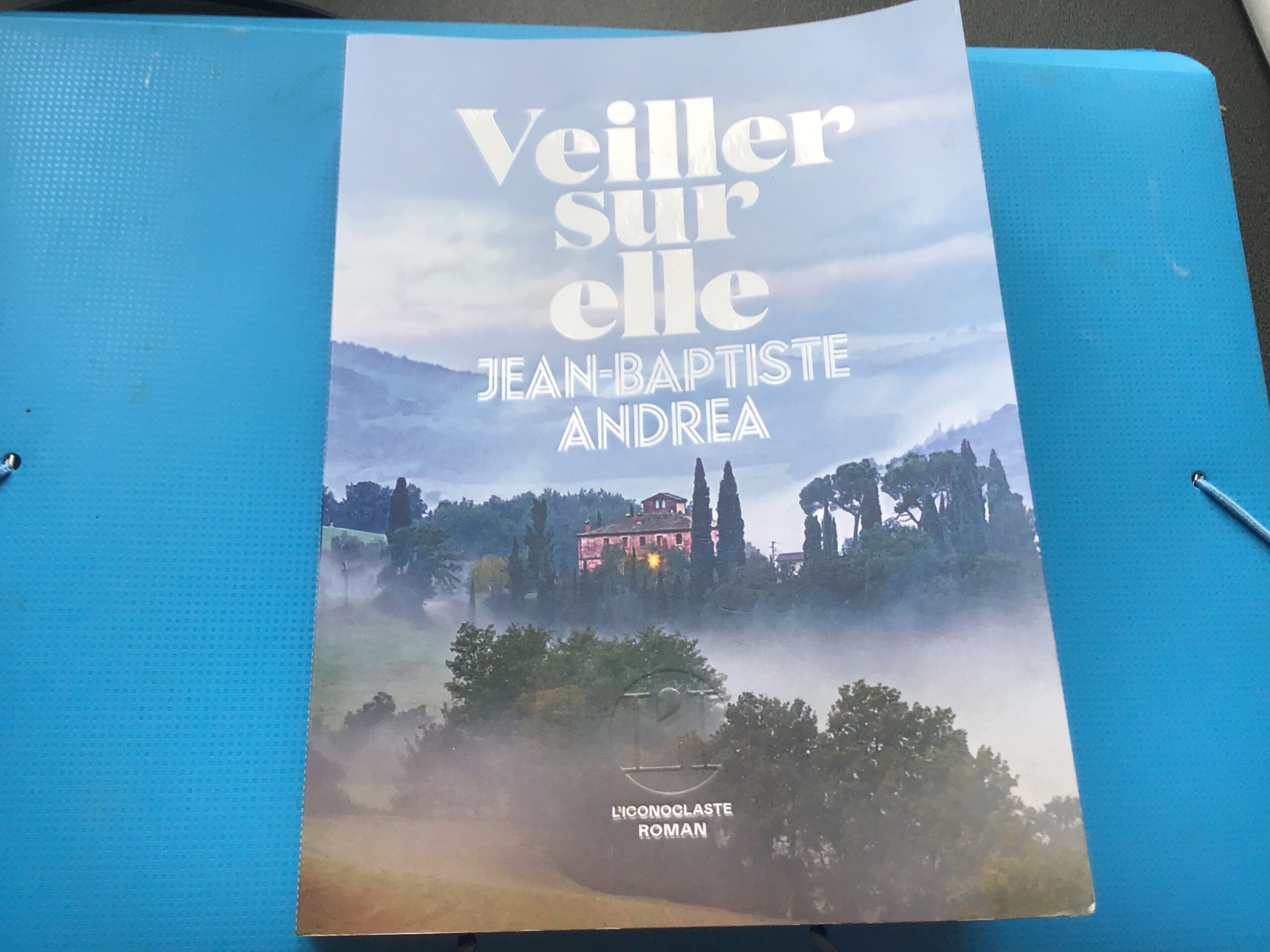
Édition l’iconoclaste
 Un vrai roman comme je les aime, je suis complètement partie dans cette histoire au point où j’ai dû vérifier si Michelangelo Vitaliani avait vraiment existé, car l’auteur mélange si bien la fiction avec l’Histoire qui a secoué l’Italie au Vingtième siècle que c’est compliqué de faire la part entre le réel et son son imagination. Une petite réserve sur la longueur du roman et le côté invraisemblable de cette histoire d’amour.
Un vrai roman comme je les aime, je suis complètement partie dans cette histoire au point où j’ai dû vérifier si Michelangelo Vitaliani avait vraiment existé, car l’auteur mélange si bien la fiction avec l’Histoire qui a secoué l’Italie au Vingtième siècle que c’est compliqué de faire la part entre le réel et son son imagination. Une petite réserve sur la longueur du roman et le côté invraisemblable de cette histoire d’amour.
Nous sommes avec un homme qui va mourir, il longtemps vécu et terminé sa vie en 1986, dans un couvent . Le père responsable de ce couvent, Vicenzo, est aussi le gardien d’un très lourd secret que le romancier mettra du temps (trop peut-être ?) à nous dévoiler. La chronologie est quelque peu bousculée mais nous suivrons l’enfance misérable de Mimo que sa mère a confié en 1916 à un individu sans coeur Zio. Le père de Mimo était sculpteur et Zio aussi . Le roman se situe en Ligurie dans un village Pietra d’Alba.
De ce lieu, le romancier met en lumière les oppositions de l’Italie de cette époque. La famille noble, les Orsini, qui ont un château et les pauvres comme Zio et les deux enfants dont il a hérité, bien malgré lui ,de la charge. Alinéa (Vittorio) et Mimo.
Celui-ci va s’avérer un artiste de grand talent, cela nous vaut de très belles pages sur la création artistique d’un sculpteur. Dans ce petit village, il va faire la connaissance de Viola la cadette des Orsini, le destin de ces deux enfants est intimement lié, ils découvrent qu’ils sont nés le même jour et se déclarent jumeaux cosmiques. Viola est une enfant surdouée qui retient tout ce qu’elle lit et veut devenir une savante. Un jour elle grandira pour devenir une très belle jeune femme mais pas Mimo qui est atteint de achondroplasie c’est à dire qu’il ne fera jamais plus d’un mètre quarante.
C’est un roman touffu, il s’y passe beaucoup d’évènements liés à l’histoire de l’Italie. La montée du fascisme est bien rendu, car si Mimo ne s’occupe pas de politique, il en est un témoin privilégié. La famille Orsini est toujours aux manettes du pouvoir et manipule tout le monde, les deux frères de Viola, le brutal fasciste qui a su retourner sa veste juste à temps et le prélat à l’air si doux tiennent dans leurs mains le destin de Mimo et Viola. L’amour de Mimo pour Viola est impossible mais également très beau. Elle sera victime de sa beauté, de sa richesse et surtout de son intelligence, ce roman décrit bien la condition des femmes de cette classe en Italie à cette époque. C’est un roman à la gloire des femmes italiennes et à leur courage, la révélation finale en est un superbe symbole.
Tout au long du roman on parle aussi de ce que Vicenzo doit garder bien caché dans des souterrains sous son église, je peux vous le dire, car on le sait assez vite, il s’agit d’une sculpture de Mimo, mais on ne sait qu’à la toute dernière page (ou presque) pourquoi il fallait la dissimuler à tous les regards.
J’ai passé des heures merveilleuses avec ce roman et j’ai beaucoup regardé la Pieta de Michelangelo et consulté Wikipédia pour vérifier les faits historiques. Si vous ne l’avez pas encore fait lisez le vite, dépaysement garanti. Mais sachez quand même qu’Athalie a beaucoup plus de réserves que moi et et que « mot à mot » est bien d’accord avec elle.
Extraits
Début.
Ils sont trente-deux. Trente-deux à habiter encore l’abbaye en ce jour d’automne 1986, au bout d’une route à faire pâlir ceux qui l’empruntent. En mille ans rien n’a changé. Ni la raideur de la voie ni son vertige. Trente-deux cœurs solides -il faut l’être quand on vit perché au bord du vide-, trente-deux corps qui le furent aussi dans leur jeunesse. Dans quelques heures, ils seront un de moins.
Le marbre et la sculpture.
Il fronça les sourcils. Son regard alla du marbre à moi, de moi au marbre, puis il écarquilla les yeux. – Oh non, non. non Mimo. Zio va te tuer il y a un chefs-d’œuvre dans ce bloc.
– Je sais. Je le vois.
(Et 10 jours plus tard)
Je ne me relevais pas aussitôt admirant l’ours, qui se dressait au dessus de moi. Il émergeait du bloc de marbre à mi-hauteur, une patte appuyée sur la pierre comme pour s’en arracher, l’autre tendue vers le ciel. Sa gueule pointait aussi, ouverte en un grognement que sa tête légèrement penchée, rendait moins menaçant. Je n’avais sculpté que la moitié supérieure du bloc, à partir de la taille, de plus en plus en détails. Si bien que l’œil du spectateur, partant du bas du socle jusqu’au sommet du museau, entreprenait un voyage de la brutalité à la délicatesse, de l’immobilité vers le mouvement. On dira ce qu’on veut de mon travail, mais je crois qu’il y avait là quelque chose du divin, dans cette genèse de marbre qui n’était d’abord rien, un condensé d’angles et de néant, puis se brisant, donnait naissance dans un jaillissement de blancheur à un monde violent, tendre, tourmenté une oursonne abandonnée qui en saluait une autre.
L’Italie.
Ce n’est pas pour rien qu’un Italien, Mercalli, donna son nom à une échelle de destruction, celle de l’intensité des tremblements de terre. Une main démolit ce que l’autre a bâti, et l’émotion est la même.
l’Italie, royaume de marbre et d’ordures. Mon pays
Jolie façon de raconter.
Je dois beaucoup aux femmes dite « perdues », et mon oncle Alberto était le fils de l’une d’elles. Une fille courageuse qui se couchait sous les hommes, au pont de Gênes, sans colère ni honte. C’était la seule personne dont mon oncle parlait avec respect, une ferveur confinant à la vénération
L’après guerre en Italie.
Les nations victorieuses se disputaient la charogne des vaincus. Les tensions de l’année passée se répandaient comme une peste dans tout le pays, obéissant au schéma précis dont j’avais été témoin : revendication de justice suivies d’une répression impitoyable par des groupes à la solde des tout jeunes Faisceaux italiens de combat, créés par un ancien socialiste à Milan.
Un moment d’humour (il n’y en a pas beaucoup).
-J’ai bientôt seize ans. Et je ne vole toujours pas. Je ne serai jamais Marie Curue.
– Quelle importance ? Tu es toi Viola, et c’est beaucoup mieux.
Viola leva les yeux au ciel et sortit sans prendre la peine de refermer la porte de la grange, nous laissant spéculer dur les,énigmatiques vertus du mystérieux Maricuri.
L’arrivée de Mussolini au pouvoir.
Le 28 octobre de cette année-là, les plus forts d’entre eux, fascistes, squadristes, anciens partisans tentèrent leur chance. Une bande dépareillée marcha sur Rome, bien décidée à intimider le gouvernement en place. Malgré leur succès à réprimer les émeutes socialistes, dont j’avais été témoin, ils étaient mal armés, hésitants et, surtout peu sûrs de leur coup. Tellement peu sûrs que leur courageux chef Mussolini, tremblant dans ces pantalons bouffants d’ancien socialiste et de futur dictateur avait préféré rester à Milan. Il avait jugé plus prudent de ne pas rejoindre la marche, pour pouvoir décamper en Suisse au cas où les choses tourneraient mal. L’ère était à la lâcheté. Et parce que L’ère était à la lâcheté, le gouvernement puis le roi décidèrent de laisser faire au lieu d’envoyer l’armée, pourtant prête à agir. Le planqué de Milan se retrouva du jour au lendemain à la tête du gouvernement ce dont il fut le premier surpris.
 Le thème de notre club de lecture de Mars 2024 est original et, pour moi, très intéressant : la bibliothécaire est allée chercher dans la médiathèque des romans qui ont eu du succès il y a 20 ans , donc en 2004 !
Le thème de notre club de lecture de Mars 2024 est original et, pour moi, très intéressant : la bibliothécaire est allée chercher dans la médiathèque des romans qui ont eu du succès il y a 20 ans , donc en 2004 !