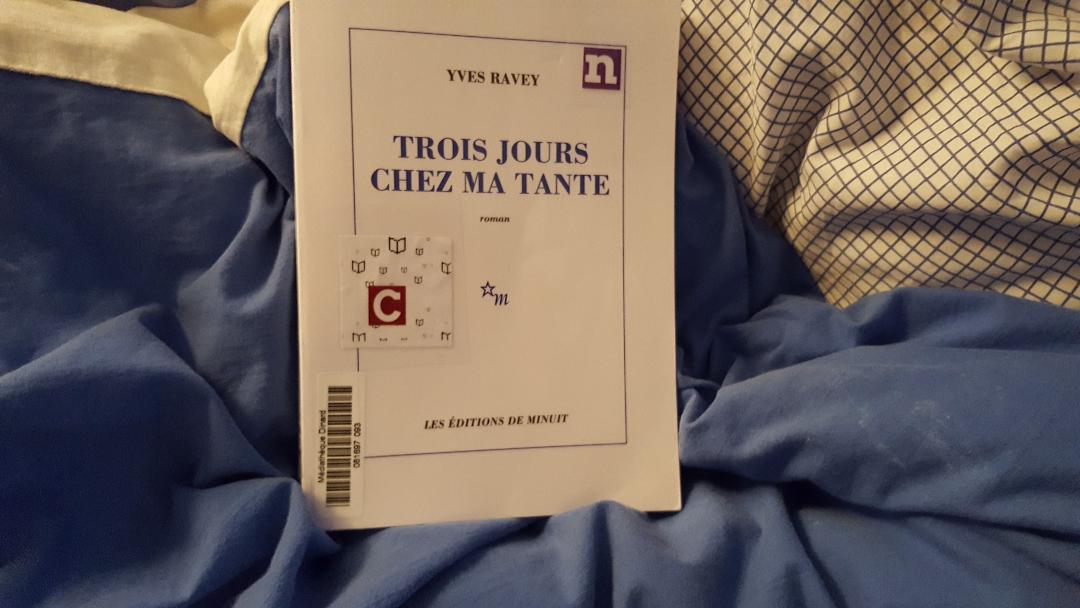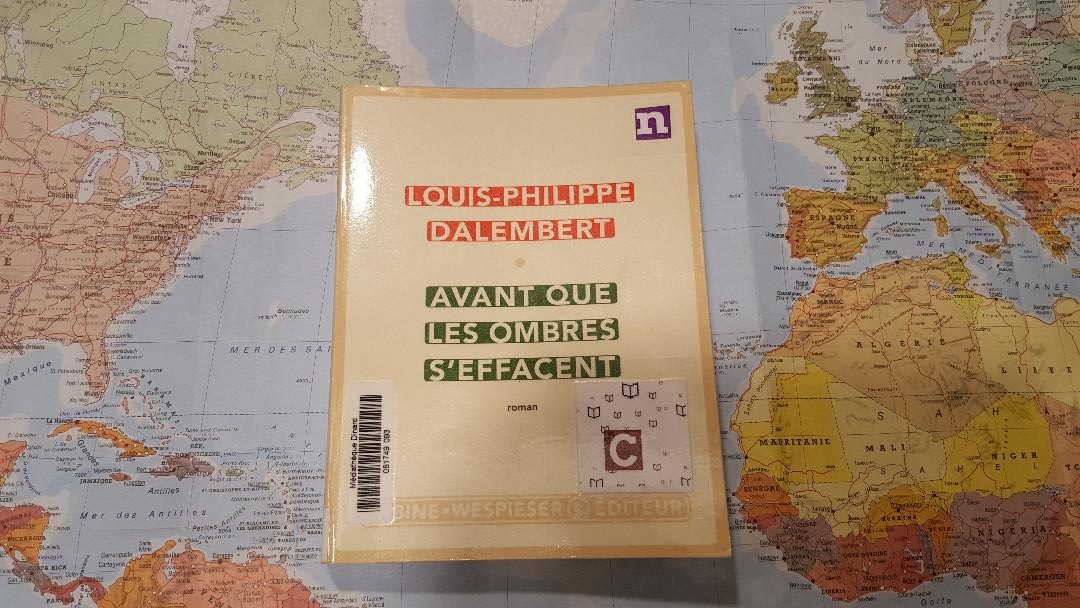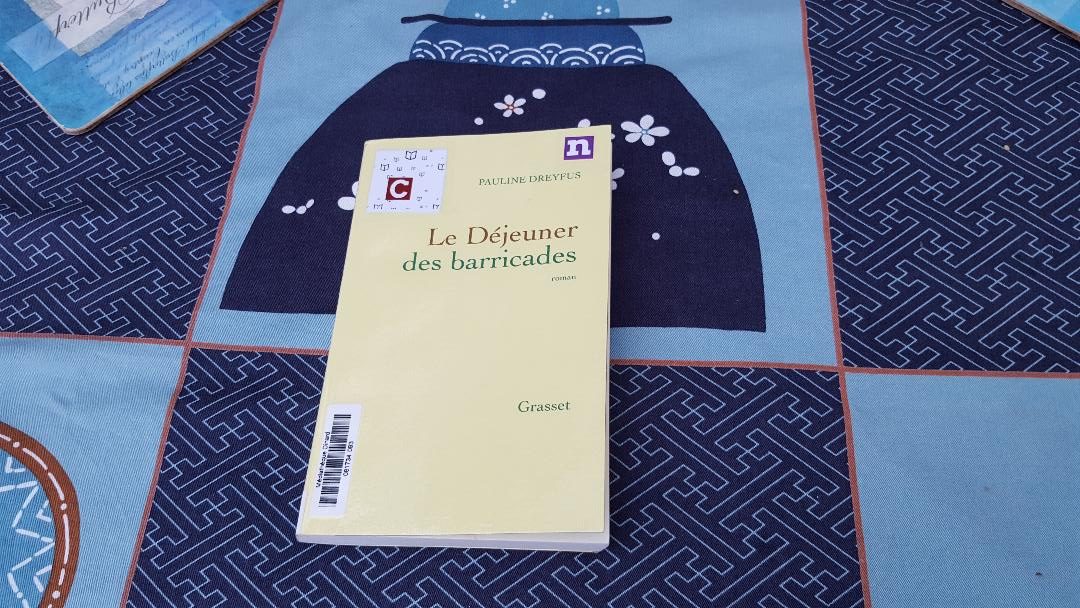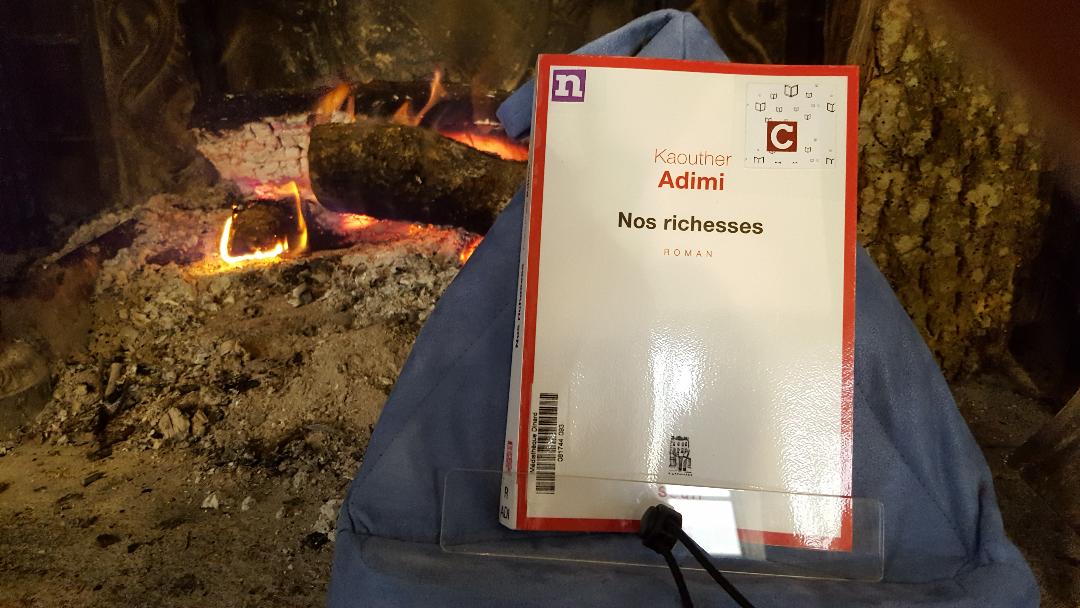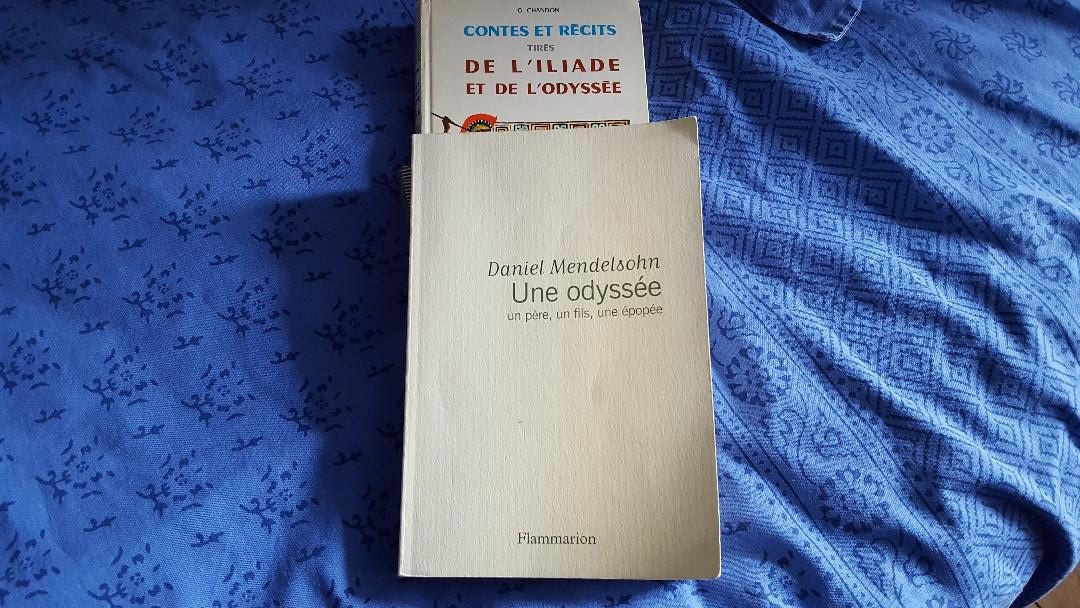Fierté française
Pour ceux qui l’auraient un peu oublié, le béton précontraint figure au nombre des fiertés françaises, avec le romanée-conti, la cathédrale de Chartes, le N°5 de Chanel et bien d’autres.

Merci Keisha, qui a été la première à me donner envie de lire ce livre, depuis j’ai lu d’autres avis tout aussi élogieux sur ce « roman » qui mérite plus le titre de « documentaire », à mon avis. J’ai écouté Laurence Cossé parler de son livre, elle explique qu’elle voit ce monument comme l’expression de la tragédie de son architecte : Johann Otto von Spreckelsen. Celui-ci a démissionné de ce projet en 1986 lorsque le gouvernement de Jacques Chirac renonce au « Carrefour International de la Communication » et il meurt quelques mois plus tard en exigeant que son nom ne soit pas associé à la « grande Arche ». Mais auparavant, il avait négocié des royalties sur toutes les photos prises de la grande Arche, et c’est d’ailleurs le seul lien que sa veuve gardera avec la France : les royalties !
L’auteure est très critique aussi pour le monde politique mais curieusement dans les entretiens, elle en veut plus à la droite (Juppé et Chirac) qu’à Mitterrand. Or en lisant ce livre, on est abasourdi par la façon dont ce président a dépensé l’argent de la France. C’est peu de dire qu’il n’avait aucun soucis d’économie et que le fait du prince a coûté très cher aux français et pas toujours pour de bonnes raisons. Comme cette volonté de ne pas traiter le marbre qu’il faut aujourd’hui remplacer. Laurence Cossé critique la droite de ne pas savoir su donner vie « au Carrefour International de Communication » mais personne ne savait quoi mettre derrière ce nom ronflant. La lecture de l’article de Libération explique bien les enjeux politiques de ce projet. Il est vrai que chaque gouvernement avait son idée pour occuper cet espace et que ce n’est pas la plus mauvaise des idées qui a été retenue. Seulement voilà Spreckelsen (qui touchera quand même ces 10 pour cent d’un bâtiment qui coûtera trois milliards sept), n’avait pas derrière lui un bureau d’études capable de mener ce projet à son terme et si, deux noms peuvent être rattachés à ce bâtiment c’est celui de Paul Andreu qui fera tout pour que ce bâtiment se construise malgré les énormes défis architecturaux et les magouilles politiques et Robert Lion directeur de la caisse et des dépôts et consignation qui a trouvé les budgets pour financer la construction.
Le problème majeur de ce bâtiment ce n’est pas tant les prouesses techniques auxquelles il a fallu faire face que le fait que personne n’ait pu lui donner une affectation qui permette aux communs des mortels de venir le visiter. Il s’inscrit à tout jamais dans une belle perspective parisienne et même si son entretien est compliqué à cause des choix esthétiques de l’architecte danois il reste un monument qui a de l’allure. Encore aujourd’hui, l’affectation de la grande Arche n’est pas définie mais on peut de nouveau monter sur son toit et apparemment s’y restaurer. Laurence Cossé vous entraînera dans cette aventure avec un talent étonnant, moi qui suis peu technique j’ai lu avec grand intérêt ce qu’elle dit sur les difficultés des maître d’ouvrages. J’ai soupiré avec elle, quand elle avoue avoir souffert en cherchant à rendre clairs les problèmes architecturaux , mais elle a réussi son pari : on comprend très bien ce qu’elle explique. Comme elle, je vous conseille l’article de Wikipédia, c’est beaucoup moins intéressant que son roman mais cela permet de suivre les différentes péripéties de la construction jusqu’à aujourd’hui..
Citations
Le début de Mitterrand
Il y avait une ambiance extraordinaire, de foi d’espoir… inimaginable aujourd’hui. On baignait dans l’illusion lyrique, tous les fantasmes de la gauche au cœur. N’ayant jamais été au pouvoir, à part de rares exceptions, les nouveaux dirigeants pensaient qu’il y avait énormément à distribuer.
Les absurdités des musées et bibliothèques
Ces films et les quelques livres sur Spreckelsen se trouvent à la bibliothèque de la Cité de l’Architecture, au Trocadéro. Un endroit lumineux, mais où il faut éviter de se rendre en juillet et en août. Car, si la cité est ouverte ces mois-là, la bibliothèque est fermée. Sans doute les autorités font-elles l’hypothèse que ceux qui s’intéressent à l’architecture ont le dos fatigué et doivent aller s’allonger deux bons mois sur la plage.C’est pourtant là une bibliothèque idéale, il serait heureux de pouvoir s’y poser une heure ou deux en été : un aquarium calme et blanc en plein Paris, des milliers de livres, des milliers d’articles, des ordinateurs, vingt lecteur jeunes et du genre le plus sérieux et dix bibliothécaires aux petits soins.
Gabegie d’état
Il y a des pratiques un peu difficile à comprendre dans l’urbanisme, en France. Par exemple d’un candidat puisse gagner un concours, ou une consultation, et que jamais ensuite son projet ne soit construit. Cela s’est pourtant fait cent fois. Souvent c’est politique….
Ce que l’on ne dit pas au contribuable, c’est que l’on fait accepter l’arbitraire à l’architecte évincé en le dédommageant. Toutes les maquettes de projet écartés qui s’entassent dans les réserves des musée de l’architecture valent chacune leur poids d’or.
Les Danois et nous
Il portait ces préventions en lui depuis longtemps, avec tous les Danois. Nous avons du mal à le croire, nous autres français qui nous croyons rationalistes, organisés et pour tout dire très intelligents, mais aux yeux de beaucoup de nos voisins nous sommes des passionnels, des idéologues, des phraseurs, des agités, des individualistes, enfin des gens peu sûrs.Le plus triste c’est que la réalité a donné raison à Spreckelsen et à ses craintes. Dans les derniers moments de sa vie, trois ans plus tard, dans le film de Tschernia-, il parle sans rancoeur mais il a des mots définitifs sur le peu de sens du contrat en France, sur les remises en cause incessantes des choix collectifs, sur la violence des affrontements entre camps politiques. Et là, il parle d’expérience.
Les débuts de l’informatique
Spreckelsen n’a jamais touché un ordinateur mais ADP commence à en être équipé. La période est unique dans l’histoire. On est à cheval sur deux ères. Les quantités documents ont été dessinés à la main sur papier. Après les avoir numérisé, il faut les faire viser par les auteurs puis obtenir l’approbation des architecte en chef. À vouloir concilier les deux systèmes, certains se demande si on ne perd pas plus de temps qu’on en gagne. À l’époque, à l’observatoire de Meudon, un vieil astronome qui se méfie de l’informatique refait tous les calculs de l’ordinateur, de la façon dont tu as toujours fait.
PARLONS CHIFFRES
Un point n’est pas conflictuel -et d’ailleurs jamais évoqué dans la littérature sur les grands travaux-, les architectes sont très bien payés. Inge Reitzel en sourit : » Nous étions voisins des Spreckelsen, à côté de Copenhague. Dans l’été 1985, allant chez eux, nous avons vu deux Jaguar devant la maison. »
Rien là d’exceptionnel. Pei pour le Louvre, Ott et Bick pour la Bastille, Tschumi et Fainsilber pour la Vilette, Chemetov pour Bercy, tous les architectes des grands travaux touchent les honoraires d’usage, quelque dix pour cent du total du coût de la construction. La modernisation du Louvre atteindra plus de six milliards de francs, la grande bibliothèque huit milliards, l’Opéra Bastille trois milliards, la Cité de la Musique un milliard trois , l’Arche trois milliards sept. Cela fait pour chacun des architectes, » une bonne pincée », comme dit Andreu.Spreckelsen est particulièrement bien traité quand on sait que son travail n’est pas comparable à ce que produit Pei, par exemple. Le second a dans sa manche un grand bureau d’études et va très loin dans le détail. Les entreprises qui construisent sous sa gouverne n’ont qu’à exécuter ses plans. Le premier à quelques collaborateurs pour la circonstance, et la qualité du travail technique indispensable à son projet est sous la responsabilité d’Andreu. « Je ne sais pas comment Spreckelsen s’était débrouillé pour obtenir des honoraires pareils », se demande encore Dauge qui, aussitôt, esquisse une hypothèse : « Il avait l’appui du président « .Sur un autre chapitre de son contrat, Spreckelsen a été bien conseillé aussi. Il a obtenu l’exclusivité des droits sur l’image. On aura besoin de son autorisation pour reproduire l’Arche et, qu’on l’ait ou non demandé, tous les droits de reproduction lui reviendront. Il ne se publiera pas une carte postale qu’il n’ait droit à une redevance.En théorie, rien de nouveau. Cela fait plus d’un siècle que les architectes se sont vu reconnaître ce droit dérivé de la propriété artistique. Dans les années 80, cependant, la plupart en sont restés à la conception selon laquelle ce qui appartient à la rue, à la ville ou au paysage appartient à tout le monde, et ne demande pas de droits sur l’image de leurs œuvres. Spreckelsen en demande. Il en demande.l’exclusivité.Quand ses confrères découvriront de quoi il retourne, ils commenceront par s’offusquer, puis ils s’y mettront à leur tour. Il y a souvent plus à gagner aujourd’hui à vendre les images que ses œuvres mêmes. Un architecte comme Pei touche des millions sur les photos de ses ouvrages architecturaux. Les peintres et les sculpteurs ne sont pas en reste. Buren s’en est fait une spécialité. Jusqu’aux propriétaires de sites naturels, qui ont pensé être fondés à prélever leur dîme sur des photos publicitaires où figuraient leurs terres – en vain, quant à eux.
Des aspects techniques
Les fondation n’en sont pas , du moins au sens classique. L’ Arche n’est pas ancrée en profondeur comme usuellement les immeubles et les tours, elle repose sur des pilliers. Ce n’est pas le premier édifice fondé de la sorte, les ponts le sont souvent, quelques centrales nucléaires, et Paul Andreu a eu recours au procédé de l’aérogare de Roissy. Mais on n’a jamais vu cela dans le bâtiment. Le toit n’a pas grand-chose d’un toit puisque c’est un palais suspendu d’un hectare posé sur deux immeubles aux extrémités. La cage à ascenseurs externe sera le plus grand ouvrage en acier inoxydable jamais assemblé, les dômes en altuglas qui coifferont les ascenseurs les plus spacieux jamais réalisés. …tout est exceptionnel, on va donc devoir innover beaucoup. Ainsi, on emploie pour la première dans ces proportions un hyperbéton, deux fois plus résistant que le béton ordinaire mais beaucoup plus fluide, et difficile à manier.Ça n’a l’air de rien pour le béotien, mais quand Andreu écrit « personnellement je n’avais jamais utilisé ce béton à haute résistance » , c’est un peu comme si un commandant de sous-marin déclarait au moment de plonger qu’il est curieux de découvrir un nouveau système de ballast.
Les fêtes de la mitterandie
Dans l’après-midi de semaine 14 juillet , le quinzième sommet des sept pays les plus riches du monde s’est ouvert au Louvre où François Mitterrand a inauguré cette fois la petite pyramide et l’immense sous-sol signé Peu. Le lendemain le 15, les chefs d’État, leurs suites et la presse du monde entier se transportent en haut de l’Arche.Le faste du moment et inimaginable aujourd’hui en France. Un des grands espaces carrés du toit a été transformé en salle de conférence ronde par l’architecte et le musicien Franck Hammoutène. Chacun des meuble de ce Saint des saints, dessiné pour la circonstance, ne servira qu’à cette unique occasion, y compris la table-monument de verre et de granit, ronde, elle aussi, comme il se doit,et si vaste, avec ses sept mètres vingt de diamètre, qu’il a fallu la monter en pièces détachées en hélicoptère. Quelques Rodin, Minet et Picasso ont été prêtée par les musées nationaux pour égayer la pièce. Dans les autres salles du toit, Andrée Putman à installé des lieux de repos dont elle a conçu le mobilier lui aussi éphémère au sens littéral, une salle à manger, un bar en demi cercle, autant de salons que de délégations, strictement identiques à part les couleurs, « taupe, ivoire, cigogne, camel », d’une banalité parfaite et donc propres à éviter tout incident diplomatique.Tout cela sera démonté dans les jours suivants. Grosse rentrée en vue pour le Mobilier national.
Les mesquineries des politiques
Habilement, le concours est ouvert aux seuls architecte français. Très ouvert : une esquisse seule est requise, et le règlement est léger. Le président Mitterrand se dit favorable au projet d’une tour de bureau, lui dont ce n’est pourtant pas le genre. Une seule explication : c’est que Michel Rocard, son premier ministre et le vieil adversaire à gauche, s’oppose pour sa part à de nouveaux immeubles de bureaux à la Défense.