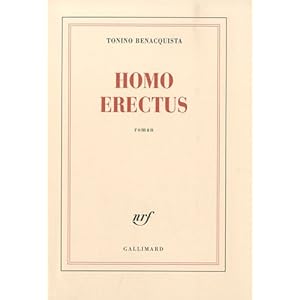Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Lucie Delplanque.

Je voulais comprendre ce qu’était Facebook. J’ai donc lu ce livre et j’ai bien compris , je le recommande donc, à tous ceux ou celles, qui se posent des questions sur ce phénomène. Le livre n’a pas d’autre intérêt que de nous faire comprendre le monde très particulier d’une création sur Internet qui fait gagner beaucoup d’argent. L’écrivain n’a pas pu rencontrer Mark Zuckerberg (le personnage principal) alors il raconte cette histoire à partir des témoignages de ceux qui ont entouré le petit « génie » puis se sont séparés de lui avec procès à la clé. J’ai compris ce qu’était Facebook, c’était le but par contre cela ne rend pas le monde des petits génies d’Internet très sympathique.
L’idée est simple : en ne donnant qu’une adresse email chacun peut retrouver immédiatement tous les gens qu’il a connus et qui sont sur le site Facebook. Le nombre fait que la publicité y est rentable et donc la société vaut beaucoup d’argent. On peut résumer la chose en une formule pour se venger des filles qui ne le regardaient jamais, Mark Zuckerberg a inventé le moyen le plus rapide de rencontrer des gens. Et lui, a toutes les filles qu’il veut car il est très, très, riche !
Depuis je suis sur Facebook… Mais je n’ai rencontré personne.
Citations
Le type à la droite d’Eduardo, un grassouillet d’un mètre soixante-cinq, était membre de l’équipe d’échecs de Harvard et parlait couramment six langues. Rien de vraiment utile en matière de drague.
Pour un observateur extérieur la relation qu’il entretenait avec son ordinateur semblait bien plus harmonieuse que toutes celles qu’il pouvait créer avec le monde extérieur. Mark ne semblait jamais aussi heureux que devant son écran.
Même à Harvard, la plus prestigieuse université du monde, il n’était en réalité que question de cul. To fuck or not to fuck. Il y avait ceux qui s’envoyaient en l’air et les autres.
C’était un outil inouï pour lubrifier les rapports sociaux. Tout allait beaucoup plus vite. Sur Facebook, vous connaissiez déjà les gens que vous invitiez à être vos amis en ligne, même si vous ne leur aviez parlé qu’une fois.
On en parle
Stef au pays des livres.