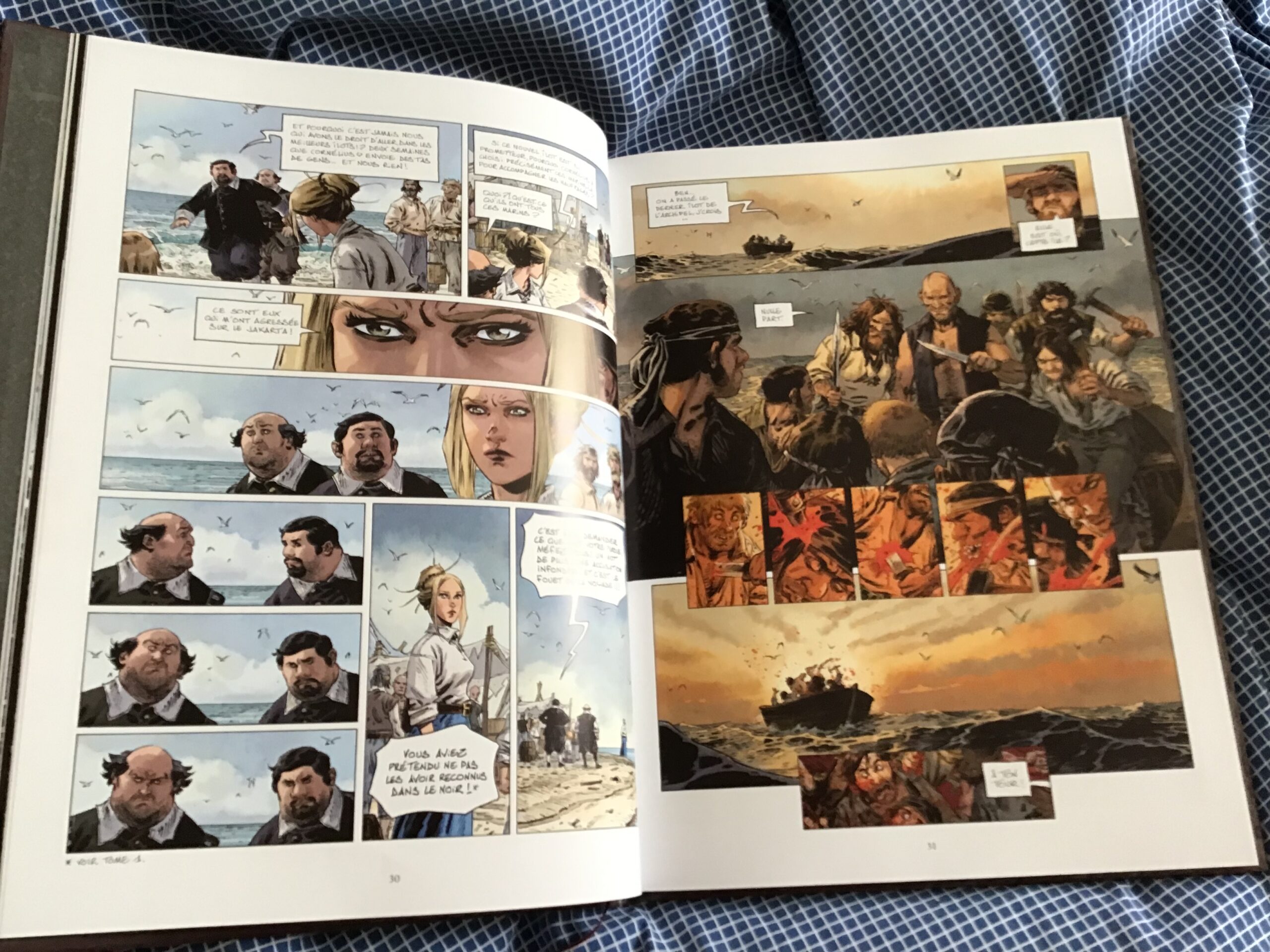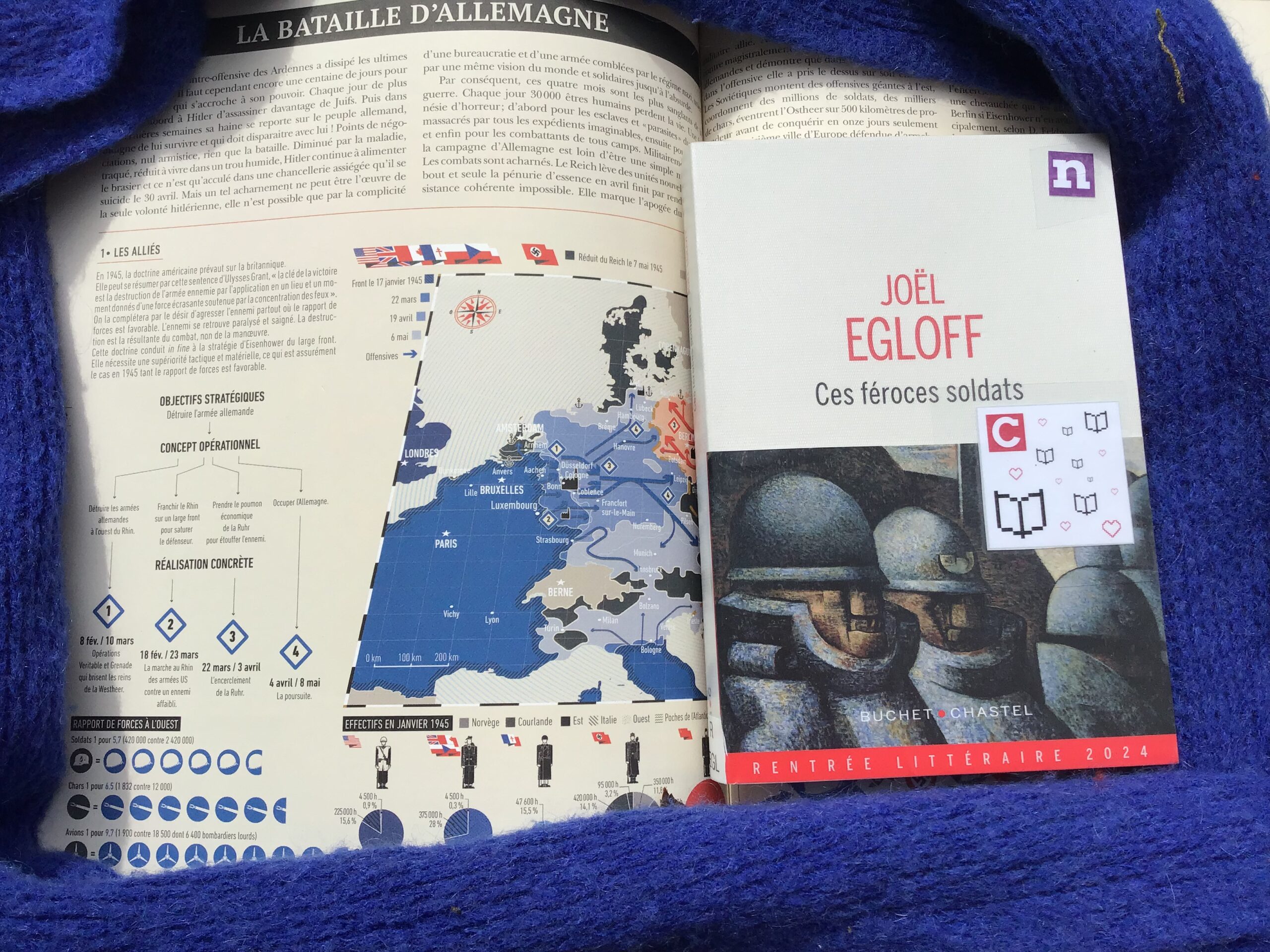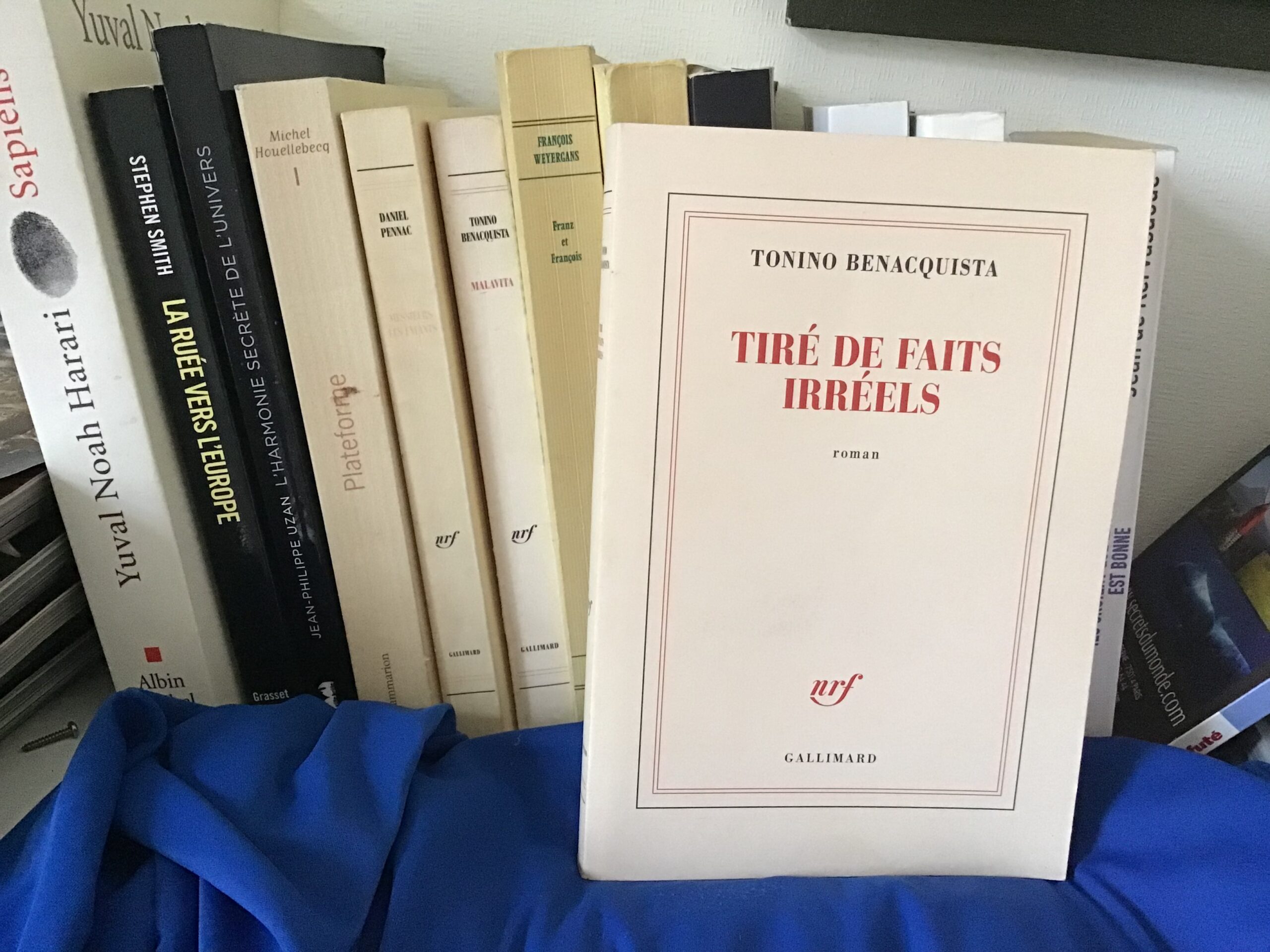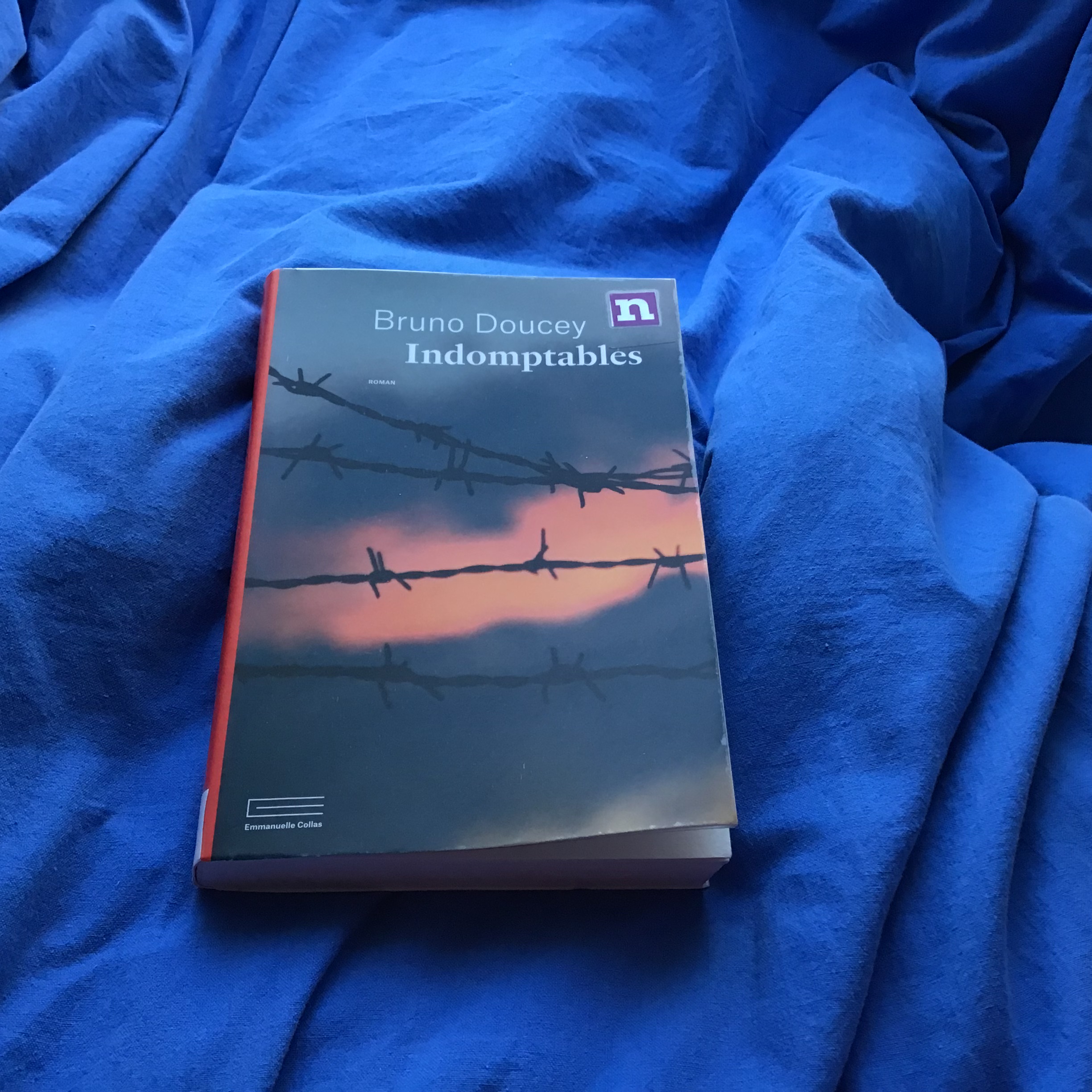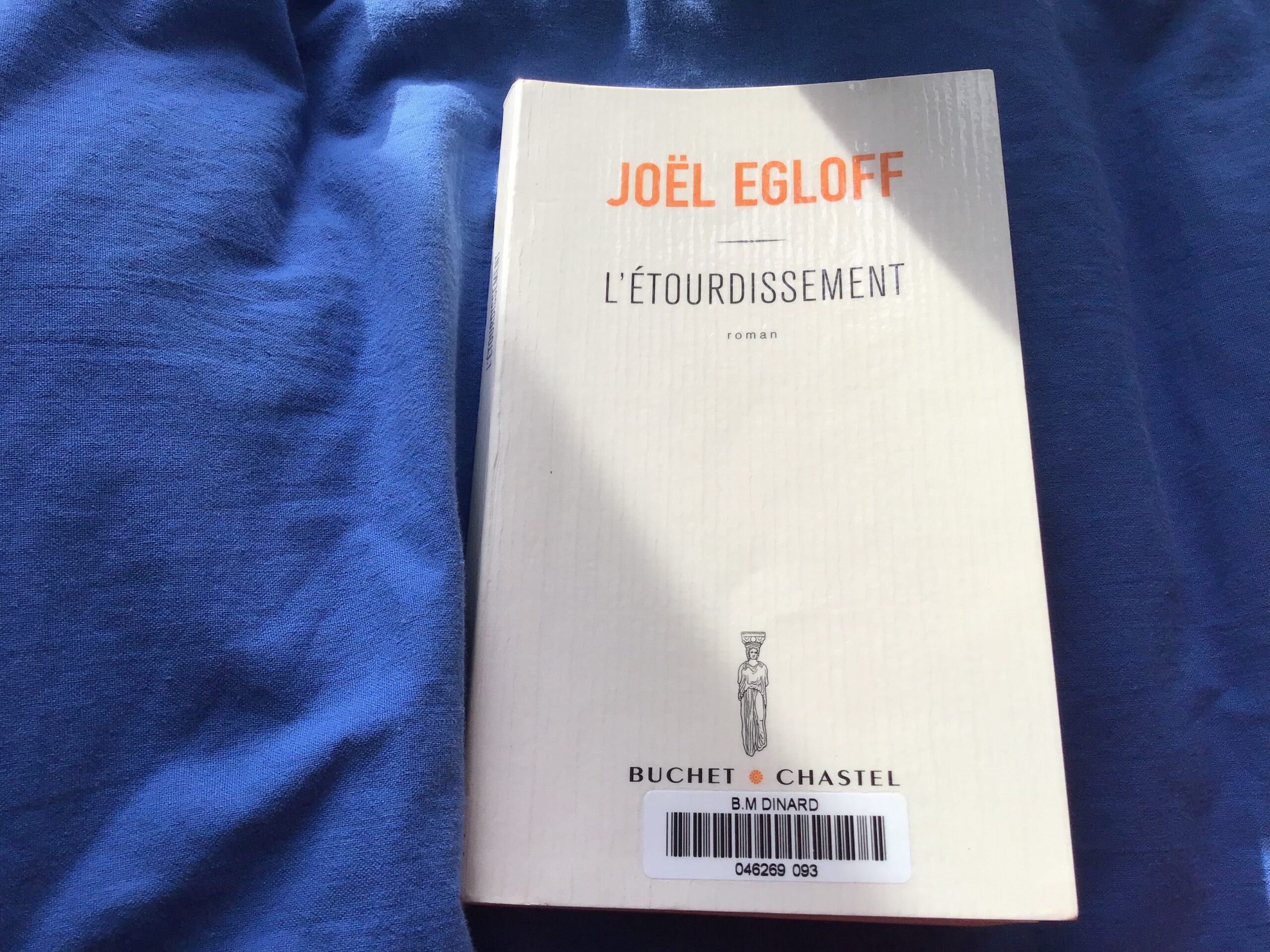Éditions du sous sol, 388 pages, février 2025
Lu dans le cadre du club de lecture de la médiathèque de Dinard.
 Je voulais lire ce roman pour son titre, comme tant d’Élisabeth , le personnage principal a supporter un dimunitif toute sa vie, pour elle c’était Betsy. Je connais bien ce phénomène. Peut-on être la même personne quand on vous vous appelez Élisabeth, mais que votre entourage déforme en Betsy, Babeth, Zabou ou Zabeth ?
Je voulais lire ce roman pour son titre, comme tant d’Élisabeth , le personnage principal a supporter un dimunitif toute sa vie, pour elle c’était Betsy. Je connais bien ce phénomène. Peut-on être la même personne quand on vous vous appelez Élisabeth, mais que votre entourage déforme en Betsy, Babeth, Zabou ou Zabeth ?
Cette remarque, toute personnelle, a peu de choses à voir avec ce roman qui raconte encore, une fois, une souffrance familiale scrutée par une écrivaine qui sait que son arrière-grand-mère, Betsy a été lobotomisée pour la « guérir » de sa schizophrénie. Cette maladie mentale plane dans toute la famille, cela procure en particulier chez les femmes une peur sourde et latente de porter en elles, cette folie.
Adèle Yon part à la recherche de ce qu’il s’est passé pour Betsy, jeune femme fiancée à André, séparée de son fiancé par la guerre 39/45 , puis mariée, accouchant de six enfants, et faisant des dépressions gravissimes et des crises de « folie ». À la demande de son mari, elle finit par subir une lobotomie et est internée loin de sa famille dans la Sarthe. Avec l’évolution de la psychiatrie, elle ressortira de ce mouroir pour « fous », et reviendra non pas auprès de son mari et de ses enfants mais dans sa propre famille maternelle.
L’autrice tape à toutes les portes pour faire la lumière sur la vie de Betsy. Le livre raconte tout et cela donne un aspect un peu fouillis, pas désagréable mais qui demande au lecteur une certaine vigilance. Le récit de l’écrivaine est en caractères graphiques habituels, les interviews, les lettres, les mails sont dans une autre typographie. On passe par tous les moments de cette enquête pas toujours passionnante, les archives des hôpitaux psychiatriques m’ont carrément ennuyées . L’autrice semble vouloir abandonner son enquête et part travailler en boucherie industrielle, elle le raconte bien , mais franchement la comparaison entre la lobotomie et le découpage du porc m’a semblé pour le moins inutile voire déplacée !
Il apparaît de façon évidente que le mari de Betsy n’a pas voulu prendre en charge sa femme et que, les six grossesses n’ont pas aidé cette pauvre femme à aller mieux. Le plus dur pour elle , c’est de n’être pas retournée vivre avec son mari quand les psychiatres plus humains l’ont déclarée apte à vivre en dehors de l’hôpital.
Les recherches que l’auteure a menées autour de la lobotomie m’ont beaucoup intéressée. C’est la raison pour laquelle j’ai mis quatre coquillages, alors que pour l’ensemble j’aurais plutôt mis 3 coquillages. La lobotomie est une pratique qui a eu beaucoup de succès aux USA, un peu moins en France et qui n’est toujours pas interdite. 85 % des personnes lobotomisées étaient des femmes, et c’était une pratique dangereuse qui n’a jamais guéri personne mais qui, dans le meilleur des cas, calmait les malades.
Pour l’écrivaine qui a ouvert tous les placards à secrets de sa famille, elle décrit le père de Betsy comme autoritaire et harceleur si ce n’est incestueux, le mari comme quelqu’un incapable d’aider sa femme et responsable de cette lobotomie qui a empêché tout progrès pour la santé de son épouse qu’il a abandonnée dans un hospice sordide.
Une fois encore, l’autrice pense que ce lire l’a aidée à guérir de sa peur de la folie et elle le dédie à toute celles qui ont la même peur qu’elle :
Je remercie enfin toutes les femmes qui, au cours de ce voyage et au-delà, m’ont fait part de leur expérience de la maladie mentale, de la peur, de la menace, du découragement, du poids familial, du silence, de la colère. Je remercie toutes celles et ceux qui apercevront leur histoire dans le creux de celle-ci. Ce livre est pour nous : qu’il nous libère.
Extraits
Première page
Objet : Jean-Louis Important
Date : 4 janvier 2023 à 02:18:49
À : LA FILLE CADETTE
Quand tu liras ces mots, j’aurai fini mes jours après avoir basculé dans le vide depuis le balcon de l’appartement que j’ai loué au 7° étage.
Début du chapitre 1.
L’inventeur devenu millionnaire du Minitel rose préparait l’opération depuis plusieurs mois. Il a mis en ordre ( jeté, donné, brûlé) ses affaires, vendu sa maison du sud de la France, loué un appartement au septième étage d’un immeuble de la rue d’Aligre, rédigé son testament, réglé ses obsèques, écrit un mail à trois personnes, téléphoné à la police pour l’avertir qu’il s’apprêtait à sauter du septième étage d’un immeuble de la rue d’Aligre et, le 4 janvier 2023 à trois heures du matin, il a sauté du septième étage de l’immeuble de la rue d’Aligre, laissant derrière lui en évidence sur la table de la cuisine, les clés d’une voiture de location Honda 245AWD32 garée dans le parking de l’immeuble.
La peur d’être folle.
Il y a pour moi un risque génétique : tout le monde sait que c’est à la sortie d’adolescence que le risque de développer une maladie mentale est le plus fort. Il n’y a aucun doute c’est ce qui est en train de m’arriver. Ai-je moi-même induit que mon arrière-grand-mère était schizophrène en une confusion qui n’était pas sans précédent entre la folie en général et la schizophrénie en particulier ?
Travail de boucherie
En boucherie, le couteau se tient comme un poignard que l’on s’apprêterait à plonger dans un corps de dos, le poing serré vers l’extérieur, la lame vers soi. Toute la force est concentrée dans le poignet. Pour cette raison, les apprentis bouchers se revêtent d’une cotte de mailles : un geste manqué finirait sans hésiter dans nos entrailles. En boucherie, on est soi-même son propre ennemi, son meurtrier potentiel.
Façon de soigner la maladie psychiatrique.
Le développement de la chirurgie gynécologique rendent soudain possible de la guérison du mal à la racine, ils permettent de l’extraire comme un vulgaire kyste, une excroissance sans laquelle le corps demeure parfaitement intact. Découper, sectionner, exciser, curateur, ablater, amputer : je suis frappée par la manière dont la psychochirurgie fait fond sur une théorie de l’excès selon laquelle l’ablation de certaines parties du corps, comme de tumeurs malignes, permettrait au sujet malade de retrouver son équilibre initial. D’abord, utérus, clitoris ; ensuite lobe frontal des parties « en trop ». La banalisation des violences envers les parties génitales des femmes ouvre naturellement la voie à la banalisation des violences envers leurs cerveaux. Découper l’utérus, découper le cerveau : il n’y a qu’un pas.
Je partage cela avec cette écrivaine.
J’ai une piètre maîtrise de la marche arrière, mes roues se dirigent toujours à l’opposé de ma pensée
 Je lis vraiment peu de BD mais j’essaie de lire celles recommandées par le club de lecture. Ce récit romance un fait historique ; des naufragés de la compagnie hollandaise au XVII° siècle a fait naufrage, et les naufragés se sont entretués de façon horrible.
Je lis vraiment peu de BD mais j’essaie de lire celles recommandées par le club de lecture. Ce récit romance un fait historique ; des naufragés de la compagnie hollandaise au XVII° siècle a fait naufrage, et les naufragés se sont entretués de façon horrible.