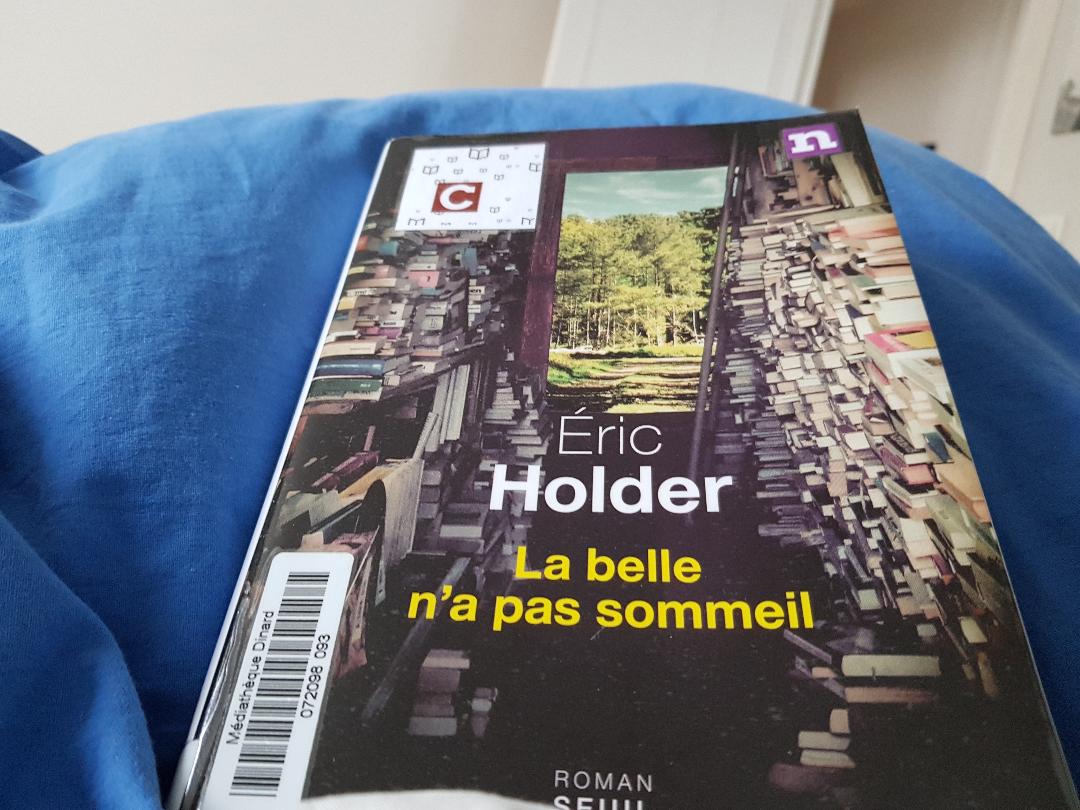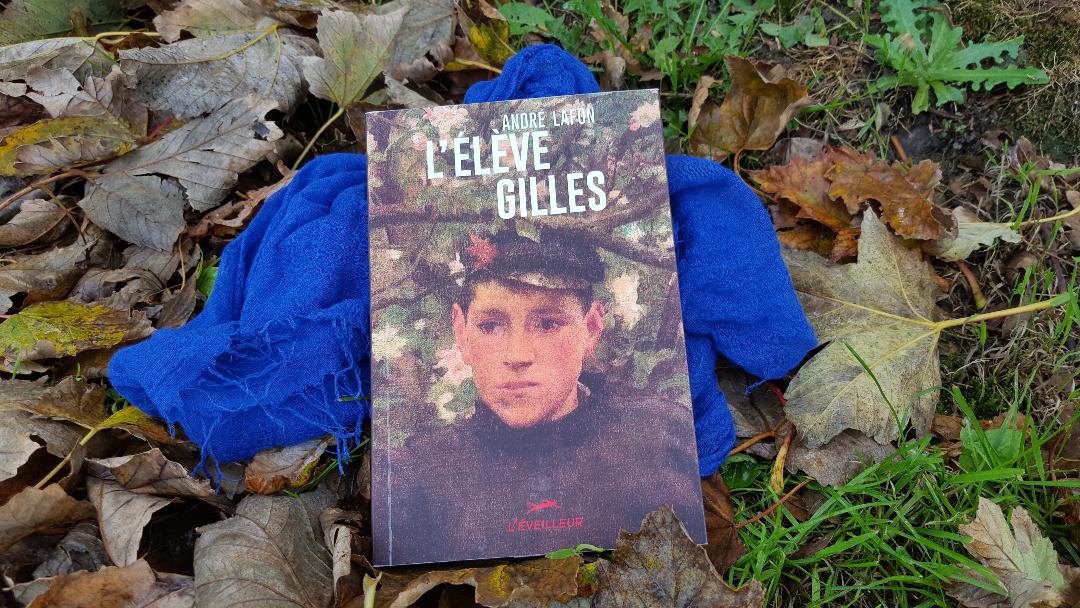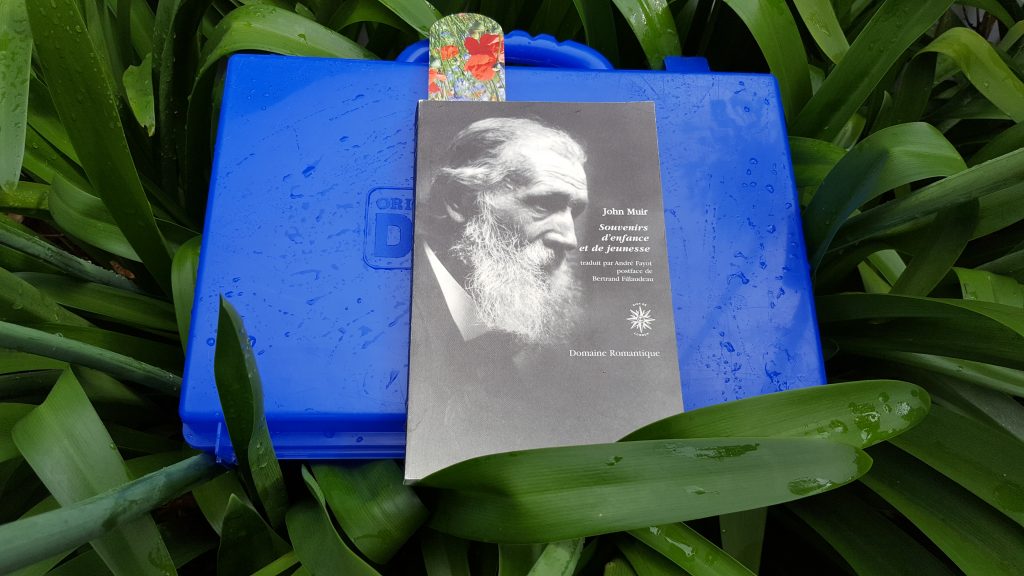Je sais que je dois cette lecture à la blogosphère en particulier à Jérôme mais à d’autres aussi. J’ai d’abord dégusté et beaucoup souri à la lecture de ce petit livre et puis je me suis sentie si triste devant tant de destructions, à la fois humaines et écologiques. Le regard de cet auteur est implacable, il sait nous faire partager ses révoltes. Comme lui, j’ai été indignée par le comportement de Philippe Boulet qui refuse de donner un simple coup de fil pour sauver de pauvres Malgaches partis en pirogues. Un de ses adjoint finira par l’y contraindre , mais trop tard si bien que seuls 2 sur 8 de ces malheureux ont été sauvés et vous savez quoi ?
Je sais que je dois cette lecture à la blogosphère en particulier à Jérôme mais à d’autres aussi. J’ai d’abord dégusté et beaucoup souri à la lecture de ce petit livre et puis je me suis sentie si triste devant tant de destructions, à la fois humaines et écologiques. Le regard de cet auteur est implacable, il sait nous faire partager ses révoltes. Comme lui, j’ai été indignée par le comportement de Philippe Boulet qui refuse de donner un simple coup de fil pour sauver de pauvres Malgaches partis en pirogues. Un de ses adjoint finira par l’y contraindre , mais trop tard si bien que seuls 2 sur 8 de ces malheureux ont été sauvés et vous savez quoi ?
En tant que chef de mission, Philippe Boulet a été décoré d’une belle médaille par le gouvernement malgache pour son rôle émérite dans le sauvetage des pêcheurs. un article de presse en atteste. Il sourit sur la photo.
La vision de la Chine est particulièrement gratinée, entre les ambiances de façades et la réalité il y a comme un hiatus. Comme souvent dans les pays à fort contrastes « le gringo » ou le »blanc » est considéré comme un porte monnaie ambulant. L’auteur se moque autant de ses propres comportements que ceux des touristes qui veulent absolument voir de « l’authentique ». Mais souvent la charge est lourde et quelque peu caricaturale. C’est peut être mon âme bretonne qui m’a fait être agacée aux portraits de bretons alcooliques. Ceci dit, pour voyager comme il le fait, il vaut mieux résister à l’alcool car on est souvent obligé de partager le verre de l’amitié qui est rarement un verre de jus de fruit quand on veut absolument vivre avec et comme les autochtones.
Enfin, le pire c’est le traitement de la nature par l’homme, c’est vraiment angoissant de voir les destructions s’accumuler sous le regard des gens qui se baladent de lieux en lieux sans réaliser que, par leur simple présence, (dont celle de l’auteur !) ils contribuent à détruire ce qu’ils trouvent, si « jolis », si « authentiques », si « typiques »….
Citations
Humour
J’ai passé des journées à marcher dans les rues, fouiner chez les disquaires de Soho, contempler l’agitation de Notting Hill ou des puces de Camden. Tout cela était très intéressant, je rencontrais d’autres possibles, mais ça ne m’aidait pas réellement à savoir qui j’étais. Le déclic eut lieu une nuit que j’étais à me morfondre dans quelque pub anglais au cœur de Londres. Accoudé sur un comptoir, je noircissais des page de cahier à spirale, dans une navrantes tentative postadolescente de devenir Arthur Morrison. Je zonais depuis une semaine, le groupe du pub reprenait Walk Of Life et j’en étais à écrire des sonnets sous Kronenbourg quand quelqu’un a renversé son verre de Guinness sur mes vers de détresse. Une vision, féminine, chevelure fatal et hormones au vent. Note pour les jeunes poètes maudits : écrire la nuit dans les bars, pour pathétique que ce soit, peut attirer la gourgandine. C’était une vieille, elle avait au moins 25 ans. Elle portait une robe noire sophistiquée et des talons arrogants ; elle travaillait dans la mode. Ses yeux brillaient d’une assurance alcoolisée. Volubile et pleins d’histoires.
Très drôle
Il existe, à l’est de Leeds, localité dont peu de gens soupçonne l’existence. Un port où le soleil n’est qu’un concept lointain, une cité prolétaire ou Margaret Thatcher est Satan et Tony Blair, Judas. Une riante bourgade ravagée par la crise postindustrielle, où l’on repère les étrangers à leur absence de tatouages et de cirrhose. Liverpool sans groupe de rock mythique, Manchester sans le foot. Hull est un sujet de moquerie pour le reste de l’Angleterre. Sa page Wikipédia se résume à 5 lignes, c’est que pour une ville de 250000 habitants.
Cette envie de recopier le livre !
Toutes ses économies dilapidées dans un voyage à pile ou face, des mafias engraissées, le cache cache avec la police de deux continents, la peur et le froid. Tout cela pour devenir esclave à Hull, qui concourt au titre de la ville la plus pourrie d’Europe. Khalid n’exprimait aucun regret : « Il vaut mieux être ouvrier à Hul que mort à Kaboul. » Une évidence contre laquelle aucune loi ne peut lutter.… Dix kilomètres jusqu’à la maison. Des cités décaties où descendaient les rouquins à capuche, un immense supermarché Tesco, qui était une des raisons pour lesquelles Azad, Mohamed et Khalid, victimes de la géographie politique avez tenté la vie en Europe. Je travaille à l’usine pour pouvoir voyager. Ils avaient beaucoup, beaucoup voyagé pour venir travailler à l’usine.
Bombay
J’ai entendu quelques histoires de jeunes Anglais venus faire de l’humanitaire en Inde en sortant de chez leurs parents, et repartant au bout de trois jours, traumatisés par la réalité de la misères. Impossible de faire abstraction, dans cette ville où il faut prendre garde à ne pas marcher sur les nouveaux nés qui dorment sur le goudron.
Portrait de surfeurs
Tous ces garçons vivent entre eux dans une colonie de vacances perpétuelle, voyageant d’un spot à l’autre autour du monde, mangeant des corn flakes et des sandwichs à la mayonnaise dans des maisons de location, torse nu, pendant que le coach les dorlote. Le soir, ils boivent des bières autour d’un barbecue. Chaque année, à date fixe, il retrouve Hawaï, la Gold Coast australienne, le Brésil, l’Afrique du Sud ou Lacanau, sans avoir le temps de connaître les endroits qu’ils traversent. Ils ne se préoccupent pas de descendre sous la surface, leur fonction est de rester à flot. Ils gagnent très bien leur vie, ce sont des stars. Leurs performances sportives leur permettent de postuler au Statut de surhomme. Musclés et bronzés, ça va sans dire. Pas très grands, pour des histoires de centre de gravité. Leurs copines sont des splendeurs, rayonnantes de santé et de jeunesse, tout cela est très logique. On pourrait moquer la spiritualité de pacotille qui entoure le monde du surf, bric-à-brac de panthéisme cool où l’homme fusionne avec la nature dans l’action, mais ce n’est pas nécessaire. Ces types consacrent leur vie à la beauté du geste, dans un dépassement de soi photogénique. Ils tracent des sillons parfaits, en équilibre constant entre la perfection et la mort. Ce n’est pas rien.
La Chine
À Chongqing, je je trouve ce que j’aime dans lex tiers-monde. Le chaos organisé, la vie dans la rue, les gens qui vendent n’importe quoi à même le sol, les cireurs de chaussures,( l’un deux a voulu s’occuper de mes tongs), les vieux porteurs voûtés qui charrient le double de leur poids, les bars qui appartiennent à la mafia et les chiens qui n’appartiennent à personne.
À Pékin, on a posé une Chine en plastique sur la Chine. Et ça fonctionne très bien. Ils ont réussi à cacher les pauvres et les crasseux. À Chongqing, il n’y a pas de jeux olympiques. Les pauvres et les crasseux côtoient les costards cravates. Des ouvriers cassent les vieux immeubles à la masse, torse et pieds nus, à 15 mètres du sol. Les normes de sécurité ne sont pas optimales. Mais un centre commercial doit ouvrir dans 20 minutes à cet emplacement , alors il faut faire le boulot.
Portrait féroce et réducteur de l’autre….
Elle est prof. De maths. Allemande. Un sacré boute-en-train. Elle passe son temps à détailler de A à Z, tous les points de désaccord avec la culture chinoise. Je ne comprendrai jamais les gens qui, sortant de chez eux, ne supportent pas qu’on ne se comporte pas comme chez eux. De son côté, elle ne comprend pas que les Françaises s’épilent les jambes régulièrement. C’est pour l’instant, le plus gros choc culturel de mon séjour.