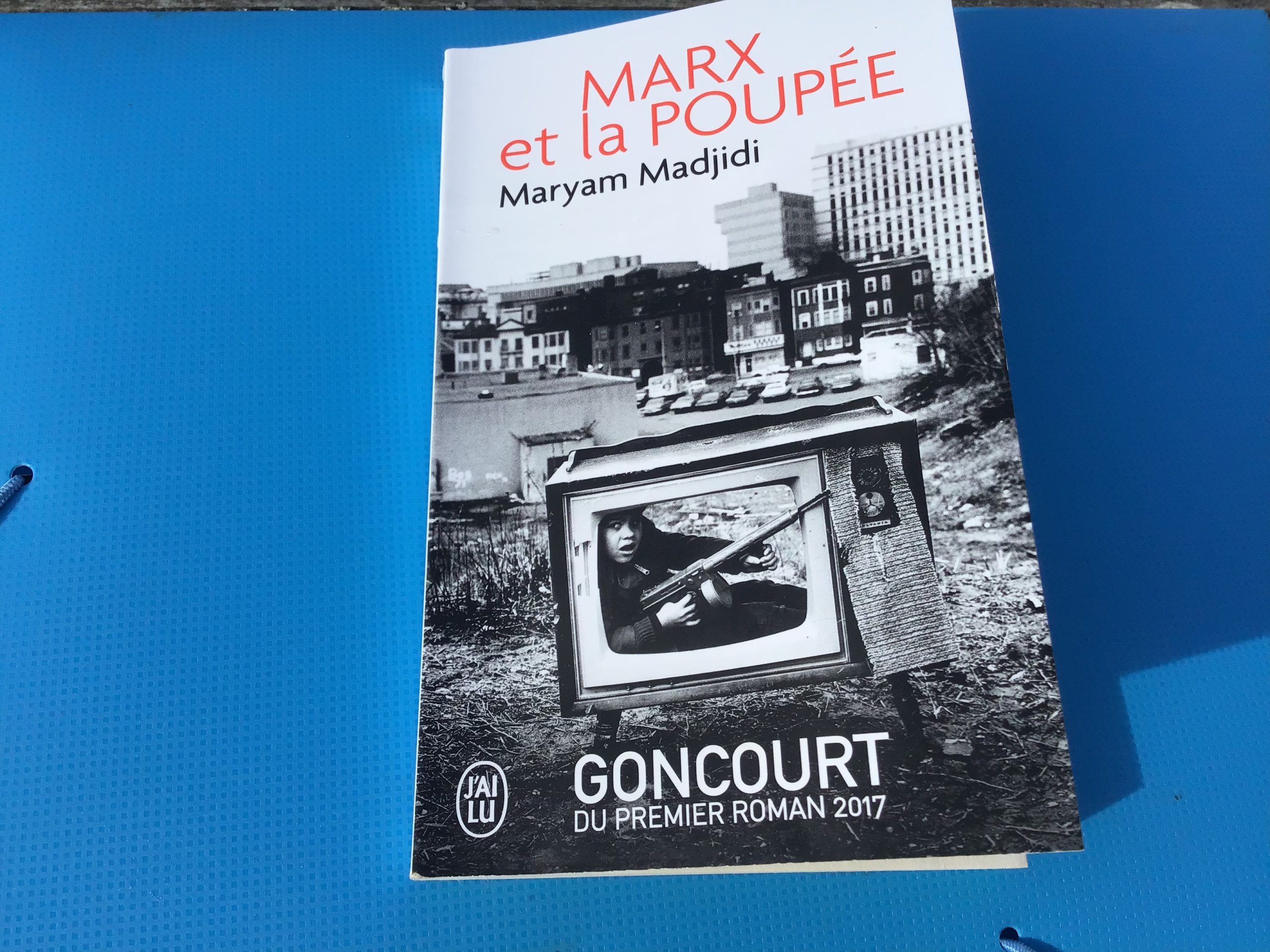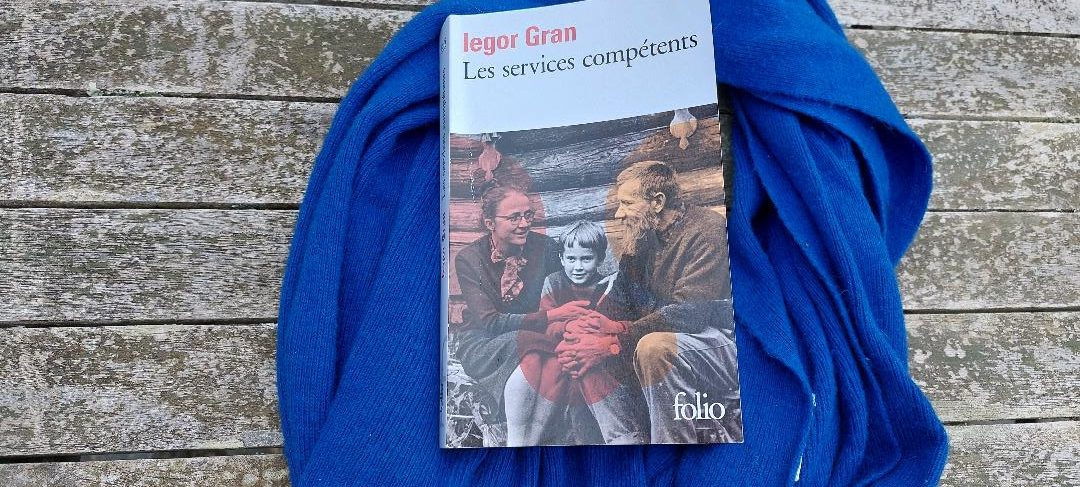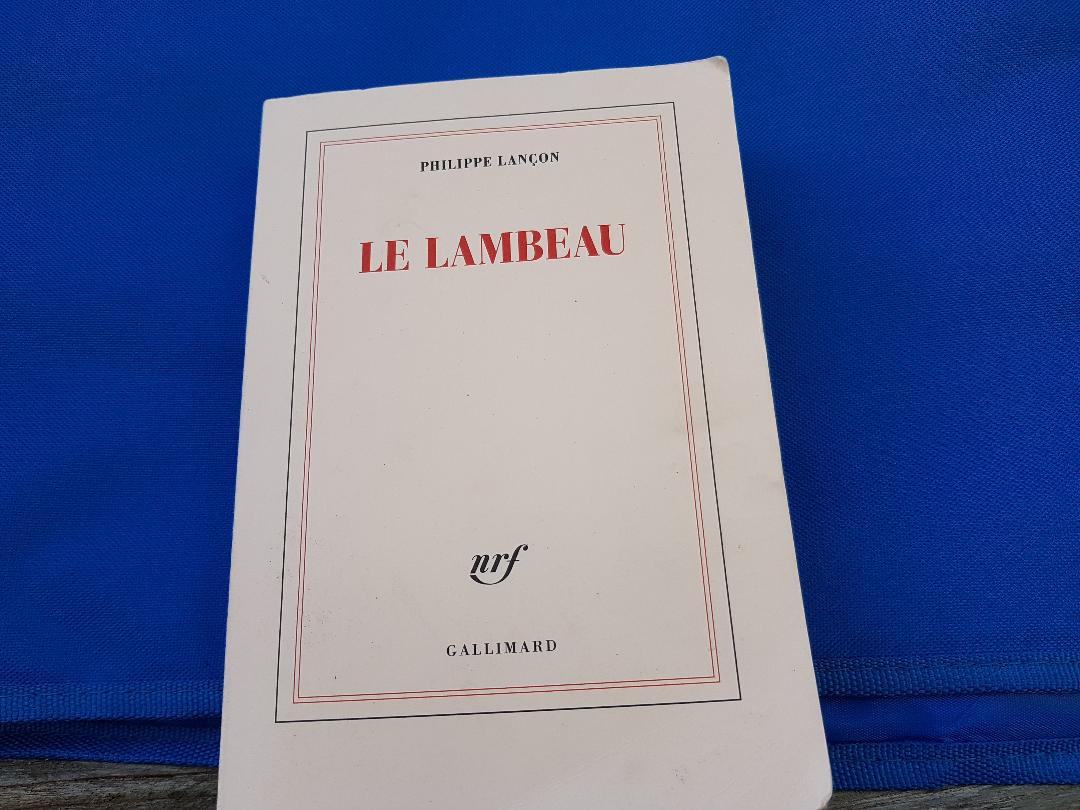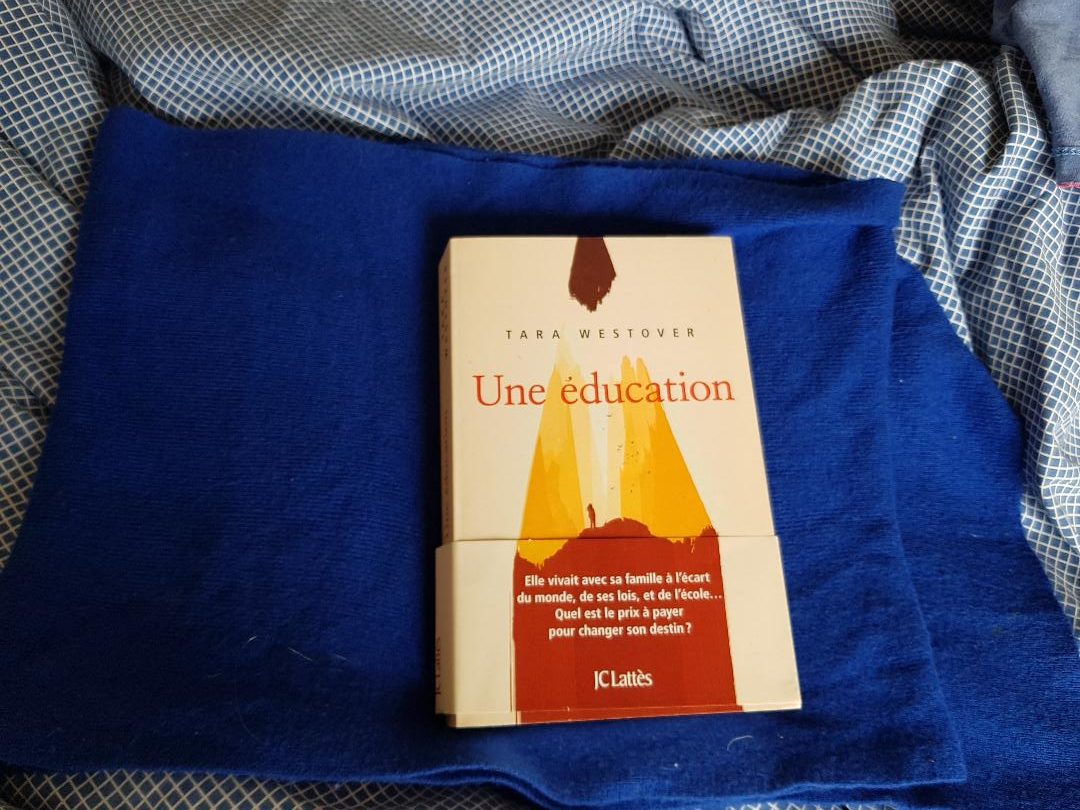J’ai vu ce roman sur de nombreux blogs en particulier, un billet que j’avais remarqué de Dominique, (désolée pour les blogs que j’oublie de citer). J’ai déjà beaucoup lu sur les quêtes de mémoire quand il ne reste plus que des lambeaux de souvenirs de familles décimées par la Shoa. Anne Berest est la petite fille de Myriam qui est elle même la fille d’Ephraïm et d’Emma et la sœur de Noemie et Jacques tous les quatre morts à Auschwitz et dont les noms ont été écrits sur une carte postale envoyée à sa mère en janvier 2003.
J’ai vu ce roman sur de nombreux blogs en particulier, un billet que j’avais remarqué de Dominique, (désolée pour les blogs que j’oublie de citer). J’ai déjà beaucoup lu sur les quêtes de mémoire quand il ne reste plus que des lambeaux de souvenirs de familles décimées par la Shoa. Anne Berest est la petite fille de Myriam qui est elle même la fille d’Ephraïm et d’Emma et la sœur de Noemie et Jacques tous les quatre morts à Auschwitz et dont les noms ont été écrits sur une carte postale envoyée à sa mère en janvier 2003.
Anne est donc juive par sa mère et bretonne par son père. Élevée loin de toute religion par des parents intellectuels et attentionnés, elle accorde que peu d’importance à cette origine. Jusqu’au jour où elle veut savoir et transmettre à ses enfants ce passé. La première partie du livre, nous permet de découvrir le destin de la famille Rabinovitch, originaire de Russie, Ephraïm devient un fervent défenseur du socialisme mais très vite il déchante sur le régime communiste et est obligé de s’enfuir. Sa femme Emma Wolf est originaire de Lodz et aimera toute sa vie son mari malgré quelques divergences en particulier sur la religion, elle est pieuse et respecte les fêtes juives.
1019 date de naissance de Myriam à Moscou, c’est la la grand mère de l’auteure et avec ses parents elle commence une pérégrination à travers une Europe qui ne veut plus de Juifs. La Lituanie puis Israël d’où ils repartiront (hélas) pour la France. Ils ont eu le temps d’aller à Lotz où la famille d’Emma très aisée sent monter l’antisémitisme polonais sans pour autant tenter de fuir.
Enfin, ils arrivent en France avec leurs trois enfants et Ephraïm veut absolument devenir français . La suite on l’imagine : leurs deux enfants seront déportés avant eux Myriam était alors mariée à un français et n’était pas sur la liste du maire d’Evreux, mais elle était là ce jour là, son père l’a obligée à se cacher dans le jardin. Et ensuite Ephraïm et Emma seront à leur tour déportés.
Histoire trop banale , mais si bien racontée avec des allers et retours vers le temps présent et les recherche d’Anne qui s’appuient sur le travail très approfondi de sa mère Leila qui avait déjà trouvé et classé un très grand nombre de documents.
La deuxième partie du récit a pour but de nous faire découvrir la vie de Myriam pendant et après la guerre et finalement au dernier chapitre l’explication de la carte postale.
Le fil conducteur du roman, serait à mon avis de se demander ce que veut dire d’être juif et pourquoi même aujourd’hui l’antisémitisme peut donner lieu à des injures comme « sale juif ! » ou une exclusion d’une équipe de foot car dans la famille d’un petit Hassan de sept ans, on ne joue pas avec les juifs !
Ephraïm a tellement confiance dans la France, le pays des droits de l’homme que jusqu’à la fin il restera persuadé qu’il est à l’abri et ne veut pas entendre les messages d’inquiétude qu’il reçoit. Myriam gardera espoir le plus longtemps possible d’un éventuel retour de sa famille ou au moins de son jeune frère et de sa sœur. Elle s’enfermera dans un mutisme tel que sa propre fille aura bien du mal à comprendre l’horrible réalité et à remonter les fils de l’histoire familiale si intimement liée à celle des pires atrocités du siècle.
Quand Anne Berest part à la recherche de ce qui reste des traces de la présence de ses parents dans le petit village des Forges, j’ai retrouvé ce que j’avais senti en Pologne : la peur que l’on demande des comptes à des descendants de gens qui n’ont pas toujours bien agi voire pire. Comme cette famille chez qui elle retrouve les photos de sa famille et le piano de son arrière grand-mère.
Je n’ai pas lâché un instant cette lecture et je relirai ce livre certainement car je le trouve parfaitement juste et passionnant de bout en bout. Il va faire partie des indispensables et je vais lui faire une place chez moi car comme le dit un moment Anne Berest c’est important que les juifs envahissent nos bibliothèques, on ne peut plus faire comme si l’antisémitisme n’avait été que l’apanage des Nazis même si ce sont eux qui ont créé la solution finale celle-ci n’a pu exister que parce que chez bien des gens on ne voulait pas savoir ce qui arrivait à « ces gens là » quand on les parquait dans des camps puis quand on les faisait monter dans des trains pour l’Allemagne.
Citations
Un moment de notre histoire.
Ephraïm suit de près l’ascension de Léon Blum. Les adversaires politiques, ainsi que la presse de droite, se répandent. On traite Blum de « vil laquais des banquiers de de Londres », « ami de Rothschild et d’autres banquiers de toute évidence juifs ». « C’est un homme à fusiller, écrit Charles Maurras, mais dans le dos »
Dialogue du petit fils avec son grand père juif et croyant .
– Tu es triste que ton fils ne croit pas en Dieu ? demande Jacques à son grand-père.– Autrefois oui j’étais triste. Mais aujourd’hui, je me dis que l’important est que Dieu croit en ton père.
La liste Otto.
Tout à fait, la La liste « Otto » du nom de l’ambassadeur d’Allemagne à paris, Otto Abetz. Elle établit la liste de tous les ouvrages retirés de la vente des librairies. Y figurait évidemment tous les auteurs juifs, mais aussi les auteurs communistes, les français dérangeants pour le régime, comme Colette, Aristide Bruant, André Malraux, Louis Aragon, et même les morts comme Jean de la Fontaine …
L’importance de porter un nom juif.
Mais petit à petit, je me rend compte qu’à l’école, s’appeler Gérard « Rambert » n’a vraiment rien à voir avec le fait de s’appeler Gérard « Rosenberg » et tu veux savoir quelle est la différence ? C’est que je n’entendais plus de « sale juif » quotidien dans la cour de l’école. La différence c’est que je n’entendais plus des phrases du genre « C’est dommage qu’Hitler ait raté tes parents ». Et dans ma nouvelle école, avec mon nouveau nom, je trouve que c’est très agréable qu’on me foute la paix.(…)– Moi aussi je porte un nom français tout ce qu’il y a de plus français. Et ton histoire, cela me fait penser que…– Que ?– Au fond de moi je suis rassurée que sur moi cela ne se voie pas.
Je trouve cette remarque très juste.
Myriam constate que Mme Chabaud fait partie de ces êtres qui ne sont jamais décevants, alors que d’autres le sont toujours.– Pour les premiers, on ne s’étonne jamais. Pour les seconds, on s’étonne chaque fois. Alors que ça devrait être l’inverse, lui dit-elle en la remerciant.
Le sens du livre .
Interroger ce mot dont la définition s’échappe sans cesse– Qu’est ce qu’être juif ?Peut-être que la réponse était contenue dans la question :– Se demander qu’est-ce qu’être juif(…) Mais aujourd’hui je peux relier tous les points entre eux, pour voir apparaître, parmi la constellation des fragments éparpillés sur la page, une silhouette dans laquelle je me reconnais enfin : je suis fille et petite fille de survivants.