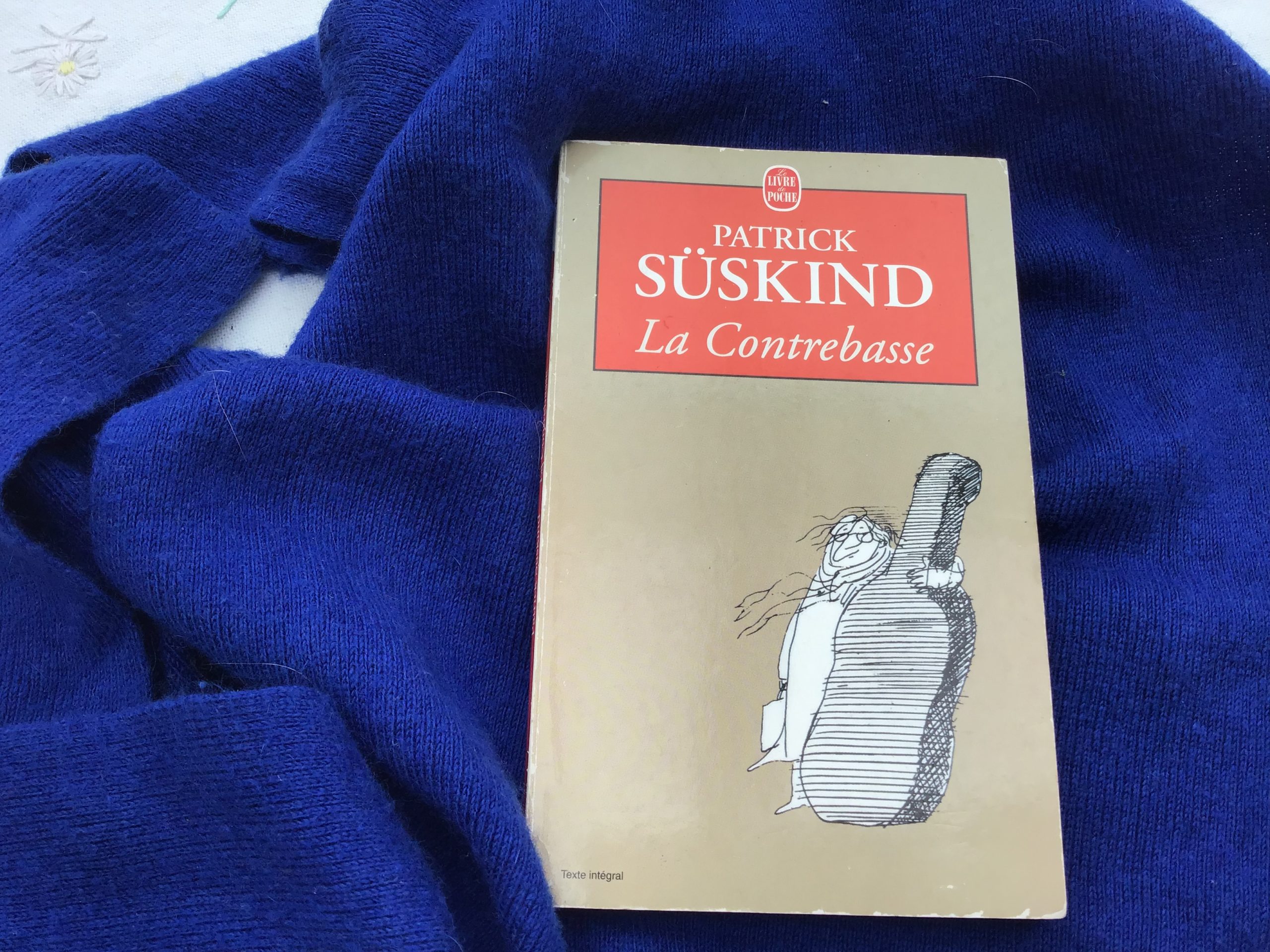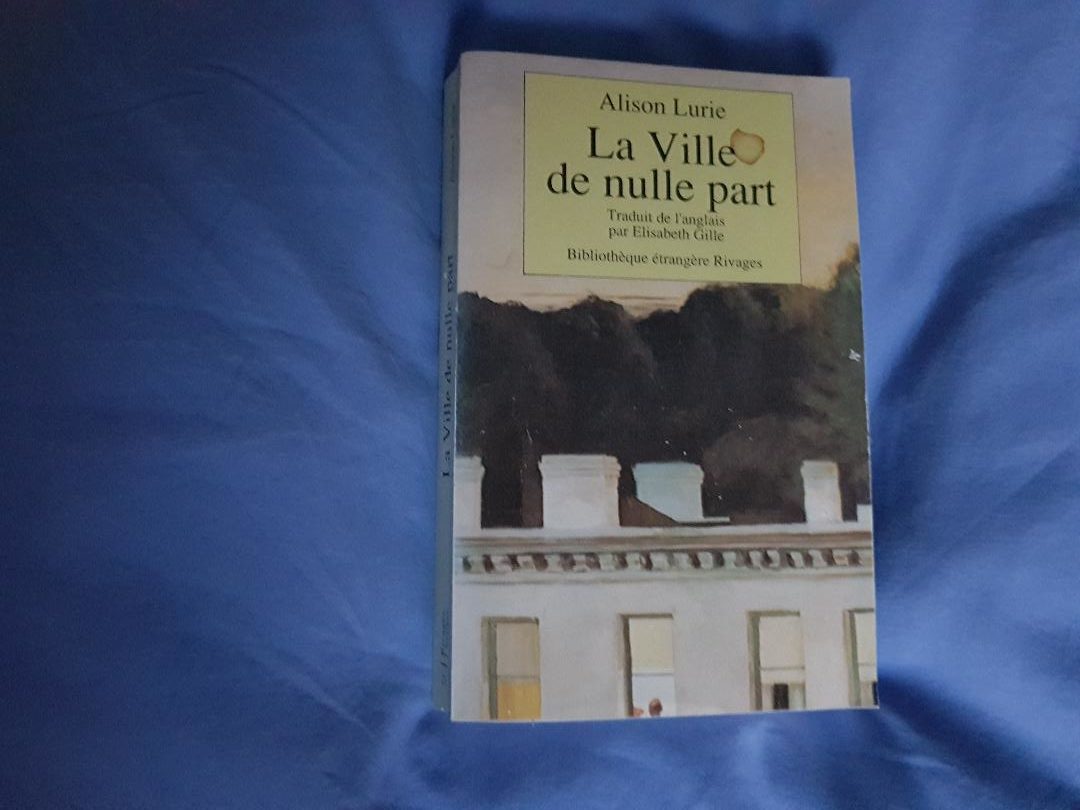Édition Robert Laffont Pavillons Poche . Traduit de l’allemand par Bernard Kreiss

participations au mois « les feuilles allemandes »
« Si on bouquinait un peu »
« Ingannmic »
 Surtout ne pas se fier à la quatrième de couverture qui raconte vraiment n’importe quoi :
Surtout ne pas se fier à la quatrième de couverture qui raconte vraiment n’importe quoi :
En 1943 son père , officier de police , est contraint de faire appliquer la loi du Reich et ses mesures antisémites à l’encontre de l’un de ses amis d’enfance, le peintre Max Nansen.
Il y a deux choses de vraies dans cette phrase, le père du narrateur est bien chef de la police local, et nous sommes en 1943 . Deux choses fausses, le père policier n’applique pas des mesures antisémites à Max Nansen qui d’ailleurs n’est pas juif , mais il applique des mesures qui combattent l’art dégénéré . Il n’est pas « contraint » de le faire, et ce mot trahit complètement le sens du roman, le chef de la police de Rugbüll éprouve une joie profonde à appliquer toutes les mesures qui relève de son « DEVOIR » . (J’attribue à cette quatrième de couverture la palme de l’absurdité du genre)
le roman se passe en deux endroits différents, le jeune Siggi Jepsen est interné dans une maison pour délinquants sur une île et doit s’acquitter d’une punition car il a rendu copie blanche à son devoir d’allemand sur le « sens du devoir ». Il explique que ce n’est pas parce qu’il n’a rien à dire mais, au contraire, parce qu’il a trop de choses à dire. Commence alors, la rédaction de ses cahiers qui nous ramènent en 1943 à Rugbüll un petit village rural du nord de l’Allemagne dans la province du Schleswig-Holstein. Une région de tourbières et de marais. Le père de Jens, le policier local est très fier de ses fonctions. Le devoir, c’est ce qui le fait tenir droit dans ses bottes comme tous les allemands de l’époque. Le deuxième personnage du récit c’est un peintre Max Ludwig Nansen dont les tableaux ne plaisent pas au régime en place. Tout ce qui est dit sur ce peintre nous ramène à Nolde qui effectivement a peint cette région et a été interdit de peindre en 1943, car sa peinture a été qualifiée d’art dégénéré, alors que lui même avait adhéré au partit Nazi et était très profondément antisémite, (Angela Merkel a fait enlever ses tableaux de la chancellerie à Berlin, pour cette raison) . Rien de tout cela dans le roman, mais une évocation saisissante de la peinture de Nolde qui a compris mieux que quiconque, sans doute, la beauté des paysages de cette région.

Le roman voit donc s’opposer le père du narrateur un homme obtus et qui n’a qu’une raison de vivre : appliquer les ordres et ce peintre qui ne vit que pour la peinture, tout cela dans une nature austère et au climat rude. Sur la couverture du livre je vois cette citation de Lionel Duroy :
J’aurais rêvé être un personnage de Lenz, habiter son livre.
Cette phrase m’a laissée songeuse, car j’ai détesté tant de personnages de ce roman. Je pense que Lionel Duroy n’aurait pas aimé être le père de Jens qui est capable de dénoncer aux autorités son propre fils Klaas qui s’est tiré une balle dans la main pour fuir l’armée. La mère qui dit tout comme son mari et qui explique à son fils de ne pas s’approcher des enfants handicapés car ils sont porteur de tous les vices et les malheurs du monde. Tous les personnages se débattent dans un pays si plat que rien ne peut y être caché et se meuvent dans une lenteur proche du cauchemar. Le peintre a une force personnelle qui rompt avec cet académisme bien pensant sans pour autant remettre à sa place le policier même après la guerre sans que l’on comprenne pourquoi.
Il y a une forme d’exploit un peu étrange dans ce roman, le mot Nazi n’y apparait jamais pas plus que la moindre allusion au sort des juifs, pas plus que le nom d’Hitler. Ce n’est sûrement pas un hasard mais je ne peux qu’émettre des hypothèses. Je pense que le but de Siegfried Lenz est de montrer qu’une certaine mentalité allemande est porteuse en elle-même de tous les excès du nazisme. Cette mentalité puise ses racines dans une nature où le regard se perd dans des infinis plats et gris auquel seul le regard d’un artiste peut donner du sens . Je vous conseille de regarder sur Arte un reportage sur Nolde, vous entendrez que ce roman de Siegfried Lens a contribué à effacer le passé antisémite du peintre et son engagement au côté du régime Nazi. Je comprends mieux les curieux silences de l’auteur qui m’avaient tant étonnée.
Tout cela donne un roman de 600 pages au rythme si lent que j’ai failli plusieurs fois fermer ce livre en me disant ça va comme ça ! Assez de nature grise mouillée sans aucun relief ! Assez de ces personnages qui restent face à face sans se parler ! Assez des bateaux sur l’Elbe qui n’avancent pas !
Mais, je me suis souvenue du mois des feuilles allemandes chez Patrice et Eva alors j’ai tout lu pour vous dire que vous pouvez laisser ce roman dans les rayons de votre bibliothèque d’où on ne doit pas le sortir très souvent. Et si vous voulez comprendre cette région regardez les tableaux de Nolde (malgré son passé nazi et son antisémitisme) vous aurez plus de plaisir et vous aurez le meilleur de cette région.

Citations
Un passage pour donner une idée du style et du rythme très lent du roman
Toujours plus haut, plus vite, plus abrupt. Toujours plus vigoureuse les impulsions. Toujours plus près de la cime large et défrisée du vieux pommier planté par Frederiksen du temps de sa jeunesse. La balançoire émergeait avec un sifflement de l’ombre verdoyante, glissait dans un grincement d’anneaux le long des cordes tendues et vibrantes et engendraient au passage un fort appel d’air ; et, sur le corps arqué et tendu de Jutra passait les ombres effrangées des branchages. Elle grimpait vers le sommet, restait un instant suspendu dans l’air, retombait ; j’intervenais dans cette chute en poussant rapidement au passage la planche de la balançoire ou les hanches de Jutta ou son petit derrière ; je la poussais en avant, en haut, vers le sommet du pommier, elle grimpait là-haut comme projetée par une catapulte, la robe flottante, les jambes écartées, et le courant d’air sifflant lui modelait sans cesse une nouvelle apparence, tirait ses cheveux vers l’arrière ou donnait plus d’acuité encore à son visage osseux et moqueur. Elle avait décidé à faire un tour complet avec la balançoire et moi, j’étais décidé à lui fournir l’impulsion nécessaire, mais pas moyen d’y arriver, même quand elle se mit debout, jambes écartées sur la planche, pas moyen d’y arriver, la branche était trop tordu ou l’impulsion insuffisante : ce jour-là, dans le jardin du peintre, pour le soixantième anniversaire du docteur Busbeck. Et quand Jutta comprit que je n’y arriverai pas, elle se rassit sur la planche. Elle se laissa balancer en souriant sans l’ombre d’une déception et se mit à me regarder d’une façon bizarre. Et soudain elle m’enserra et me retint dans la pince de ses jambes maigres et brunes, je n’avais plus guère notion d’autre chose que de sa proximité. En tout cas je compris cette proximité, et j’ose l’affirmer, elle comprit que j’avais compris ; je décidai de rester absolument immobile et d’attendre la suite mais il n’y eut pas de suite : Jutta me donna un baiser bref et négligent, desserra ses jambes, se laissa glisser à terre et courut vers la maison.
Le sens du devoir du père policier et le peintre
Peut-être te renverra t-on les tableaux un jour, Max. Peut-être que la Chambre veut-elle seulement les examiner et te les renverra-t-on après.
Et dans la bouche de mon père une telle affirmation, une telle hypothèse prenait un air de vraisemblance tel qui ne serait venu à l’idée de personnes de mettre en doute sa bonne foi. Le peintre en resta interloqué et sa réponse mit du temps à venir. Jens, dit-il enfin avec une indulgence un peu amère , mon Dieu, Jens, quand comprendras-tu qu’ils ont peur et que c’est la peur qui leur inspire cette décision, interdire aux gens d’exercer leur profession, confisquer des tableaux. On me les renverra ? Dans une urne peut-être, oui. Les allumettes sont entrés au service de la critique d’art, Jens, de la contemplation artistique comme ils disent. Mon père faisait face au peintre ; il ne montrait plus le moindre embarras et son attitude exprimait même une impatience arrogante. Je ne fus donc pas surpris de l’entendre dire : Berlin en a décidé ainsi et cela suffit. Tu as lu la lettre de tes propres yeux, Max. Je dois te demander d’assister à la sélection des tableaux. Est-ce que tu vas mettre les tableaux en état d’arrestation ? demanda le peintre et mon père, d’un ton cassant, nous verrons quels tableaux doivent être réquisitionnés. Je vais noter tout ça et on viendra les chercher demain.
Heureusement que l’écrivain narrateur prévient de la lenteur…
Mais il faut maintenant que je décrive le matin, même si chaque souvenir appelle des significations nouvelles : il faut que je mette en scène une lente éclosion du jour au cours de laquelle un jaune irrésistible l’emporte peu à peu sur le gris et le brun ; il faut que j’introduise l’été, un horizon sans bornes, des canaux, un vol de vanneaux, il faut que je déroule dans le ciel des nappes de brume, et que je fasse résonner de l’autre côté de la digue le bourdonnement vibrant d’un cotre ; et pour compléter le tableau, il faut que je quadrille le paysage d’arbres et de haies, de fermes basses d’où ne se lève aucune fumée ; il faut aussi que, d’une main négligente, je parsème les prairies de bétail taché de blanc et de brun.
Toujours cette lenteur qui convient aux gens du Nord de l’Allemagne
Je dois patienter si je veux tracer de lui un portrait ressemblant ; je dois évoquer les entrée en matière des deux hommes, leur extraordinaire propension à larder la table de la cuisine de silences exagérément longs -ils parle il parlèrent d’avion volant en rase-mottes et de chambres à air- je dois supporter une fois encore le soin minutieux qu’ils mirent à s’informer de la santé de leurs proches et je dois aussi songer à leurs gestes lents mais calculés.
Le devoir dialogue avec le facteur
Il y en a qui se font du souci, dit-il, il y a des gens qui se font du souci pour toi parce qu’ils pensent que les choses peuvent changer un beau jour : tu sais qu’il a beaucoup d’amis. J’en sais encore plus, dit mon père, je sais qu’on l’estime aussi à l’étranger, qu’on l’admire même, je sais que chez nous également, il y en a qui sont fiers de lui, fiers, parce qu’il a inventé ou créé ou fait connaître le paysage de chez nous. J’ai même appris que dans l’Ouest et dans le Sud c’est à lui qu’on pense d’abord quand on pense à notre région. Je sais pas mal de choses crois-moi. Mais pour ce qui est du souci ? Celui qui fait son devoir n’a pas de souci à se faire -même si les choses devaient changer un jour.
Son père, est ce de l’humour ?
Il avait la réflexion besogneuse, la compréhension lente, une chance car cela lui permettait de supporter pas mal de choses et surtout de se supporter lui-même.
L’allure de son père
On n’entendait pas encore leurs pas traînants dans le couloir que déjà le policier de Rugbüll s’apprêtait à les recevoir et adoptait un maintien que nous qualifierons de martial. Dressé de tout son haut , des jambes légèrement écartées , solidement ancré au plancher, l’air décontracté mais néanmoins en éveil, il resta planté au centre de la cuisine, revendiquant ostensiblement l’obéissance dont on lui était redevable en tant qu’instructeur et actuel chef de notre milice populaire.
L’après nazisme
On se dit qu’ils vont rester terrés un bon moment, faire les morts, se tenir cois, en tête à tête avec leur honte, dans l’obscurité, mais à peine a-t-on eu le temps de respirer Que déjà ils sont de retour. Je savais bien qu’ils reviendraient, mais pas si vite, Teo, jamais je ne l’aurais cru. Quand on voit cela, on ne peut que se demander ce qui leur fait le plus défaut : la mémoire ou les scrupules.
La présence des tableaux
Peut-être cela commença-t-il ainsi : je remarquai que j’étais observé et non seulement observé mais reconnu. Les slovènes étaient assis autour de leur table ronde, la mine béate, l’ œil vitreux, plein de schnaps. Les marchands avaient d’intérêt que pour une vieille femme qui passait sans faire attention à eux et les paysans courbés par le vent avaient fort à faire avant l’orage imminent. Les acrobates ? Les prophètes ? Ceux-là ne faisaient que soliloquer.
Ce devaient être les deux banquiers avec leurs mains vertes légèrement dorées et leur visage semblable à des masques, ils me regardaient. Ils avaient cessé de se mettre d’accord du coin de l’ œil sur l’homme prostré en face d’eux sur sa chaise. Son désespoir ne les intéressait plus, ils l’abandonnaient à sa douleur. Il me sembla qu’ils avaient levé le regard, toute trace de supériorité avait disparu de leurs yeux gris et froid. Je ne pouvais pas me l’expliquer, je ne cherchais pas non plus à me l’expliquer : la peinture se rétrécit , j’ai ressenti une douleur précise, comme un étau contre les tempes, quelque chose de clair se déplaçait vers la peinture germait très loin à l’arrière-plan et se rapprochait en vacillant.
Évocation de la nature qui peut faire penser aux tableaux de Nodle
Nous attendîmes jusqu’au crépuscule et il ne se passait toujours rien. Le soleil se couchait derrière la digue, exactement comme le peintre lui avait appris à le faire sur papier fort, non perméable : il sombrait, il s’égouttait pour ainsi dire dans la mer du Nord, en filaments de lumière rouges, jaunes, sulfureux ; de sombres lueurs fleurissaient des crêtes des vagues. Le ciel s’allumait de tons ocres et vermillons aux contours flous, aux formes imprécises, presque gauche ; mais le peintre lui-même le voulait ainsi : l’habileté, avait t-il déclarer un jour, ce n’est pas mon affaire. Donc, un long coucher de soleil, gauche d’allure, avec quelque chose d’héroïque malgré tout, plus ou moins bien, cerné au début comme noyé à la fin.

 Lors d’une discussion pendant les vacances de la toussaint, mes petits enfants ont exprimé toute leur passion pour Harry Potter, ma soeur leur a demandé : – Connaissez-vous « Émile et les détectives » ?
Lors d’une discussion pendant les vacances de la toussaint, mes petits enfants ont exprimé toute leur passion pour Harry Potter, ma soeur leur a demandé : – Connaissez-vous « Émile et les détectives » ?